Mélanie me taquine avec Angèle. Le surnom de Morticia l’amuse beaucoup. J’ai déjà avoué à Mel, même si je n’ai rien à lui cacher, que cette femme me permet de tenir le coup. Je n’ai pu la voir que quelques fois depuis cet été, mais Angèle est une énergie nouvelle dans ma vie. Bien sûr, elle est désespérément indépendante, bien sûr, elle voit probablement d’autres hommes, et oui, elle ne m’accueille que quand ça lui chante, mais elle m’aide à oublier mon ex-femme et me rassure sur ma virilité, à tous les sens du terme. Mes amis aussi ont remarqué le changement : depuis qu’Angèle Rouvatier est entrée dans ma vie, j’ai minci, je suis plus joyeux, j’ai arrêté de me plaindre. Je fais attention aux vêtements que je porte, mes chemises sont parfaitement blanches, amidonnées, et mes jeans noirs, bien coupés, comme les siens. J’ai acheté un long manteau qu’Arno trouve « trop cool » et que même Margaux semble apprécier. Et chaque matin, je m’asperge de l’eau de Cologne qu’Angèle m’a offerte, une senteur italienne citronnée qui me fait penser à elle, à nous.
Pendant ma longue conversation avec Mel, mon téléphone me signale un double appel. Je regarde mon écran : Margaux. J’interromps mon coup de fil avec ma sœur pour répondre ; c’est ma fille, elle m’appelle si rarement.
— Coucou, c’est papa !
La seule chose que j’entends en retour, c’est un profond silence.
— Tu es là, Margaux ?
Je perçois un sanglot étouffé. Mon cœur s’emballe.
— Ma chérie, qu’est-ce qu’il y a ?
La tête de fouine de Lucie se tourne vers moi. Je me lève et me dirige vers l’entrée.
— Papa…
Margaux a l’air d’être à des milliers de kilomètres, sa voix me parvient faiblement.
— Parle un peu plus fort, ma chérie, je ne t’entends pas !
— Papa !
C’est comme si elle hurlait maintenant. Elle me vrille les tympans.
— Qu’y a-t-il ?
Mes mains tremblent. Je manque de lâcher mon téléphone. Elle sanglote, les mots se bousculent confusément. Je ne saisis rien de ce qu’elle essaie de me dire.
— Margaux, mon amour, s’il te plaît calme-toi, je ne comprends rien !
Derrière moi, le parquet grince. C’est Lucie qui approche, furtivement. Je me retourne et lui lance un regard glacial. Elle se fige, un pied en l’air, et retourne à son bureau sans se faire prier.
— Margaux, parle-moi !
Je m’installe dans l’entrée, derrière une grande armoire.
— Pauline est morte.
— Quoi ? dis-je en m’étranglant.
— Pauline est morte.
— Mais comment ? balbutié-je. Où es-tu ? Que s’est-il passé ?
Sa voix est blanche à présent.
— C’est arrivé pendant le cours de gym. Après le déjeuner. Elle s’est évanouie.
Mes pensées s’emmêlent. Je me sens impuissant, perdu. Le téléphone en main, je retourne à mon bureau, j’attrape mon manteau, mon écharpe, les clefs.
— Tu es toujours en cours de gym ?
— Non, on est rentrés à l’école. Ils ont emmené Pauline à l’hôpital. Mais c’est trop tard.
— Ils ont appelé Patrick et Suzanne ?
— J’imagine que oui.
Je déteste sa voix de robot froid. Je préférerais l’entendre hurler à nouveau. Je lui dis que j’arrive tout de suite.
Une pensée me terrifie. Astrid n’est pas là. Astrid est loin, tu vas devoir te débrouiller tout seul, toi le père, toi le papa. Celui à qui sa fille a à peine adressé la parole le mois dernier, qu’elle ne « calcule » même pas.
Je ne sens pas le froid. Je cours aussi vite que je peux, mes jambes pèsent des tonnes. Mes poumons de fumeur souffrent. Port-Royal est à vingt minutes. Quand j’arrive devant le lycée, je croise des groupes d’adolescents et d’adultes aux yeux rouges. Je finis par voir Margaux. Son visage est ravagé. Les gens font la queue pour la prendre dans leurs bras, pour pleurer avec elle. Pauline était sa meilleure amie. Elles étaient ensemble en cours depuis la maternelle. Depuis plus de dix ans. Dix sur quatorze ans de vie. Deux professeurs que je connais passent près de moi. Je marmonne un bonjour et fends la foule pour atteindre ma fille. Arrivé près d’elle, je la serre contre moi. Elle est si frêle, si fragile. Je ne l’ai pas serrée comme ça depuis longtemps.
— Que veux-tu faire ? dis-je.
— Je veux rentrer à la maison.
J’imagine que, vu les circonstances, les cours ont dû être suspendus pour la journée. Il est quatre heures et le jour commence déjà à baisser. Elle dit au revoir à ses amis et nous remontons péniblement le boulevard de l’Observatoire. La circulation est bruyante, ça klaxonne, les moteurs grondent, mais entre nous, il n’y a que du silence. Que puis-je lui dire ? Les mots ne sortent pas. Je ne peux que passer mon bras autour d’elle et la serrer contre moi. Elle est chargée de tas de sacs. J’essaie de la soulager en en prenant un, mais elle proteste avec vigueur : « Non ! » et m’en tend un autre. Celui-là, je le reconnais, c’est son vieux Eastpak. Elle s’accroche à l’autre comme à sa propre vie. Ce doit être celui de Pauline.
Nous dépassons Saint-Vincent-de-Paul, l’hôpital où sont nés mes enfants. Et Pauline aussi. C’est comme ça que nous avons rencontré Patrick et Suzanne, puisque les filles ont deux jours d’écart. Astrid et Suzanne étaient dans la même aile. La première fois que j’ai posé les yeux sur Pauline, c’était dans cet hôpital, dans le petit berceau de plastique qui jouxtait celui de ma fille.
Pauline est morte. Je ne réalise pas encore. Les mots n’ont aucun sens. Je veux en être sûr, bombarder Margaux de questions, mais son visage hagard me freine. Nous continuons à marcher. La nuit tombe. Il fait froid. Le chemin du retour est interminable. J’aperçois enfin l’énorme croupe de bronze du lion de Denfert-Rochereau. Nous ne sommes plus qu’à quelques minutes.
En entrant dans l’appartement, je prépare du thé. Margaux s’est assise sur le canapé, le sac de Pauline posé sur les cuisses. Quand elle lève les yeux vers moi, alors que j’arrive avec le thé sur un plateau, je trouve le visage dur et fermé d’une adulte. Je pose le plateau sur la table basse, lui sers une tasse, avec du lait et du sucre. Elle la prend sans rien dire. Je lutte pour ne pas allumer une cigarette.
— Peux-tu me dire ce qui s’est passé ?
Elle boit à petites gorgées. D’une voix basse où l’on sent la tension, elle lâche :
— Non.
La tasse tombe sur le sol et me fait sursauter. Le thé gicle en dessinant une étoile. Margaux sanglote. Je tente de la prendre dans mes bras mais elle me repousse violemment. Je ne l’ai jamais vue si en colère, son visage est déformé, écarlate, gonflé de rage. Elle hurle aussi fort qu’elle peut, en postillonnant.
— Pourquoi, papa ? Pourquoi c’est arrivé ? Pourquoi Pauline ?
Je ne sais pas quoi faire pour la calmer. Aucun mot apaisant ne veut sortir de ma bouche. Je me sens inutile. Mon esprit est vide. Comment puis-je l’aider ? Pourquoi suis-je si gauche ? Si seulement Astrid était là. Elle saurait quelle attitude adopter, les mères savent toujours. Pas les pères. Enfin, pas le père que je suis.
— On va appeler ta mère, marmonné-je en hésitant, tout en calculant le décalage horaire. Oui, c’est ça, appelons ta mère.
Ma fille me lance un regard méprisant. Elle tient toujours le sac de Pauline serré contre elle.
— C’est tout ce que tu as trouvé ? me dit-elle, ulcérée. Appelons ta mère ? C’est comme ça que tu crois m’aider ?
— Margaux, je t’en prie…
— Tu es pathétique ! C’est le pire jour de ma vie, et tu ne sais même pas comment m’aider, putain ! Je te déteste ! Je te déteste !
Elle se précipite dans sa chambre. J’entends sa porte claquer. Ses paroles me brûlent. Je me fous de l’heure qu’il est au Japon. Je cherche le bout de papier où j’ai noté le numéro de leur hôtel à Tokyo. Mes doigts tremblent quand je compose le numéro. Je te déteste. Je te déteste. Ces mots martèlent mon crâne.
La porte d’entrée claque à son tour. Ce sont les garçons qui rentrent. Arno est au téléphone, comme d’habitude. Lucas s’apprête à me parler quand l’hôtel décroche. Je lève la main pour lui faire signe de se taire. Je demande Astrid en utilisant son nom de jeune fille, puis je me souviens qu’elle est descendue sous le nom de famille de Serge. La réceptionniste m’informe qu’il est près d’une heure du matin. J’insiste, c’est une urgence. Les garçons me regardent ahuris. Au bout du fil, j’entends la voix endormie de Serge. Il commence par se plaindre que je le réveille en pleine nuit, mais je le coupe et lui demande de me passer Astrid. Sa voix est inquiète :
— Qu’est-ce qui se passe, Antoine ?
— Pauline est morte.
— Quoi ? dit-elle dans un souffle, à des milliers de kilomètres de là.
Les garçons me fixent avec horreur.
— Je ne sais pas ce qui est arrivé. Margaux est en état de choc. Pauline a perdu connaissance pendant le cours de gym. C’est tout ce que je sais.
Silence. Je l’imagine assise sur son lit, les cheveux en désordre, Serge dans son dos, dans une de ces chambres d’hôtel chic et contemporaines, en haut d’un gratte-ciel, avec salle de bains ultra-moderne, vue à couper le souffle, mais plongée dans l’obscurité à cette heure. Le « catalogue de sushi » étalé sur une grande table, avec les épreuves photographiques de Serge. Un ordinateur en veille dont le fond d’écran mouvant brille dans le noir.
— Tu es toujours là ? finis-je par dire tandis que le silence s’éternise.
— Oui, me répond-elle avec un calme presque froid. Est-ce que je peux parler à Margaux ?
Les garçons, interdits et mal à l’aise, s’écartent pour me laisser passer, le téléphone à la main. Je frappe à la porte de ma fille. Pas de réponse.
— C’est ta mère.
La porte s’entrouvre, elle m’arrache le téléphone et la referme aussitôt. J’entends un sanglot étouffé, puis la voix terrifiée de Margaux. Je retourne dans le salon où les garçons n’ont pas bougé, pétrifiés par la nouvelle. Lucas, livide, retient ses larmes.

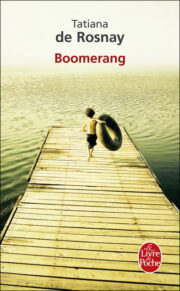
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.