— Je commence par les laver. Je prends mon temps. Je les nettoie de la tête aux pieds. Avec une douchette spéciale. – Elle me montre un évier tout proche. – J’utilise une éponge et un savon antiseptique, ce qui me permet de bouger les membres pour diminuer la rigidité cadavérique. Je scelle les yeux avec des capuchons spéciaux et je suture la bouche, enfin, je déteste ce mot, je préfère dire que je ferme la bouche, et parfois je me sers d’adhésif parce que c’est plus naturel. Si le visage ou le corps a subi un traumatisme, je travaille les zones concernées avec de la cire ou du latex. Puis je commence à embaumer. Tu sais comment on procède ?
— Pas vraiment.
— J’injecte le fluide d’embaumement par la carotide et j’aspire le sang de l’autre par la veine jugulaire. Le liquide d’embaumement restaure la couleur naturelle et retarde la décomposition, au moins pendant un moment. Grâce à l’injection, tout le violet disparaît du visage de monsieur B. Ensuite, j’utilise un trocart pour retirer tous les fluides corporels. De l’estomac, des intestins, des poumons, de la vessie. – Elle fait une pause. – Ça va toujours ?
— Oui, dis-je, sincèrement.
C’est la première fois que je vois un cadavre, si j’excepte la forme du corps de ma mère sous le drap. J’ai quarante-trois ans et je n’ai jamais regardé la mort en face. Je remercie intérieurement monsieur B. de montrer un visage si serein et un tel teint de pêche. Ma mère ressemblait-elle à ça ?
— Et tu fais quoi ensuite ?
— Je remplis toutes les cavités avec des produits chimiques concentrés, puis je suture les incisions et les orifices. Cela aussi prend un certain temps. Évitons les détails, ça n’est pas très plaisant. Ensuite, j’habille mes patients.
J’adore la façon dont elle dit « mes patients ». Ils sont plus morts que morts et elle les appelle ses patients. Je remarque que, toute la durée de son explication, sa main nue est restée sur l’épaule de monsieur B.
— Est-ce que la famille de monsieur B. est déjà venue le voir ?
Elle regarde sa montre.
— Ils viennent demain. Je suis très satisfaite de monsieur B. C’est pour cela que j’ai tenu à te le montrer. Ce n’est pas comme les autres patients dont j’ai eu à m’occuper aujourd’hui.
— Pourquoi ?
Elle se tourne vers la fenêtre. Se tait un moment.
— La mort est parfois très laide. On a beau déployer tous les efforts du monde, dans certains cas il est impossible de rendre un visage ou un corps suffisamment paisible pour qu’il puisse être montré à la famille.
Je frissonne en pensant à ce qu’elle doit voir tous les jours.
— Comment fais-tu pour que tout ça ne t’atteigne pas ?
Elle se retourne pour me regarder.
— Oh, mais tu sais, cela m’atteint.
Elle soupire, remonte le drap sur le visage de monsieur B.
— Si je fais ce métier, c’est à cause de mon père. Il s’est suicidé quand j’avais treize ans. C’est moi qui l’ai trouvé à mon retour de l’école. Il était affalé sur la table de la cuisine, la cervelle éclatée contre les murs.
— Mon Dieu !
— Ma mère était dans un tel état que c’est moi qui ai dû tout prendre en charge et organiser les funérailles. Ma sœur aînée s’est effondrée. J’ai beaucoup grandi ce jour-là, et je suis devenue la dure à cuire que tu connais. Le thanatopracteur qui s’est occupé de lui a fait un travail formidable. Il a reconstitué le crâne de mon père avec de la cire. Ma mère, et toute la famille, a pu le voir une dernière fois sans tomber dans les pommes. Moi, je suis la seule à l’avoir vu avec la tête explosée. J’ai été si impressionnée par le travail de l’embaumeur que j’ai tout de suite su que je ferais ça plus tard. J’ai eu mon diplôme à vingt-deux ans.
— C’était difficile ?
— Au début, oui. Mais je sais à quel point c’est important, quand on a perdu quelqu’un de cher, de pouvoir le regarder une dernière fois et de trouver de la paix sur son visage.
— Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier ?
— Plus que tu n’imagines. Quand je m’occupe de bébés ou de jeunes enfants, les parents sont soulagés de savoir qu’ils vont avoir affaire à une femme. Ils doivent penser qu’une femme aura des gestes plus doux, sera attentive aux détails, respectera la dignité de ceux qu’ils aimaient.
Elle me prend la main et me sourit, avec cette lenteur si particulière.
— Tu me laisses le temps d’une douche et je vais te faire oublier tout ça. On va chez moi.
Nous traversons les bureaux adjacents. Juste après, se trouve une cabine de douche carrelée de blanc.
— J’en ai pour une minute, dit-elle en disparaissant.
Sur son bureau, je remarque des photographies. De vieux clichés en noir et blanc montrant un homme d’âge mûr. Il lui ressemble énormément. Ce doit être son père. Les mêmes yeux, le même menton. Je m’assois à son bureau. Des papiers, un ordinateur, des lettres. Près de son téléphone portable, se trouve un petit agenda. Je suis tenté d’y jeter un coup d’œil. Je veux tout savoir de cette fascinante Angèle Rouvatier. Ses petits amis, ses rendez-vous galants, ses secrets. Mais je résiste finalement à mon envie. Je suis heureux de l’attendre ici, même si je ne suis probablement qu’un homme de plus qui a craqué pour elle. J’entends la douche couler dans la pièce d’à côté. J’imagine l’eau glissant sur sa peau douce, tout le long de son corps. Je suis obsédé par ses lèvres chaudes et humides. Obsédé par ce que nous allons faire quand nous arriverons chez elle. J’y pense dans les détails. Je sens monter une érection monumentale. Pas vraiment convenable dans une morgue.
Pour la première fois depuis longtemps, j’ai la sensation que ma vie s’éclaire. Comme le premier rayon de soleil après la pluie. Une lumière fraîche et délicate. Comme le passage du Gois réapparaissant à la marée descendante. Je ne veux pas passer à côté de ça. Je ne veux pas en rater une miette.
Mi-septembre, Mélanie rentre chez elle pour la première fois depuis l’accident. Je me tiens à ses côtés sur le seuil de son appartement. Je ne peux m’empêcher de penser qu’elle a l’air encore bien frêle et bien pâle. Elle marche toujours difficilement, avec des béquilles, et je sais que les prochaines semaines seront entièrement consacrées à une rééducation intense. Elle est heureuse et sourit largement quand elle voit que tous ses amis sont là pour lui souhaiter la bienvenue, les bras chargés de fleurs et de cadeaux.
Chaque fois que je vais lui rendre visite, rue de la Roquette, quelqu’un est à ses côtés pour lui tenir compagnie, qui prépare du thé, cuisine, écoute de la musique avec elle ou la fait rire. Si tout se passe bien, elle pourra reprendre son travail au printemps. Qu’elle en ait envie est une autre question.
— Je ne sais pas si l’édition est toujours un métier aussi intéressant qu’auparavant, nous avoue-t-elle, à Valérie et à moi, un soir, à dîner. J’ai du mal à lire. Je ne peux pas me concentrer, cela ne m’était jamais arrivé auparavant.
L’accident a transformé ma sœur. Elle est plus calme, plus réfléchie, moins stressée. Elle a arrêté de se teindre les cheveux, et finalement ses mèches blanches, qui brillent comme des fils d’argent dans la masse de sa chevelure, lui vont bien. Cela lui donne plus de classe encore. Un ami lui a offert un chat, une créature noire aux yeux jaunes appelée Mina.
Quand je parle à ma sœur, je brûle de lui lancer tout à trac : « Mel, te souviens-tu de ce que tu voulais me dire au moment de l’accident ? » mais je n’ose jamais. Sa fragilité me retient. J’ai plus ou moins abandonné l’espoir que les phrases qu’elle s’apprêtait à me dire lui reviennent. Mais j’y pense sans arrêt.
— Et ton vieil admirateur salace, il devient quoi ? lui demandé-je un jour en la taquinant, avec Mina ronronnant sur mes genoux.
Nous sommes dans son salon. La pièce est très lumineuse, sur les murs olive pâle, des rangées de livres. Il y a un grand canapé blanc, une table ronde avec un plateau de marbre, une cheminée. Mélanie a fait des merveilles dans son appartement. Elle l’a acheté il y a quinze ans sans emprunter un centime à notre père. C’était, à l’origine, une enfilade de chambres de bonne minables, au dernier étage d’un bâtiment sans prétention, dans un arrondissement qui n’était pas encore à la mode. Elle a fait abattre les murs, restauré les planchers, monté une cheminée sans me demander mon aide ou mes conseils. J’ai trouvé cela plutôt vexant à l’époque, mais j’ai fini par comprendre que c’était, pour Mélanie, une façon d’affirmer son indépendance. Et j’ai admiré ça.
Elle balance la tête.
— Oh ! lui… Il continue à m’écrire, il m’envoie des roses. Il m’a même offert de m’emmener en week-end à Venise. Tu m’imagines à Venise avec mes béquilles ? – Nous rions. – La vache, c’était quand la dernière fois que j’ai fait l’amour ? – Elle me regarde avec des yeux ronds. – Je n’arrive même pas à m’en souvenir. C’était probablement avec lui, le pauvre vieux.
Elle plante sur moi un regard inquisiteur.
— Et ta vie sexuelle, à toi, Tonio ? Tu fais bien des mystères et je ne t’ai pas vu aussi joyeux depuis des années.
Je souris en pensant aux cuisses douces comme de la crème d’Angèle. Je ne sais pas vraiment quand je vais la revoir, mais cette attente pleine d’impatience et d’angoisse rend la chose plus excitante encore. Nous nous parlons au téléphone tous les jours, plusieurs fois par jour, plus les SMS, les mails. Le soir, je m’enferme dans ma chambre comme un adolescent coupable et je la regarde nue par webcam. J’avoue plus ou moins à ma sœur que j’entretiens une relation à distance avec une thanatopractrice terriblement sexy.
— Eh bien ! s’exclame-t-elle. Éros et Thanatos. Tu parles d’un cocktail freudien ! Et quand pourrai-je la rencontrer, cette créature ?
Je ne sais même pas moi-même quand je vais la revoir en chair et en os. Au bout d’un moment, la webcam cessera d’être excitante, j’en suis sûr, et j’aurai besoin de la toucher, de sentir son corps, de la prendre. De la prendre vraiment. Ce n’est pas ce que je dis à Mélanie, mais je sais qu’elle comprend.

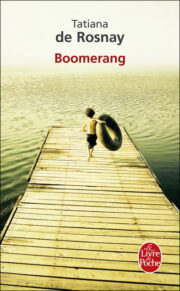
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.