Nous avions un jardin, dont je m’occupais avec cœur – qui peut se permettre d’avoir un jardin en plein Paris ? –, nous pouvions prendre nos déjeuners et dîners d’été à l’extérieur, malgré le ronronnement du périphérique voisin auquel nous nous sommes vite habitués. Notre vieux et pataud labrador qui y passe ses journées ne comprend toujours pas pourquoi j’ai déménagé, ni qui est le nouveau type dans le lit d’Astrid. Mon vieux Titus.
J’aimais les hivers près de la cheminée, le grand salon, toujours sens dessus dessous à cause des trois enfants et du chien. Les dessins de Lucas. Les bâtonnets d’encens d’Astrid dont le parfum puissant me faisait tourner la tête. Les devoirs de Margaux. Les baskets d’Arno, pointure 45. Le canapé rouge sombre qui n’avait plus sa splendeur des premiers jours, mais dans lequel il était toujours aussi agréable de s’endormir. Les fauteuils défoncés qui vous enveloppaient comme de vieux amis.
Mon bureau se trouvait au dernier étage. Spacieux, lumineux et calme. C’est moi qui l’avais aménagé. Dans cette pièce, surplombant les toits de tuile rouge et le ruban gris du périphérique, toujours encombré, je me sentais comme Leonardo DiCaprio dans Titanic quand il déclame I’m the king of the world, les bras tendus vers l’horizon. Moi aussi, j’étais le roi du monde. Maudit bureau. C’était ma tanière, mon antre. Astrid y grimpait, au bon vieux temps, quand les enfants étaient endormis, et nous faisions l’amour sur la moquette en écoutant Cat Stevens. Sad Lisa. J’imagine que Serge y a installé le sien. Et a pris possession de la moquette par la même occasion. Mieux vaut s’interdire d’y penser.
Notre foyer. Et ce jour où j’ai dû le quitter. Ce jour où je suis resté sur le seuil, enveloppant d’un dernier regard ce qui avait été à moi. Les enfants n’étaient pas là. Astrid me regardait avec un brin de mélancolie. Tout ira bien, Antoine, me rassurait-elle. J’ai acquiescé. Je ne voulais pas qu’elle voie les larmes qui montaient. Elle m’a dit de prendre ce que je voulais. Prends ce que tu estimes être à toi. J’ai commencé à remplir rageusement des cartons avec mon fouillis, puis j’ai ralenti le mouvement. Je ne voulais pas en emporter, des souvenirs, à part les photos. Je ne voulais rien de cette maison. Je voulais juste qu’Astrid me revienne.
Alors que j’attends que ma famille arrive dans ce sinistre troquet envahi par les accords d’une chanson sirupeuse de Michel Sardou, je me demande soudain si mon père n’aurait pas raison. Je ne me suis jamais battu pour elle. Jamais fait d’esclandre. J’ai renoncé, je l’ai laissée partir, courageux et bien élevé, comme quand j’étais petit garçon. Ce petit garçon propre sur lui, avec les cheveux bien peignés et un blazer bleu marine, qui n’oubliait jamais de dire s’il vous plaît, merci, pardon.
Enfin, j’aperçois notre bonne vieille Audi, couverte de poussière. Je regarde ma famille en descendre. Ils ne savent pas que je suis là, ils ne peuvent pas me voir. Mon cœur chancelle. Cela fait un moment que je ne les ai pas vus. Les cheveux d’Arno ont blondi au soleil et descendent jusqu’à ses épaules. Je vois qu’il essaie de se laisser pousser un bouc, ce qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, ne lui va pas si mal. Margaux porte un bandana autour de la tête, elle s’est légèrement remplumée. Sa démarche est maladroite, elle est un peu complexée. C’est Lucas qui me surprend le plus. Le petit garçon rondouillet est devenu une sorte de sauterelle tout en bras et en jambes. On sent le futur ado en lui qui commence à gronder, prêt à surgir tel l’incroyable Hulk.
Je ne veux pas regarder Astrid tout de suite, mais je n’y tiens plus. Elle porte une robe longue en jean délavé que j’adore, boutonnée de haut en bas et étroitement ajustée. Ses cheveux blonds, parsemés de quelques cheveux blancs, sont attachés. Elle a les traits tirés, mais reste très belle, malgré tout. Serge n’est pas là. Je soupire de soulagement.
Je les regarde quitter le parking et se diriger vers l’hôpital. Soudain je sors. Lucas pousse un hurlement et me saute dans les bras. Arno m’attrape par la tête et m’embrasse le front. Il est plus grand que moi. Margaux se tient à l’écart, sur une jambe, comme un flamant rose, avant de se décider à approcher et à fourrer sa tête contre mon épaule. Je m’aperçois que, sous le bandana, ses cheveux sont teints en orange vif. Je tressaille, mais ne me permets aucune remarque.
Je garde Astrid pour la fin. J’attends que les enfants aient fait le plein de leur papa, puis je la prends dans mes bras avec une sorte de faim fiévreuse qu’elle doit interpréter comme de l’angoisse. C’est incroyablement bon de la serrer contre moi. Son parfum, la douceur de sa peau, le velouté de ses bras nus me tournent la tête. Elle ne me repousse pas. Elle me rend mon étreinte, avec intensité. Je voudrais l’embrasser et je suis sur le point de le faire. Mais ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour Mel.
Je les emmène jusqu’à sa chambre. En chemin, nous croisons mon père et Joséphine. Mon père embrasse tout le monde avec sa délicatesse habituelle. Il tire sur le bouc d’Arno.
— Mon Dieu, mais qu’est-ce que c’est que ça ? grogne-t-il. Il donne à Arno, une tape dans le dos. – Tiens-toi droit, idiot, bête que tu es ! Ton père ne te le dit donc jamais ? Il ne vaut pas mieux que toi, franchement.
Je sais qu’il plaisante, mais comme toujours, son humour est mordant. Depuis qu’Arno est tout petit, mon père me harcèle à cause de l’éducation que je lui donne, me reprochant de mal l’élever.
Nous entrons tous sur la pointe des pieds dans la chambre de Mélanie. Elle n’est pas réveillée. Son visage est plus pâle que ce matin. Elle a l’air d’une petite chose et fait subitement plus que son âge. Les yeux de Margaux s’embuent et j’y vois briller des larmes. Elle a l’air horrifié par l’aspect de sa tante. Je passe un bras autour de ses épaules et la serre contre moi. Elle sent la sueur et le sel. Le parfum de cannelle de la petite fille a disparu. Arno demeure bouche bée. Lucas gigote, orientant son regard alternativement vers moi, sa mère et Mélanie.
Puis Mélanie tourne la tête et ouvre doucement les yeux. Elle reconnaît les enfants et son visage s’éclaire. Elle tente un faible sourire. Margaux éclate en sanglots. Les yeux d’Astrid sont aussi pleins de larmes, sa bouche tremble. Je m’éclipse discrètement dans le couloir. Je prends une cigarette que je n’allume pas.
— Interdiction de fumer ! hurle une infirmière aux airs de matrone en pointant un doigt rageur vers moi.
— Je la tiens juste. Je ne la fume pas.
Elle me lance un sale regard, comme si j’étais un voleur à l’étalage pris la main dans le sac. Je range ma cigarette dans son paquet. Je pense soudain à Clarisse. Il ne manque qu’elle. Si elle était encore en vie, elle serait ici avec nous, dans cette chambre, auprès de sa fille, de ses enfants, de ses petits-enfants. De son mari. Elle aurait soixante-neuf ans. Impossible d’imaginer ma mère à soixante-neuf ans. Elle restera pour toujours une jeune femme. J’ai atteint un âge qu’elle n’a jamais connu. Elle n’a jamais su ce que c’était que d’élever des adolescents. Tout aurait été différent si elle n’avait pas disparu. Mélanie et moi avons mis le couvercle sur notre puberté. Nous avions été habitués à la soumission ; il n’y eut donc ni emportements, ni cris, ni portes qui claquent, ni insultes. Pas de saine rébellion adolescente. La raideur de Régine nous avait muselés. Blanche et Robert avaient approuvé. C’était la bonne méthode, selon eux. Des enfants présents, mais en silence. Et notre père qui, en une nuit, était devenu une autre personne, ne s’intéressant plus à ses enfants, ni à leur avenir.
Mélanie et moi n’avons pas eu le droit d’être des adolescents.
Alors que je raccompagne ma famille vers la sortie, une grande femme en uniforme bleu pâle me dépasse en me souriant. Elle porte un badge, mais je ne parviens pas à savoir si c’est une infirmière ou un médecin. Je lui rends son sourire. Je songe à quel point il est agréable, dans ces hôpitaux de province, que les gens vous saluent, ce qui n’arrive jamais à Paris. Astrid a toujours l’air fatigué et je commence à penser que faire maintenant la route jusqu’à Paris, dans cette chaleur étouffante, n’est pas une très bonne idée. Ne pourraient-ils pas rester un peu plus longtemps ? Elle hésite, puis marmonne quelque chose à propos de Serge qui l’attend. J’ajoute que j’ai réservé une chambre dans un petit hôtel voisin où je resterai tant que Mélanie doit être hospitalisée. Pourquoi n’en profiterait-elle pas pour se reposer avant de reprendre la route ? La chambre est petite, mais fraîche. Elle pourrait même prendre une douche. Elle incline la tête, l’idée ne lui déplaît pas. Je lui tends les clefs et lui montre l’hôtel, juste derrière la mairie. Elle s’éloigne avec Margaux. Je les suis du regard.
Arno et moi retournons vers l’hôpital et nous asseyons sur les bancs de bois qui encadrent l’entrée.
— Elle va s’en tirer, hein ?
— Mel ? Tu parles ! Bien sûr qu’elle va s’en tirer.
Mais ma voix ne fait pas illusion.
— Papa, tu as dit que la voiture avait quitté la route ?
— Oui. Mel conduisait. Et puis soudain, boum, l’accident.
— Mais comment ? Comment est-ce arrivé ?
Je décide de lui dire la vérité. Ces derniers temps, Arno s’est montré distant, renfermé, ne répondant à mes questions qu’en grognant. Je n’arrive même pas à me souvenir de la dernière fois où nous avons eu une conversation digne de ce nom. Alors l’entendre à nouveau, sentir ses yeux fixer les miens me donne envie de prolonger autant que possible ce contact inespéré, d’une manière ou d’une autre.
— Elle était sur le point de me confier quelque chose qui la préoccupait. C’est à cet instant-là que c’est arrivé. Elle a juste eu le temps de me dire qu’un souvenir troublant avait ressurgi. Mais depuis l’accident, sa mémoire a quelques failles.

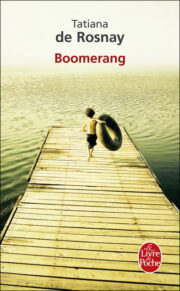
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.