Au crépuscule, on entraîna Squanto derrière la montagne. Il put voir la falaise s'ouvrir, se fendre et cracher ses entrailles dans un bruit terrifiant. Et quand la nuit fut venue, trois ou quatre pétards, qui voulurent bien partir malgré l'humidité, achevèrent de l'éblouir. Il revint parmi ses frères avec sur son visage l'expression de Moïse descendant du Sinaï.
– Oui, j'ai vu les étoiles tomber du ciel !
Le lendemain, à l'aube, Mistress William embrassa son enfant inconsciente, mais sauvée, qu'elle ne reverrait sans doute jamais.
Elle laissa à Angélique des indications sur l'établissement du Brunswick Falls, sur la rivière Androscoggin, où habitaient les grands-parents de l'enfant. Peut-être pourrait-on un jour l'y conduire. Serrant sur son sein sa fille nouveau-née, elle suivit courageusement ses farouches gardiens.
Angélique regarda le petit groupe s'éloigner sous la pluie qui tombait doucement. Brumes et brouillards rôdaient à la surface des lacs. La cime des arbres s'estompait dans les nuées aqueuses et lourdes. Les Indiens et leurs captifs longèrent le lac, les enfants portés par leurs maîtres ; Samuel Daugherty, le garçon de douze ans, toujours chargé comme un âne, « l'engagé » soutenant William qui boitait.
Les femmes plus chaudement vêtues, mieux chaussées, portaient leur bébé. Angélique avait drogué Cornélius, Tentant braillard, afin qu'il se tînt tranquille, et avait confié un flacon de la potion à sa mère. Les deux captives redressaient la tête et marchaient vaillamment afin de suivre le pas souple et rapide des Indiens et de ne pas s'attirer leur mécontentement. On vit le petit groupe s'enfoncer, disparaître à travers la forêt verdâtre, comme au sein d'un élément trouble, spongieux, liquide...
Chapitre 2
À mesure qu'on avançait dans la saison, les Indiens arrivaient de partout pour la traite. Ils entraient sans ambages, jetaient leurs fourrures sur la table, et s'installaient tout de go sur les lits avec leurs calumets et leurs mocassins boueux. Ils réclamaient de l'eau-de-feu et touchaient à tout. C'était le désespoir de Mme Jonas.
La fièvre de la fourrure gagnait les plus indifférents. Peyrac répétait qu'il ne voulait pas de ce commerce et que les bénéfices qu'on en tirerait seraient vite un leurre. Il savait aussi que pour les Français de la Nouvelle-France il y avait deux choses sacrées : la croix et le monopole du castor, et il trouvait inutile de s'attirer l'inimitié du gouvernement de Québec par un commerce dont il n'avait pas besoin. Mais il était difficile de se tenir tout à fait à l'écart de la traite. C'était à la fois la maladie du pays et du printemps. Elle secouait les gens comme une fièvre saisonnière.
Comment résister à la fascination de ces fourrures riches et tièdes, à leur inimitable douceur, à la blancheur immaculée des hermines, au noir profond des loutres, à la suavité grise, mauve ou bleutée des visons ou des renards argentés et surtout à l'or sombre bruni des castors, médaillons parfaits, parfois de dix pouces de large, ou enfin aux peaux d'ours noirs, de loups, de belettes rosés, de skunks rayés...
Des coureurs de bois canadiens apparurent, tel Romain de L'Aubignière, chargés de peaux qu'ils avaient ramassées dans les pays hauts, sur l'autre rive du Saint-Laurent. Ils osaient ce voyage à l'insu de leurs compatriotes pour demander à Peyrac de vendre leurs fourrures dans les villes anglaises ou hollandaises ce qu'ils ne pouvaient faire eux-mêmes sous peine d'être accusés de trahison. Mais ils savaient qu'ils gagneraient le double par cette voie, et qu'on trouvait chez les Anglais, en échange, de la quincaillerie deux fois meilleur marché et de meilleure qualité qu'au Canada. Leur bénéfice serait donc quadruplé s'ils ne vendaient pas à Québec.
Le comte accepta de leur servir d'intermédiaire, à charge de revanche pour eux de l'assister et de lui être amicaux quand l'occasion s'en présenterait.
Après la visite de L'Aubignière, le vieil Eloi Macollet n'y put tenir. Au milieu de toutes ces odeurs de poils et de bêtes, il était comme le vieux cheval de bataille qui entend le son des fifres et des tambours.
Il leva des écorces de bouleaux, cercla, cousit, colla, colmata et, ayant achevé son petit canot, le mit sur la tête et partit à la recherche d'un petit cours d'eau qui le mènerait jusqu'à la rivière Saint-François et, de là, au pays des Outaouais. Angélique et les enfants l'accompagnèrent en cortège aussi loin qu'ils purent et lui firent de grands signes d'adieux tandis qu'il se lançait, tout alerte, parmi les remous d'un torrent.
La jeune Anglaise Rosé Ann maintenant était guérie. C'était une enfant longue, frêle, pâle, que l'exubérance d'Honorine paraissait effrayer. Celle-ci l'appelait d'un air protecteur « la petite » bien que Rosé Ann eût le double de son âge. Elles se réconciliaient autour de la poupée merveilleuse et passaient des heures à préparer pour la princesse d'étranges mixtures que Lancelot engouffrait ensuite.
Angélique remarquait que Cantor avait cessé de provoquer Honorine et parfois se montrait bon pour elle. Il courait la montagne tout le jour, et même la nuit, suivi de la petite boule sombre du glouton. Et son père le laissait faire. Il ramenait de curieux récits de ses promenades nocturnes et promettait à Honorine de l'emmener une nuit observer un couple de loups et leurs petits, au clair de lune.
Il était devenu plus bavard, communiquant plus facilement ses pensées.
– J'aime les loups, disait-il, ils sont sensibles, intelligents. Le chien est féroce. Le loup, pas ; seulement, il se défend. Le chien compte sur l'homme. Le loup, non. Il sait qu'il est seul, qu'il n'a pas d'amis.
Des tipis s'élevaient tout alentour du poste avec leurs fumées nonchalantes et leurs cris d'enfants et de chiens.
Un jour, le superbe Piksarett survint. Il longea le bord du lac, en secouant fièrement la parure de plumes de corbeaux qui ornait son chignon entremêlé de chapelets de perles. Il entra en souriant dans la cour, jetant autour de lui des regards arrogants. Il ne parut pas remarquer l'émotion que sa venue suscitait et marcha droit vers les hommes qui se trouvaient dans la cour, ainsi qu'Elvire et Angélique. L'Indien leva la main en un salut cordial. Puis il tendit vers le charpentier Vignot une poignée de ce qu'ils prirent tout d'abord pour des fourrures et qui ressemblaient surtout à des queues de rats assez malpropres.
– Voulez-vous des scalps de « Yenngli » ?... Des scalps d'Anglais ?...
Elvire porta la main à ses lèvres, eut une nausée et s'enfuit.
– Voulez-vous des scalps de « Yenngli » ? répéta le sauvage. Ils sont entiers ! Je les ai coupés moi-même à Jamestook, sur la tête de ces infâmes coyotes qui ont tué Nôtre-Seigneur Jésus... Hé ! voulez-vous pendre cela à votre porte si vous êtes de bons chrétiens ?...
Et, éclatant de rire devant les visages effarés de ses interlocuteurs, le grand Abénakis pirouetta et s'en alla comme il était venu, plein de morgue et brandissant à bout de bras ses hideux trophées.
Vers le début de juin, le bruit courut que des hommes armés montaient en canots le fleuve Kennebec. On avait été trop tranquilles depuis quelque temps. On en riait parfois lorsqu'on s'imaginait les idées qu'on s'était faites en s'enfermant dans le fort pour l'hiver. On croyait qu'on n'allait voir personne pendant de longs mois. Qui oserait franchir des déserts mortels ? Mais les Français de Canada osent tout. Voilà ce que l'hiver leur avait appris. Des visites, on n'en avait pas manqué ! Et maintenant qu'on avait des forces à revendre et qu'il y avait de la poudre et des balles fabriquées à la mine, eh bien ! on ne demandait pas mieux d'en recevoir encore...
Mais bientôt, à certains détails donnés par les Indiens qui avaient apporté la nouvelle, il apparut qu'il s'agissait des mercenaires recrutés par Curt Ritz, l'homme de confiance que Peyrac avait laissé à cette fin en Nouvelle-Angleterre.
L'excitation changea d'objectif. Nicolas Perrot partit en estafette tandis qu'on hâtait les travaux de construction destinés à abriter ce nouveau contingent. Quelques jours plus tard, le Panis de Nicolas Perrot surgit.
– Ils arrivent !... Ils arrivent !...
On lâcha tout. Les gens de Wapassou et les Indiens couraient le long des rives. Comme ils parvenaient à l'extrémité du troisième lac, le premier homme émergea du trou feuillu où s'engouffrait l'eau de la décharge. Il émergea, cuirassé d'acier, carré, germanique, le poil dur, l'œil clair sous un sourcil broussailleux, image parfaite du mercenaire des champs de bataille de l'Europe posant son pied lourd sur la terre du Nouveau Monde. Ils l'entourèrent et le saluèrent avec émotion. Il répondit en allemand.
D'autres arrivaient à leur tour guidés par Perrot. Ils étaient une trentaine : Anglais, Suédois, Allemands, Français et Suisses.
Joffrey de Peyrac vit tout de suite que Curt Ritz ne se trouvait pas parmi eux, mais le lieutenant et ami fidèle de celui-ci se présenta. C'était un gentilhomme helvétique d'un canton de langue française, nommé Marcel Antine. Il salua le comte de Peyrac et lui remit un pli assez épais dans lequel, disait-il, était expliquée l'absence du commandant de la troupe. Lui-même en avait pris la charge et était heureux d'être arrivé à bon port. Il disait aussi qu'une barque à voiles avait remonté le fleuve avec eux, d'autres suivraient. Déjà du ravitaillement avait été expédié avec les hommes. Chacun portait un tonnelet d'eau-de-vie ou de vin, prévu pour les réjouissances de l'arrivée.
Aux questions que lui posait Peyrac demandant si Ritz était malade, blessé, il répondit évasivement, disant que l'explication était contenue dans cette lettre et que, si monseigneur voulait, il en discuterait plus tard avec lui.

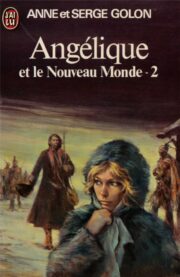
"Angélique et le Nouveau Monde Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2" друзьям в соцсетях.