— Je ne dois plus, je ne veux plus… je ne pourrai plus jamais mener la vie qui était mienne jusqu’ici, dit-il à Milly. Je refuse mon titre d’archiduc ainsi que celui d’Altesse impériale. Je ne veux plus être un fantoche prétentieux, un mannequin démodé manipulé par un vieillard féroce ; je veux être un homme libre, relever de ma seule conscience et ne plus dépendre que de moi-même, dans la pleine liberté de penser tout haut et d’agir à ma guise. J’entends vivre désormais sur les seuls revenus de ma fortune personnelle, qui n’est pas grande, et sans plus jamais coûter au trésor impérial un seul kreutzer…
Milly n’était pas de celles qui discutent quand leur maître et seigneur a pris une décision. Quelque temps après, malgré les supplications de sa famille, effrayée des conséquences de son geste, Jean-Salvator écrivait à l’empereur pour lui faire connaître, dans toutes les formes de respect requises, sa décision de renoncer à son rang, à ses titres, apanages et prérogatives, pour n’être plus qu’un simple sujet autrichien sous le nom de Johann Orth.
Trop cruellement frappé par la mort de son fils pour éprouver la moindre indulgence envers ce rebelle qu’il rendait en partie responsable des errements de Rodolphe, François-Joseph répondit par un décret qui allait plus loin encore, enlevant au révolté la nationalité autrichienne et lui interdisant de résider dans les limites de l’Empire.
Selon des témoins dignes de foi, une ultime et affreuse scène aurait confronté le vieil empereur et l’ex-archiduc, une scène dont le secret n’a point été révélé, mais dont les éclats auraient réussi à percer les murs cependant épais de la Hofburg. Mais quand, blanc de rage, Jean-Salvator descendit le grand escalier du palais impérial, il savait que plus jamais de sa vie, il ne le remonterait.
Rentré chez lui, dans le petit appartement de l’Augustinerbastei qu’il occupait avec Milly lors de leurs séjours à Vienne, il fit part à la jeune femme de sa décision de quitter l’Autriche, et même l’Europe, pour aller commencer au loin une vie nouvelle.
— Tu es libre, Milly, de me suivre ou non. L’exil est une épreuve pénible, même quand on aime.
— Je suis prête à te suivre où tu voudras, même au bout du monde s’il le faut. Tu sais bien que ma vie, c’est toi et toi seul.
Rassuré de ce côté, il restait à Jean-Salvator un devoir à remplir avant de s’éloigner : reprendre à la comtesse Larisch certain coffret de fer que Rodolphe, avant de partir pour Mayerling, lui avait confié avec prière de le remettre à qui le lui réclamerait en donnant, comme signe de reconnaissance, les quatre lettres gravées sur le couvercle : R. I. U. C.
Par une nuit glaciale, la comtesse, assez effrayée, reçut un ordre mystérieux : celui de se rendre avec le coffret dans les jardins de la place Schwartzenberg.
Il était tard, l’endroit était solitaire et la cousine de Rodolphe, plus morte que vive, vit venir à elle un homme coiffé d’un grand chapeau noir qui lui jeta les quatre lettres convenues. Elle lui tendit la cassette, mais la nuit n’était pas encore assez sombre pour que ses yeux aigus n’aient point reconnu Jean-Salvator.
— Est-ce que vous ne craignez pas, monseigneur, que ce dépôt vous fasse courir un grand danger ? murmura-t-elle.
— Et pourquoi donc, comtesse ? Sachez ceci : moi aussi, je mourrai. – Puis, après une courte réflexion il ajouta, sarcastique : – Je mourrai, mais je resterai en vie…
Quelques instants plus tard, il avait disparu, absorbé par les ombres de la nuit.
Le 26 mars 1890, le brick-goélette Santa Margharita, aux ordres du capitaine Södich, quittait Portsmouth avec, à son bord, le propriétaire du bateau, un Autrichien nommé Johann Orth. Le navire traversa l’Adantique et toucha terre à Buenos-Aires.
De là, le 10 juillet, Johann Orth écrivait à l’un de ses amis viennois, le journaliste Paul Henrich, pour lui dire qu’il était satisfait de son voyage et qu’il se disposait à le continuer afin d’explorer la Patagonie, la Terre de Feu et les abords du cap Horn. Mais il comptait prendre lui-même le commandement de la Margharita, ayant dû laisser à terre le capitaine Södich, sans doute peu disposé à un voyage aussi dangereux. Le départ était prévu pour le jour-même.
La Margharita mit donc à la voile et prit la direction du sud. Nul ne devait jamais la revoir ni même en entendre seulement parler. L’énigme Johann Orth commençait, car nulle part il ne fut possible de relever la moindre trace. Navire et équipage, passagers et commandant, tout disparut comme si une main géante les avait tout à coup effacés de la surface de la mer. Pas la moindre épave n’apparut, en admettant qu’il y ait eu naufrage, malgré les recherches extrêmement minutieuses entreprises sur l’ordre de François-Joseph qui, malgré sa rancune, envoya un navire à la recherche des disparus. Au bout de quelque temps, d’ailleurs, la cour de Vienne annonçait officiellement la disparition du prince de Toscane. Et pourtant…
Et pourtant, la mère de Jean-Salvator ne prit jamais le deuil d’un fils que cependant elle adorait et cela jusqu’à sa mort, survenue en 1898. Et pourtant, les familles des marins de la Margharita ne présentèrent jamais la moindre réclamation, la moindre demande de secours. Et pourtant, d’étranges affaires d’assurance purent laisser supposer que l’archiduc n’était pas mort et que le navire perdu toucha terre à La Plata, en décembre 1890.
Alors, le phénomène habituel aux disparitions princières se produisit : nombre de gens prétendirent avoir rencontré Johann Orth qui au Chili, qui en Afrique occidentale, qui en Patagonie, qui même dans l’île Juan Fernandez où avait vécu Robinson Crusœ, qui enfin en Inde, accompagné de Milly et de leurs enfants car, bien sûr, Milly elle aussi disparut sans que personne pût suivre sa trace.
Or, chose étrange, ceux qui prétendaient avoir rencontré Jean-Salvator ne faisaient aucune mention de la jeune femme, à l’exception d’une rocambolesque histoire due tout entière à l’imagination inépuisable de l’incurable comtesse Larisch-Wallersee, qui prétendait avoir retrouvé le jeune couple dans un massif montagneux au cœur de la Chine…
Reste un dernier témoignage, le dernier, le plus convaincant aussi : celui d’un voyageur français, le comte Jean de Liniers.
Celui-ci aurait rencontré en Patagonie, au pied du volcan Fitz-Roy, un étrange ranchero, Fred Otten, vivant là en compagnie d’un Anglais et d’un Allemand. Ce Fred Otten lui aurait avoué, un jour, n’être autre que le mystérieux Johann Orth. Quant à Milly, il aurait rompu avec elle avant même de quitter l’Angleterre. Mais en ce cas, que serait devenue la jeune femme et pourquoi n’aurait-elle laissé aucune trace elle non plus ?
Deux ans plus tard, le comte de Liniers retourna aux abords du volcan. Mais cette fois, il ne trouva plus qu’une tombe. Était-ce celle de Jean-Salvator ? Ou bien faut-il chercher ailleurs, au Brésil peut-être où l’ancienne famille impériale aurait peut-être beaucoup à dire sur la disparition si mystérieuse de la quatrième victime de Mayerling.
EMPEREURS
D'ALLEMAGNE
Le romantique amour
de Guillaume Ier
Le 18 janvier 1871, dans la prestigieuse galerie des Glaces du château de Versailles, la France, vaincue, connaissait la pire des humiliations. Dans le plus beau palais de l’univers, dans ce palais où s’étaient déroulés deux siècles, parmi les plus glorieux de la France, l’empire allemand était proclamé…
Ainsi l’avait voulu Bismarck, le chancelier de fer, l’homme qui n’avait jamais su voir dans la France autre chose qu’un pays commode pour y faire éclore ses amours. Et, sous le dais de soie et d’or que l’on avait installé pour la circonstance, le roi Guillaume de Prusse devint l’empereur Guillaume Ier.
Si l’empire était jeune, lui ne l’était plus. C’était un vieil homme de soixante-quatorze ans, dur et taciturne, un géant assez semblable à l’homme qui l’avait mis où il était. La France n’avait pour lui que de la haine, une haine bien légitime, mais il s’en souciait peu. En dehors de la couronne impériale qui allait coiffer son front têtu rien ne l’intéressait plus vraiment en ce bas monde. Il avait une femme, qu’il n’avait jamais aimée, des enfants, des petits-enfants, mais son cœur, enfoui depuis longtemps sous l’uniforme et les décorations, ne se manifestait plus que rarement. Et peut-être le peuple transi, haineux, qui, la colère et les larmes au fond des yeux, regarda briller dans la brume le fantôme de pierre de sel gloires éteintes eût-il un peu moins souffert s’il avait pu deviner que le vieil empereur vers qui Bismarck faisait monter des volées d’acclamations guerrières n’en entendait peut-être pas grand-chose. Peut-être ! au lieu des ors de Versailles, voyait-il au fond de mémoire ceux de Charlottenburg et, sous les lustres illuminés d’un soir de bal, une jeune fille blonde, en robe blanche, qui dansait…
Tout avait débuté cinquante ans plus tôt, au mois de juin 1820 quand le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, père de Guillaume, avait commencé d’éprouver quelques soucis au sujet de son fils cadet. En effet, depuis quelques semaines le jeune Guillaume Ier vingt-trois ans, donnait des signes indubitables et inquiétants de dérangement sentimental.
L’évidence voulait que le jeune prince ne mangeât plus guère, eût perdu le sommeil et, rêvant plus souvent qu’à son tour, affichât un peu partout et en toutes circonstances, même pendant les revues militaires, une mine songeuse et romantique tout à fait susceptible d’attendrir le cœur sensible des jeunes Berlinoises, mais absolument incompatible avec un grade de colonel. Et les potineuses de la Cour chuchotaient volontiers, dans les couloirs de Charlottenburg, que l’objet de la passion cachée du jeune homme était une ravissante fille de seize ans, la petite princesse Elisa, fille du prince Antony-Henryk Radziwill, gouverneur de Posen. Or, le roi de Prusse, s’il adorait les commandements lancés à plein gosier, avait positivement horreur des chuchotements…

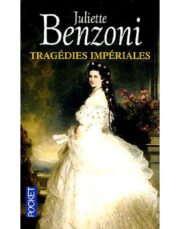
"Tragédies impériales" отзывы
Отзывы читателей о книге "Tragédies impériales". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Tragédies impériales" друзьям в соцсетях.