La couronne de Constantinople passait alors au quatrième fils de Pierre, Henri, qui la refusa sans même prendre le temps de respirer tant l’aventure l’avait scandalisé. Restait donc le cinquième, autrement dit le petit Baudouin.
Le pauvre gamin n’avait pas connu son père et sa mère était morte misérablement, à demi folle de douleur, quand il avait deux ans. L’empereur Robert, si peu intéressant qu’il fût, l’aima beaucoup. Une tendresse qu’il partageait avec sa sœur Marie de Courtenay, déjà veuve d’un empereur de Nicée. Installée à Constantinople, ce fut elle surtout qui s’occupa de l’éducation de Baudouin. Confié aux meilleurs maîtres, il apprit plusieurs langues dont le grec, les mathématiques, l’histoire et ce qu’il convenait que sût un garçon appelé à régner sur un grand peuple. Après la mort de Robert et, la réserve de fils étant épuisée chez les Courtenay, on le maria à Marie de Brienne, seconde fille de ce fameux Jean de Brienne qui avait été roi de Jérusalem et s’en était vu chasser par l’empereur allemand Frédéric II après que celui-ci eut épousé sa fille aînée Isabelle de Brienne-Jérusalem 16. Le vieux guerrier rongeait son frein en Italie et accueillit avec quelque plaisir l’idée de servir de tuteur au jeune Baudouin en coiffant jusqu’à sa majorité une couronne de co-empereur de Constantinople.
Dans la vie quotidienne Baudouin II était un homme aimable, ami des plaisirs et bon compagnon mais, s’il plaisantait volontiers son état d’empereur errant, cela n’en cachait pas moins une réelle douleur et un regret proche de la honte. Être le plus impécunieux des souverains d’un empire dont la richesse était jadis proverbiale, d’une ville où l’or coulait presque jusque dans les ruisseaux, n’était guère supportable. Naturellement courageux, il rêvait de hauts faits, de conquêtes et de ces splendeurs qui faisaient des anciens « basileus » les rutilantes images de Dieu sur la terre. Seulement il était d’intelligence moyenne et manquait de cette force de caractère nécessaire à qui veut être un vrai et grand souverain. Ainsi l’appui de Louis IX et de sa mère lui était nécessaire et il n’acceptait de conseil que venant d’eux. Ceux-ci l’aimaient bien, d’ailleurs, mais le Roi avec plus de chaleur et d’amitié vraie que Madame Blanche. Si celle-ci se félicitait de tenir en quasi-tutelle l’empereur titulaire de Constantinople, elle n’éprouvait pour lui qu’une certaine affection fortement nuancée de mépris. Allez donc prendre au sérieux un homme qui charmait ses rêveries au son aigre d’une cornemuse !
Cette passion bizarre remontait au premier voyage que Baudouin avait fait en Angleterre pour tenter d’entraîner le roi Édouard III dans une croisade qui, en passant par les rives du Bosphore et l’Anatolie, lui donnerait un coup de main pour ramener à la raison l’empereur de Nicée et autres princes grecs acharnés à le vouloir déposséder. Le souverain britannique ayant lui-même sa suffisance de soucis pour maintenir l’héritage Plantagenêt, le pauvre Baudouin n’obtint de lui que de bonnes paroles et une très vague promesse de se pencher sur la question mais, dans une taverne de Londres, il fit la rencontre d’Angus le Roux et de sa cornemuse, la seconde aidant le premier à subsister, ce qui voulait dire engloutir tout son content de bière. Et Baudouin, fasciné par cette musique étrange, s’attacha les services exclusifs du musicien et ensuite le traîna à peu près partout à sa suite.
Ce fut seulement en arrivant à Rome que Renaud découvrit ce nouveau personnage de l’entourage impérial. En effet, lors du départ de Baudouin pour Cologne et Paris, Angus était trop ivre pour qu’on pût seulement songer à le hisser sur un cheval et il avait bien fallu le laisser avec le reste de la suite, mais les retrouvailles furent touchantes et Baudouin passa une nuit entière au fond de son appartement du Latran à écouter Angus souffler dans son instrument.
Heureusement les murs étaient épais car l’époque n’était guère aux réjouissances musicales. L’interminable querelle entre les pontifes romains et l’empereur d’Allemagne venait de se rallumer. Elle avait vécu tant qu’avait duré le presque centenaire et coriace Grégoire IX et c’était à présent au tour de son successeur Innocent IV de faire face à un souverain schismatique par nature et fourbe plus qu’il n’est permis. La cause en était, cette fois, la ville de Viterbe, proche de Rome, mais annexée par Frédéric II, où les gens du cardinal Capocci, évêque de la ville, en étaient venus aux mains avec ceux du gouverneur impérial. Cela avait suffi pour faire voler en éclats des accords quelque peu fragiles. Chacun des adversaires en appela qui au Pape, qui à l’Empereur et, chacun envoyant à sa rescousse, la ville fut bientôt à feu et à sang… On put alors s’attendre au pire.
Cependant, au moment du retour de Baudouin Rome jouissait encore d’une très relative tranquillité, la ville papale aux sept collines connaissant habituellement des nuits plus agitées que ses jours. Hérissée de tours bâties sur les vestiges de la Rome des Césars ou sur des forteresses individuelles que les familles nobles, rivales presque toujours, avaient édifiées autant pour se protéger que pour narguer les autres, le bruit des armes emplissait plus souvent l’atmosphère locale que celui des cantiques. Frangipani, Orsini, Colonna, Massimi, Anabaldi et quelques autres se partageaient les collines, cependant que l’activité populaire se concentrait aux approches du Tibre : sur la rive gauche le Champ-de-Mars où les fours à chaux réduisaient les marbres antiques en nouveau matériau de construction – ceux tout au moins sur lesquels ne s’élevaient pas les tours féodales – et, sur la rive droite, le Transtevere où se concentraient l’activité du fleuve et celle des industrieux commerçants juifs. Le tout sous l’œil rébarbatif du mausolée d’Hadrien devenu le château Saint-Ange, une redoutable forteresse protégeant le pont Aelius et l’antique et petite basilique Saint-Pierre à demi ruinée.
Le domaine de Sa Sainteté, c’était le mont Caelius où, depuis le IVesiècle, siégeaient la résidence et l’administration pontificales. Le palais du Latran était alors un ensemble un peu confus de bâtiments reliés par un portique, le « corridor du Latran ». Il y avait plusieurs triclinia, ou salles à manger, dont la plus magnifique était le triclinium de Léon III, siège des banquets solennels. Venait aussi la salle du Concile ornée de somptueuses mosaïques et au milieu d’une fontaine bleu et or. Et puis des chapelles dont celle du Sancta Sanctorum avec des écoles de chanteurs, un séminaire pour les jeunes prêtres, sans compter un jardin planté de pins et bien entendu tous les services nécessaires à la vie quotidienne d’un palais papal et de ses habitants. Un palais si vaste que sa voisine, la basilique Saint-Jean-de-Latran, « la mère et la première de toutes les églises de la Ville et du Monde », faisait figure d’annexe en dépit de sa splendeur. L’ensemble s’élevait dans un auguste isolement, le défunt pape Grégoire IX ayant fait raser à son avènement les tours féodales trop proches à son gré.
Ce lieu si plein de majesté, de beauté et de grandeur, dont la première impression eût dû être de sérénité, était loin de l’inspirer. Ses salles et ses jardins, au lieu de renvoyer l’écho discret du pas cérémonieux des cardinaux, de ceux humblement mesurés des prêtres et des moines et du glissement quasi aérien des serviteurs sur fond d’oraisons ou de chants religieux, résonnaient comme un gong gigantesque du fracas des armes, des galopades des chevaux, du piétinement des soldats et des voix vigoureuses clamant des ordres dans l’air chaud et humide de Rome. Si les cloches, elles, se taisaient, c’était plutôt bonne chose car elles n’eussent pu sonner que le tocsin pour compléter ce tableau d’apocalypse.
Les nouveaux arrivants trouvèrent le Pape dans son cabinet privé qui ressemblait davantage à l’état-major d’un chef de guerre qu’à la salle de réflexion d’un successeur de saint Pierre. À cette différence toutefois que, s’il regorgeait de hauberts, de heaumes et autres chapeaux de fer, il y régnait un ordre absolu et un silence où s’entendait seule la voix sèche et précise d’Innocent IV.
S’il ne possédait pas la carrure physique de son irascible prédécesseur, l’ex-cardinal Sinibaldo Fieschi en imposait tout autant bien que d’une autre façon. Ce Génois avoisinant la cinquantaine était doué d’une intelligence froide et calculatrice, d’une personnalité active uniquement tournée vers les réalités, d’une retenue prudente et d’une grande souplesse qui lui permettaient d’exploiter sans scrupules les avantages acquis. Jadis ami de Frédéric II qui espérait, en poussant à son élection, réaliser enfin son rêve d’avoir un pape à sa botte, il s’était mué à peine assis sur le trône de Pierre en son adversaire le plus acharné car, ne considérant plus que les intérêts de l’Église, il leur sacrifia sans hésiter ses sympathies personnelles.
L’entrée de l’empereur de Constantinople annoncée par un héraut interrompit ce qui n’était rien d’autre qu’un conseil de guerre : les simarres cardinalices recouvraient plus de cottes de mailles que de soutanes en soie. Le Pape regagna le siège surélevé qui se trouvait dans toutes les salles de réception tandis que les autres personnes présentes se rangeaient autour de lui formant ainsi une assemblée assez impressionnante surtout pour le jeune écuyer. Être admis en présence du Pape était plus que Renaud eût jamais espéré, et ce fut en toute humilité qu’il s’agenouilla tandis que Baudouin allait baiser le gros saphir ornant l’annulaire droit du Pontife.
— Impériale majesté, notre fils en Jésus-Christ, vous voici donc de retour ? fit Innocent IV avec un froid sourire. D’où nous arrivez-vous aujourd’hui ?
— De France, Très Saint Père, où j’ai obtenu du roi Louis une courte audience…

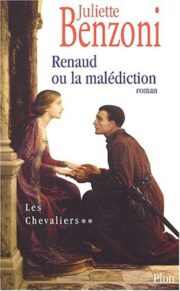
"Renaud ou la malédiction" отзывы
Отзывы читателей о книге "Renaud ou la malédiction". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Renaud ou la malédiction" друзьям в соцсетях.