— Arrangez-vous comme vous voulez, dit la Raucourt, mais il me faut une Élise ou je rentre à Paris !
Alors, le bon Weimer tente une timide proposition : il a une fille, Joséphine-Marguerite, qui a quatorze ans mais en paraît facilement trois ou quatre de plus et qui étudie pour être actrice. Elle ne s’en tire pas si mal, selon le père, et en outre elle connaît le rôle… Mais que pèse l’avis d’un père auprès d’une Raucourt pour qui, d’ailleurs, les souvenirs amiénois se ressemblent…
En effet, quelques années auparavant, elle était venue jouer Athalie dans le même théâtre et, cette fois, le jeune garçon chargé du rôle de Joas s’était trouvé défaillant. Pour éviter la catastrophe, on en avait trouvé un autre, très beau d’ailleurs et qui, une fois revêtu de la longue robe des lévites, ne manquait pas d’allure. Hélas, quand, au second acte, Athalie se rend au temple pour interroger le mystérieux adolescent et demande : « Comment vous nommez-vous ? » le vers de Racine n’éveilla aucun souvenir dans l’esprit simplet du garçon qui répondit avec un beau sourire et une grande politesse :
— Nicolas Branchu, Madame.
La salle s’est étouffée de rire et Raucourt de fureur. Aussi n’a-t-elle pas envie de revivre une soirée analogue. Une fois lui a suffi… Mais Weimer au bord des larmes la supplie : elle ne risque rien de pareil avec sa Joséphine et, comme il faut à tout prix une Élise, elle consent à écouter un instant. Le théâtre fait le plein ce soir.
C’est un argument auquel Raucourt est sensible. Elle n’est plus toute jeune et à Paris elle a un petit peu moins de succès : d’où cette tournée dans le Nord. Alors, elle accepte : « Voyons cette gamine ! »
Un instant plus tard, elle reste stupéfaite devant une magnifique adolescente : Joséphine a de grands yeux noirs, une beauté classique, un peu sévère même et pour ainsi dire romaine. On lui donnerait dix-huit ou vingt ans sans hésiter. En outre, elle possède une voix chaude, pleine et sonore qui, sur le vers fait merveille. Et, bien sûr, la débutante va jouer Élise avec un plein succès. La soirée est un triomphe et Raucourt décide qu’elle emmène « la gamine » :
— Elle a le théâtre dans le sang, déclare-t-elle. Je me charge de son éducation et lui ferai une pension de douze cents francs en attendant qu’elle se suffise à elle-même.
Et voilà Joséphine-Marguerite partie pour Paris. Pas toute seule d’ailleurs. Sa nourrice et sa brave femme de mère ont tenu à l’accompagner pour s’efforcer de protéger sa vertu. Autant le dire tout de suite cela ne servira à rien. À peine franchi le seuil de la Comédie-Française, la nouvelle va tomber dans les bras du séduisant Lafont, l’un de ses camarades.
Le trio un peu désorienté s’est installé rue Dauphine, dans une pension plus que modeste appelée hôtel de Thionville. Il est même si misérable qu’on le quitte bientôt pour celui du Pérou, rue Croix-des-Petits-Champs qui l’est un peu moins et, en outre, plus proche du théâtre. C’est à ce moment d’ailleurs que Joséphine y entre : jusque-là elle se contentait d’aller prendre des leçons chez Mme Raucourt qui habitait du côté des Champs-Élysées l’ancienne demeure de Mme Tallien. C’était assez loin mais la fillette et sa nourrice possédaient de bonnes jambes.
Ces visites quotidiennes ont d’ailleurs eu l’avantage de développer son goût pour les belles choses et de constater à quel degré de luxe pouvait atteindre une comédienne de renom. Elle apprend ainsi à se tenir en société et à employer le juste ton avec ses admirateurs. Enfin, le 28 novembre 1802, elle est admise à faire ses débuts. Elle s’appelle désormais Mlle George, en hommage à son cher papa et elle va débuter dans Iphigénie en Aulide, rôle de Clytemnestre ce qui ne va pas aller de soi.
C’est évidemment une drôle d’idée de confier un rôle essentiellement maternel et dramatique à une fille qui n’a pas encore seize ans mais la stature de George peut permettre cette bizarrerie. En revanche, le public, lui, n’est pas du tout d’accord et cela dès le lever du rideau. Avec, il faut bien le dire une excellente raison : le rôle de Clytemnestre était l’apanage de Mlle Duchesnois et il ne voyait pas pourquoi on le retirait à une artiste qui avait sa faveur pour le confier à une débutante.
Autre sujet de mauvaise humeur : Talma tient le rôle distribué jusque-là à l’irrésistible Lafont. Aussi, en dépit de la présence du Premier Consul et de sa femme, la salle est-elle houleuse quand Mlle George fait son entrée. Cris, sifflets, toutes les démonstrations d’une cabale en règle secouent le théâtre. La « nouvelle » va-t-elle se retirer ? Point du tout ! Laissant peser sur les agités son regard de velours sombre, elle entame son texte d’une voix de violoncelle qui fait courir un frisson dans le dos de ceux qui veulent bien se donner la peine d’écouter. Bonaparte est de ceux-là et séduit autant par la voix que par l’allure royale de cette enfant, il se met à applaudir à tout rompre.
Un si vigoureux soutien entraîne une partie de la salle mais sans calmer les enragés. Au quatrième acte, ils se déchaînent et George devra recommencer trois fois sa tirade. La troisième fois elle l’achève sous un tonnerre d’applaudissements unanimes. La partie est gagnée.
Ce soir-là, c’est un autre membre de la famille Bonaparte qui va offrir ses hommages à la nouvelle étoile : Lucien Bonaparte lui envoie un nécessaire en vermeil et cent louis d’or. Il sera récompensé selon ses mérites et Mlle George va s’installer dans un bel appartement de la rue Saint-Honoré où elle va vivre enfin dans le luxe.
La romance avec Lucien ne dure guère. Celui-ci rencontre bientôt une jolie veuve, Mlle Jouberthon dont il s’éprend passionnément et qu’il épouse en dépit de la fureur de son frère. Cela lui vaudra d’être exclu, plus tard, de certaines distributions de couronnes princières voire royales. Il sera prince un jour mais grâce au Pape.
Lucien disparu, Mlle George le remplace par un Polonais, le prince Sapieha qui la comble de tout ce qu’une fille d’Ève peut désirer. Néanmoins, la toute jeune femme en est encore à attendre la grande aventure de sa vie.
Ce soir-là, on a joué de nouveau Iphigénie en Aulide et Mlle George est Clytemnestre. Bonaparte est dans sa loge accompagné de Joséphine merveilleusement parée à son habitude mais beaucoup moins souriante que de coutume. Visiblement, elle trouve qu’une édition d’Iphigénie devrait suffire pour une vie entière et elle s’ennuie d’autant plus visiblement que son époux participe à l’action. Dieu sait qu’il y met du cœur ! Jamais on ne vit spectateur plus chaleureux. Et, à l’issue de la représentation, il tient à se faire présenter les artistes. Puis il s’en va mais, en rentrant chez elle, George constate qu’une voiture attend devant sa porte et qu’un inconnu est installé dans son salon.
Elle comprend tout de suite quand l’inconnu se nomme : il est Constant, le valet de chambre du Premier Consul et son message est fort clair : il vient inviter la tragédienne à se rendre le lendemain au palais de Saint-Cloud. Une voiture viendra la prendre.
Un éblouissement brouille un instant les yeux de George. Va-t-elle donc devenir l’amie… peut-être plus du maître de l’heure ? L’idée est plutôt grisante mais son prince polonais ne mérite pas qu’on lui joue un vilain tour car il est généreux, tendre et empressé… Seulement Bonaparte plaît à la jeune femme et elle sait qu’il n’aime guère qu’on le repousse. Enfin, il y a en elle une curiosité bien féminine : comment est-il dans l’amour ce foudre de guerre ?
Toutes ces hésitations ne prennent pas beaucoup de temps. Enfin, George se décide : elle ira à Saint-Cloud mais que la voiture vienne la prendre au théâtre, à huit heures comme prévu, et non chez elle.
Constant s’incline et se retire. C’est entendu : demain, huit heures à la Comédie-Française…
La jalousie de Joséphine
Une fois parti l’émissaire de Bonaparte, Mlle George a regretté de lui avoir donné rendez-vous au théâtre. Elle craint la publicité obligatoire que lui fera la venue d’une voiture du Consul, surtout vis-à-vis de son ami, le prince Sapieha. Et puis, elle n’aime pas dissimuler. Si elle doit devenir la maîtresse de Bonaparte, eh bien ! elle le sera, quitte à rompre avec le Polonais. Néanmoins, une fois dans la voiture un trac affreux s’empare d’elle et elle supplie Constant de rebrousser chemin.
Le valet de chambre de Bonaparte ne peut s’empêcher de rire : il serait bien reçu s’il revenait seul. D’autant qu’elle n’a aucune raison d’avoir peur. Le Premier Consul est d’une grande bonté et il saura d’autant mieux la rassurer qu’il l’attend avec impatience.
Naturellement, une fois à Saint-Cloud, ce n’est pas dans un salon du palais que l’on introduit la tragédienne. Après avoir laissé la voiture dans le parc, Constant conduit George à travers l’Orangerie et l’amène vers une porte-fenêtre de la terrasse devant laquelle veille Roustan, le mamelouk de Bonaparte. Le palais est tranquille, les salons sont obscurs.
Sans un bruit, la visiteuse est conduite dans une chambre élégante mais sévèrement meublée d’acajou sombre. De grands rideaux de soie verte pendent devant les fenêtres assortis à ceux qui drapent le lit. Constant se hâte de les tirer puis déclare qu’il va avertir son maître.
Assise sur un divan qui occupe un coin de la pièce, George s’efforce de dominer son trouble. Jamais elle n’a eu aussi peur ! Et quand la porte s’ouvre, elle sursaute : Bonaparte vient d’entrer. Et c’est avec beaucoup de gaieté et de gentillesse qu’il salue sa visiteuse. Il la fait rasseoir sur le divan, prend ses mains dans les siennes et s’étonne de les trouver si froides.

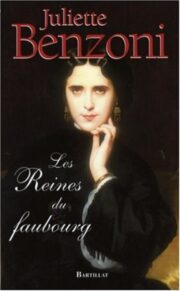
"Les reines du faubourg" отзывы
Отзывы читателей о книге "Les reines du faubourg". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Les reines du faubourg" друзьям в соцсетях.