Le soir même, Louis XIII fait à une Louise rougissante des excuses pleines de délicatesse auxquelles la jeune fille répond avec tant de gentillesse que le roi, charmé, s’assoit auprès d’elle pour bavarder un moment. Il l’interroge sur sa famille, son enfance, et Louise, déjà séduite par cet homme timide et simple qui est son roi, lui répond avec naturel. Elle lui parle de son cher Vésigneux, des siens, de tout ce qui a été son paisible univers. Elle parle aussi de cette étrange attirance qu’elle a toujours éprouvée pour le couvent. Elle dit qu’elle aurait aimé prendre le voile…
— Oh, mademoiselle, dit Louis, trouvez-vous donc le roi un si mauvais maître qu’il vous faille, à votre âge, chercher Dieu ?
Louise n’aura pas à répondre. Mme de Montbazon, qui surveille l’entretien, vient à point nommé demander à Louise de chanter. Celle-ci a une voix délicieuse et le roi devrait l’entendre. La soirée s’achève donc en musique mais, cette fois, Saint-Simon a gagné : quand il rentre chez lui, Louis XIII a oublié Mlle de Hautefort.
Dans les mois qui suivent, la cour ébahie assiste sans y comprendre grand-chose à l’éclosion d’un amour étrange, car il se défend de rien demander à la chair ni même à la terre. Professant tous deux une égale horreur du péché, Louis et Louise trouvent leur bonheur dans de longues conversations et dans une correspondance de plus en plus nourrie. Pour la première fois de sa vie le roi ose s’épancher, avouer les angoisses d’un cœur perpétuellement inquiet. Il ose aussi laisser deviner combien lui semble lourde parfois l’emprise du cardinal de Richelieu. Non sans ajouter aussitôt qu’elle est indispensable au bien du royaume. Mais Louise va tout de suite se ranger du côté de son ami et contre le cardinal.
Celui-ci d’abord ne s’inquiète pas de cette aventure, mais il commence à dresser l’oreille quand Louise, qui cependant ne demande jamais rien, obtient le poste de valet de chambre royal pour un M. de Boisenval, protégé de sa famille. En outre, Mlle de La Fayette prêche à son roi l’amour universel… quand une guerre serait nécessaire. Enfin sa famille, farouchement hostile à Richelieu, crée des troubles en Bourbonnais. Il faut faire quelque chose ! Et d’abord trouver à Louise un autre confesseur car le sien vient de mourir. Ce sera le père Carré, supérieur du noviciat des dominicains, un homme tout dévoué au cardinal.
Celui-ci n’a rien de plus pressé que de démontrer à Louise que c’est un grave péché qu’aimer un homme marié, et fait tant et si bien que, épouvantée, la jeune fille veut se retirer au couvent. Le roi en tombe malade. Alors, Mme de Montbazon qui, apparemment, s’est faite l’ange tutélaire des amours royales, vient chapitrer Louise : tient-elle tellement à tuer le roi ? Quelle mouche l’a piquée ?
Le nom du père Carré l’éclaire. La manœuvre est aisée à comprendre. Il faut tout de suite prendre un autre confesseur ! Louise ne demande pas mieux, bien sûr. Elle remercie le dominicain et, le soir même, vêtue de soie blanche, elle va chanter au chevet de Louis avec les musiciens de sa chapelle.
Ravi d’avoir retrouvé celle qu’il appelle tendrement son « beau lys », le roi se hâte de guérir et c’est le cardinal qui manque de tomber malade. Les jours qui suivent sont merveilleux. Louis XIII passe alors deux ou trois heures par jour auprès de son amie, sans se soucier de la guerre qui menace. Richelieu le rappelle au devoir mais Louise fait une véritable crise de désespoir et… commet une grosse sottise en déclarant que le cardinal ne veut cette guerre que pour séparer le roi de son amie…
Heureusement, Louis sait encore faire passer son devoir avant ses amours, mais le cardinal a compris : il lui faut se débarrasser au plus tôt de Mlle de La Fayette ! Alors, calmement, il organise la brouille entre ces « trop parfaits amants » et pour cela trouve le meilleur des agents : l’ingratitude. Acheté par lui, ce Boisenval qui doit sa place à Louise se fait son complice, subtilise des billets, colporte de faux bruits. On dit que le roi commence à être las des amours trop sages… que Mlle de La Fayette s’intéresse à un jeune seigneur… Tout cela réussit à merveille. Le roi et Louise souffrent le martyre chacun de son côté mais, trop fiers pour se plaindre, choisissent le silence… Louise, alors, se décide à entrer en religion, et l’annonce au roi.
Il reçoit le choc sans broncher, s’enfuit après quelques paroles mais, le lendemain, il rencontre la jeune fille dans la galerie qui mène chez la reine. Et, cette fois, il ne peut plus feindre :
— Vous ne m’aimez donc plus ? Moi je vous aime plus que jamais…
C’est la première fois que Louis prononce des mots d’amour. Jusqu’ici ils ne lui étaient pas apparus indispensables : tous deux se comprenaient si bien ! Et puis, il aurait craint de faire rougir son beau lys… Et, de fait, Louise a rougi… Et elle avoue, elle aussi, son amour mais elle craint trop d’être entraînée dans une voie qu’elle regretterait. Et c’est au tour de Louis de commettre une bêtise. Que pourrait-elle regretter, protégée par son amour ? Il peut la faire puissante, heureuse. Qu’elle soit à lui et il lui fera quitter la cour. Il l’installera dans son pavillon de Versailles…
Le malheureux ! Il a prononcé les mots irréparables et Louise s’enfuit en se bouchant les oreilles. Quelques jours plus tard, le 19 mai, elle entrait au couvent des Filles de Sainte-Marie de la Visitation pour y devenir sœur Louise-Angélique. Comme une bête malade, le roi a fui et se terre dans ce Versailles dont, un instant, il a pensé faire le nid de ses amours…
Ils se reverront pourtant. De temps en temps, le roi va au couvent visiter sœur Louise-Angélique. C’est en la quittant, un soir d’orage, qu’il devra aller passer la nuit avec la reine. Une nuit dont Louis XIV sera le fruit. On dit que Louise était du complot fomenté pour rapprocher les deux époux, qui n’avaient plus aucune vie commune.
Six ans, presque jour pour jour, après leur séparation, Louis XIII se meurt. Au père Dinet, son confesseur, il remet discrètement un petit crucifix qu’il porte au cou.
— Pour sœur… Louise-Angélique !…
Le château de Vésigneux oublia Louise. En 1651, il recevait le prince de Condé. C’est à lui qu’un homme appelé Urbain Le Prestre vint confier son fils Sébastien pour qu’il en fît un soldat. Ce jeune Sébastien devint par la suite M. de Vauban, le grand maître des fortifications de France.
À la Révolution, le château fut pillé. Le comte de Bourbon-Busset mourut de chagrin en apprenant que son fils était emprisonné et attendait la mort au Luxembourg. Après être passé par diverses mains, dont celles des Chabannes, Vésigneux, racheté en 1926 par Mlle de Bourbon qui le fit restaurer, appartient toujours à la famille…
Le château n’est pas ouvert à la visite.
1- Voir Hautefort.
Villette
La Vénus lycéenne
Fragilité, ton nom est femme.
« Un paysage délicieux, une société charmante, tous les talents réunis à la beauté dans la personne des filles de la maison, la musique, la peinture, le latin, le grec, toutes les langues, toutes les sciences. » Ainsi s’exprime dans le dernier quart du XVIIIe siècle un habitué, admirateur inconditionnel du charmant château de Villette et de ses habitants, le marquis de Grouchy, de vieille souche normande – on dit que l’un de ses ancêtres escortait Guillaume le Conquérant –, sa femme et ses trois enfants. Ce sont Sophie, l’aînée, qui est aussi l’héroïne de cette histoire, Emmanuel, alors garde du corps du roi Louis XVI mais qui sera un jour le maréchal de Grouchy, l’homme qu’à Waterloo l’Empereur attendra en vain, et enfin la petite Charlotte.
Tout le monde vit le plus gaiement, le plus aimablement du monde dans ce joli château des environs de Meulan : une large maison au bout d’une allée de vieux tilleuls, une maison qui semblerait presque simple s’il n’y avait la splendeur du parc orné de cascades et de jeux d’eaux, une maison où il fait bon vivre.
Mais en ce mois de décembre 1786, c’est de Sophie surtout qu’il est question à Villette : elle va, en effet, se marier et ce mariage agite la ville et la campagne, le monde intellectuel et celui des sciences, jusqu’à la grave Académie où l’on se préoccupe d’envoyer aux noces une délégation : « On en prenait dans la classe de géométrie, dans celle d’astronomie », on cherchait les représentants les plus dignes de la docte assemblée. Et pas seulement à l’Académie des sciences mais aussi à l’Académie française dont le fiancé est un membre très représentatif.
Au fait, le fiancé, qui est-il donc ? Tout simplement Jean-Antoine de Caritat, marquis de Condorcet, le grand savant, auteur de brillantes recherches sur le calcul intégral et l’algèbre, celui que Voltaire a déclaré « l’homme le plus nécessaire de France ». On conçoit l’émotion suscitée par une telle union alors que le siècle des Lumières jette ses derniers feux avant de sombrer dans la marée sanglante de la Révolution.
Le moins que l’on puisse dire est que les fiancés ne sont guère appariés du côté de l’âge. Sophie, qui fut d’abord chanoinesse au chapitre de Neuville-les-Dames en pays de Dombes, a vingt-deux ans. Elle est ravissante avec le minois le plus éveillé et d’immenses yeux noirs vifs et intelligents. Condorcet, lui, en a quarante-trois et n’est pas mal du tout. Mais ce n’est pas là ce qui cause la surprise et l’émoi général. Simplement, un géomètre qui se marie semble enfreindre un principe de droit. Lorsque l’on est un mathématicien, on se doit de ne pas exécuter ce que d’Alembert appelle le « saut périlleux ».
Quoi qu’il en soit, Condorcet fait le saut périlleux et il le fait par amour. Il aime Sophie au point de refuser toute dot. Il se contente d’un contrat verbal. De son côté, Sophie, à ce qu’il paraît, aime, elle aussi, son mathématicien, bien que l’on ait vaguement fait allusion à un penchant pour La Fayette.

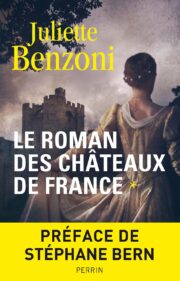
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.