Louise accepte : elle se conformera aux directives que lui donnera le marquis Colbert de Croissy, ambassadeur de France, et, avec Buckingham, elle s’embarque.
En fait, le duc a obéi avec empressement aux ordres de son maître lui enjoignant de ramener Mlle de Kéroualle. Il a une idée derrière la tête : se faire une amie de celle qui ne peut être que la future favorite et, ainsi, combattre l’influence de la favorite actuelle, l’arrogante Barbara Palmer, lady Castlemaine et duchesse de Cleveland, qu’il déteste et qui le lui rend bien.
De son côté, Louise sait bien qu’elle est destinée au roi mais elle va, durant de longs mois, lui tenir la dragée haute, ce qui est d’ailleurs fort habile. Cela se sait en France, si, en Angleterre, on pense généralement qu’elle s’est rendue beaucoup plus tôt. « Elle avait perdu sa réputation avant d’avoir perdu son honneur », écrit Bussy-Rabutin à une amie.
C’est à la fin de l’été 1671, en septembre, que Louise devient la maîtresse de Charles II au cours d’une fête charmante : chez lady Arlington, à Euston, on organise une noce villageoise. Les mariés ce sont le roi et Louise. Et le coucher de la mariée aura lieu en grande pompe et en face d’une assistance nombreuse. Mais, à cet instant, ce qui était simulacre devient réalité. Un an plus tard, Louise met au monde un enfant qui, trois ans plus tard, deviendra duc de Richmond.
En 1673, Mlle de Kéroualle devient duchesse de Portsmouth. Un beau titre que le roi Louis XIV, en récompense de sa fidélité, va doubler d’un autre titre français : celui de duchesse d’Aubigny (sur Nère). Sur le domaine se trouve le superbe château de La Verrerie et c’est à ce moment que la jolie Bretonne en devient propriétaire.
Le château avait pris son aspect actuel au XVe siècle et c’était au début de ce siècle que le vaste domaine avait été donné par le roi Charles VII à John Stuart of Buchan, comte de Darnley… et connétable de France. On ignore généralement que, durant la guerre de Cent Ans, l’Écosse combattit aux côtés de la France. John Stuart était le second fils du roi d’Écosse et devait périr au service de Charles VII. C’est depuis cette époque qu’une garde écossaise, d’où devaient sortir les gardes du corps, servait les rois de France. Après John Stuart, ses descendants conservèrent et embellirent La Verrerie, et c’est Béraud Stuart, l’un des héros de la bataille de Fornoue, en Italie, qui lui fit don de sa splendeur.
En fait, en donnant La Verrerie et le duché d’Aubigny à la maîtresse d’un roi Stuart, Louis XIV accomplit une sorte d’acte de justice puisque, plus tard, c’est le fils de Louise et de Charles II qui en héritera.
À Londres, cependant, la vie de la duchesse de Portsmouth n’est pas si simple. Le roi l’aime mais il a de nombreuses maîtresses dont la plus bruyante est sans doute la comédienne Nell Gwyn. En outre, on n’apprécie guère Louise parce qu’elle est française et catholique. Mais elle parvient tout de même à tenir son rang et même à marier sa sœur Henriette au comte de Pembroke. Cela lui vaudra de revoir les siens mais, pour que le sévère comte de Kéroualle pardonne à sa fille son rang de maîtresse royale, il ne faudra rien de moins qu’une lettre et un ordre de Louis XIV : « J’espère, écrit le souverain, que vous ne serez pas plus sévère que votre roi et que vous retirerez la malédiction que vous avez cru devoir faire peser sur votre malheureuse fille. Je vous en prie en ami et vous le demande en roi. » Que répondre à si noble lettre, sinon en s’inclinant ?
Après un voyage en France en 1682 où elle sera reçue en reine et viendra prendre possession de son château, la duchesse de Portsmouth ne réintégrera définitivement son pays natal qu’en 1685, à la mort de Charles II dont elle ne devait jamais perdre le souvenir. Rentrée à Paris d’abord elle y tint salon mais, entre elle et la toute-puissante Mme de Maintenon, les relations n’étaient guère bonnes. Certains propos tenus chez elle faillirent lui valoir l’exil mais Louis XIV gardait une indulgence pour celle qui l’avait si bien servi. Elle en fut quitte pour la peur.
Avec le temps, l’idée de Dieu s’emparait d’elle et elle se tournait vers la dévotion. Elle quitta alors Paris pour La Verrerie dont elle ne s’éloigna plus jamais et où elle s’éteignit en 1737.
Son fils hérita du château mais n’y vécut guère, choisissant de regagner l’Angleterre et d’y servir la famille d’Orange. Il fut gentilhomme de la chambre sous George Ier. Néanmoins, ses descendants, les ducs de Richmond, conserveront La Verrerie jusqu’en 1842, date à laquelle il passa à la famille de Vogüé, qui, depuis cette époque, en est demeurée souveraine et maîtresse.
Le château dispose de chambres d’hôte et organise chaque hiver des concerts de musique de chambre.
Promenade toutes les heures à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
En avril, mai, juin, septembre et octobre : tous les jours sauf le lundi et le mardi
En juillet et août : tous les jours
http://www.chateaudelaverrerie.com/
Vésigneux
Le « beau lys » du roi Louis XIII
Il accomplit des miracles, l’amour enveloppé de prières…
Quand on suit la route qui d’Avallon conduit à Lormes et à Château-Chinon, on aperçoit dans un beau fond un château, auprès d’un étang, un château dont les toits de vieilles tuiles et les poivrières couvrent des murs antiques qui, pour certains, ont connu les ravages des Grandes Compagnies. Mais, dans sa majeure partie, Vésigneux est l’œuvre du XVIIe siècle. C’est là qu’en 1619 Marguerite de Bourbon-Busset donne à son époux Jean de La Fayette, seigneur d’Hautefeuille, une petite fille qui jouera dans l’Histoire un rôle important puisqu’elle se trouve à l’origine d’un fait qui amena la naissance de Louis XIV.
Quand, en 1635, Louise de La Fayette qui a seize ans est nommée demoiselle d’honneur de la reine Anne d’Autriche, épouse du roi Louis, treizième du nom, c’est à Vésigneux le branle-bas de combat. La famille – une haute famille, d’ascendance royale puisqu’il s’agit des Bourbon-Busset – ne manque pas de biens en général mais, dans le château morvandiau, ce n’est pas la richesse. Pourtant il faut que Louise fasse bonne figure à la cour. Alors, afin de lui donner le trousseau, les robes qui conviennent à son nouvel état, on vend l’une des fermes. Et Louise, encore émerveillée de ce qui lui arrive, part pour Paris. Un peu inquiète aussi : jusqu’à présent, elle se croyait destinée au service de Dieu et au voile des religieuses.
D’aucuns pensent que ce serait dommage car elle est charmante, cette enfant. Petite et brune avec de beaux yeux de velours sombre, elle est toute grâce et tout charme, un charme timide et discret mais prenant et dont elle a trop de naïveté et d’innocence pour deviner le pouvoir. Quelqu’un va s’en charger à sa place.
Ce quelqu’un, c’est le grand louvetier de France, Claude de Rouvroy de Saint Simon, le compagnon de chasse préféré du roi. L’un de ses plus proches aussi. Or M. de Saint-Simon aime sincèrement son maître et enrage de le voir en butte aux entreprises d’une coquette avertie : la belle, l’insolente, l’arrogante Marie de Hautefort qui s’est juré d’amener Louis XIII au plus servile esclavage1. Et elle mène, en face d’un homme pudique et chaste jusqu’à la sauvagerie, un jeu cruel et délibéré dont chacun, à la cour, surveille les passes d’armes. À la grande exaspération de Saint-Simon qui a bonnement conseillé au roi de mettre l’intrigante dans son lit pour en finir une bonne fois. Mais il s’est heurté à une morale intransigeante :
— À Dieu ne plaise, mon ami, que l’adultère entre jamais dans ma maison, lui a dit le roi avec un rien de sévérité.
Alors ? Alors, il faut détourner Louis XIII du danger que représente la belle Hautefort et, pour cela, diriger son cœur romantique sur un « objet plus doux ». Et, dans cet ordre d’idées, Mlle de La Fayette semble incarner l’idéal aux yeux du grand louvetier.
Il commence par conseiller à son roi de s’intéresser, en apparence tout au moins, à la nouvelle venue, pour remettre un peu Marie de Hautefort à sa place : elle se croit trop sûre de son pouvoir sur Louis et a grand besoin qu’on lui rabaisse son caquet. Être un peu jalouse lui fera le plus grand bien…
L’idée séduit Louis XIII mais il n’a seulement jamais vu cette Mlle de La Fayette. Qu’à cela ne tienne ! Ce soir, chez la reine, on la lui montrera, et il pourra constater qu’elle est non seulement jolie mais encore très douce et très aimable.
Le soir venu, chez sa femme, Louis XIII remarque, près d’une fenêtre, un groupe de trois jolies filles qui semblent s’amuser beaucoup. Il connaît deux d’entre elles, Mlles de Polignac et d’Aiches, mais il ne connaît pas la troisième qui rit de si bon cœur aux plaisanteries de ses compagnes. C’est vrai qu’elle est charmante, cette brunette, mais Louis XIII, comme tous les timides, est maladroit. Il s’avance vers les jeunes filles et, du ton mécontent qui lui est trop habituel, il décoche :
— Pourquoi donc riez-vous si fort, mademoiselle ?
Le résultat est désastreux. Louise perd contenance, plonge dans une révérence gauche, essaie de dire quelque chose et, finalement, éclate en sanglots. Du coup, voilà le roi affolé :
— Mon Dieu ! Je vous ai fait de la peine ? Je ne le voulais pas.
Et comme il perd contenance lui aussi et risque de se mettre à bégayer, il préfère battre en retraite sans plus d’explications. Cette première entrevue n’est pas une réussite, mais Saint-Simon en a vu d’autres et ne s’avoue pas vaincu. Il fait comprendre à son maître qu’il y va de sa réputation de gentilhomme d’effacer la peine injuste causée à une enfant. Il lui explique qu’à seize ans il est tout naturel de rire quand on vous raconte des choses amusantes. Mais cela, le roi ne peut pas le comprendre : il ne sait pas rire.

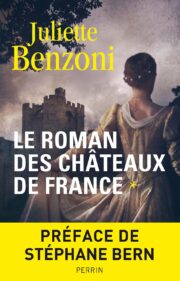
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.