Mais Mazarin, mourant, a institué le roi son héritier, mettant ainsi sa famille à l’abri tandis qu’à Vaux, en face d’une prodigalité qui écrase sa propre obscurité, en face de ce palais rayonnant qui minimise ses résidences, la colère du jeune roi monte peu à peu. Il sait, il veut bâtir un nouveau siècle, il veut que son règne soit grand. Il n’accepte pas l’ombre humiliante dans laquelle Fouquet le rejette. On lui a trop dit que les caisses de l’État sont vides pour qu’il admette une telle fortune chez un serviteur. Le sentiment n’est peut-être pas très beau, il n’en est pas moins humain.
En outre, voulant se faire bien voir, Fouquet a fait des « offres de service » à la jeune Louise de La Vallière pour laquelle il semble que le roi ait un penchant très vif. C’est la goutte d’eau qui fait déborder un vase déjà plein.
Louis XIV ne couchera qu’une nuit dans la chambre somptueuse préparée pour lui. Il repart le lendemain sans un mot de remerciement. Trois semaines plus tard, à Nantes où il a rejoint le roi pour assister aux États de Bretagne – il a acheté et fait fortifier Belle-Isle pour son usage –, Fouquet est arrêté par un capitaine de mousquetaires fort illustre, d’Artagnan. Une voiture fermée l’emmène sur-le-champ à Angers.
Le procès qui s’ouvrit à l’Arsenal, le 4 mars 1662, sous la présidence de Lamoignon, devait durer jusqu’au 20 décembre 1664. Il fut l’un des plus houleux et des plus curieux de l’Histoire. Il était peut-être difficile de s’y retrouver dans les comptes un peu embrouillés de Fouquet mais il est certain que la haine y eut sa large place et qu’en toute justice le surintendant n’avait pas trouvé sa fortune dans les seules caisses de l’État. Mazarin s’était servi beaucoup plus que lui.
La sentence n’en fut pas moins sévère : la prison à vie dans la forteresse de Pignerol en Piémont où d’Artagnan conduisit un prisonnier qu’il n’avait pratiquement jamais quitté. La famille fut dépouillée. Les scellés furent mis à Vaux et l’on aimerait, pour la beauté de l’histoire, que le roi ne se soit pas attribué une large part des dépouilles du vaincu. Heureusement, on ne toucha pas à la fortune de Mme Fouquet et, quelques années plus tard, elle put racheter Vaux. Mais, après la mort de son fils, elle le vendit au maréchal de Villars qui l’acheta sans même l’avoir vu et fut un peu affolé de son acquisition.
« La mariée est trop belle, déclara-t-il, et elle coûte cher. Trop de cascades et de fontaines ! »
Néanmoins il allait, pour sa jeune et jolie femme, remeubler le château vide et y installer de grands tableaux représentant ses victoires. Peut-être pour impressionner cette jeune épouse qui le trompait abondamment. Le roi Louis XV vint un jour à Vaux mais ne fit pas arrêter le maréchal trois semaines plus tard. En 1763, l’héritier du héros vendait Vaux à César-Gabriel de Choiseul-Praslin, alors ministre de la Marine, qui, après la disgrâce de son cousin Choiseul, allait y vivre son propre exil.
C’est l’un de ses descendants, le duc Théobald, qui, sous Louis-Philippe – le château avait de justesse échappé aux démolisseurs de la Terreur –, chargea Visconti de restaurer les appartements. Il n’aura pas le temps d’achever son œuvre.
Marié à Fanny Sebastiani, fille du maréchal compagnon de l’Empereur, le duc en a eu neuf enfants. Mais la naissance des deux derniers a ébranlé sérieusement la santé de la duchesse atteinte d’obésité et de varices qui ont causé deux phlébites. Le caractère corse ajouté à cela en a fait une compagne difficile et dolente. Une gouvernante a été jugée obligatoire pour s’occuper des enfants et peut-être aucun drame ne serait-il intervenu si une certaine Henriette Deluzy-Desportes n’avait fait, le 1er mars 1841, son entrée dans le somptueux hôtel du faubourg Saint-Honoré, résidence parisienne des Praslin.
De cette Henriette, le duc s’est épris avec une telle passion qu’il lui devient bientôt indispensable de se séparer de sa femme. Le 17 août 1847, après une scène terrible au cours de laquelle Théobald a vainement supplié sa femme de reprendre Henriette chassée par elle, la duchesse est assassinée dans sa chambre de trente coups de poignard. La culpabilité du mari étant évidente, le duc fut arrêté, enfermé au Luxembourg où, le 24 août, il s’empoisonnait pour éviter la guillotine. Vaux retomba au silence, presque à l’abandon jusqu’à ce qu’en 1875 Alfred Sommier, propriétaire de grandes raffineries sucrières, le rachète et lui redonne, avec le talent d’un grand mécène, son aspect d’autrefois, celui que nous pouvons désormais contempler.
Le domaine est aujourd’hui la propriété du comte Patrice de Vogüé qui le reçut en 1967 en cadeau de noces de son père, neveu d’Edme Sommier mort sans postérité.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 17 mars au 11 novembre 10 h-18 h
Château ouvert pendant les vacances de Noël.
Les samedis du 7 mai au 8 octobre, dès le soir venu, plus de 2 000 chandelles sont allumées dans l’enceinte du château et du jardin.
http://www.vaux-le-vicomte.com/
Véretz
La conversion de Monsieur de Rancé
L’homme s’agite mais Dieu le mène…
Pour qui possède quelque teinte des lettres importantes du XIXe siècle, Veretz évoque surtout la mort étrange, l’assassinat de Paul-Louis Courier qui fut peut-être l’un des plus grands pamphlétaires de tous les temps mais, à coup sûr, le plus hargneux, exploit dont on l’a récompensé par une statue qui occupe le centre de la petite ville. Mais le sort tragique du « Vigneron de la Chavonnière » n’aura de nous qu’un salut au passage. Un crime est toujours sordide et nous nous arrêterons plutôt à la dramatique histoire d’amour et de mort d’un homme qui, sans transition, comme soulevé hors de lui-même par l’effroi et l’horreur, passa d’une existence de perversion et de débauche à l’aurore d’une des plus hautes aventures humaines. Une de celles qui mènent à Dieu et qui, commencée dans le gracieux décor d’une aimable demeure, s’achève dans le dénuement du marais insalubre d’où surgira la Grande Trappe.
Un château moderne remplace, actuellement, l’antique château bâti en 1519 par Jean de La Barre qui fut, en son temps, chambellan du roi Charles VIII et appelé en ses conseils. De ce château-là il ne reste qu’une tour, ce qui est peu.
Mais, en ce soir de l’automne 1654, le château de Véretz est encore intact dans sa splendeur Renaissance cernée de terrasses et de jardins descendant jusqu’à la rivière.
C’est un soir comme les autres. Entendez par là que le propriétaire, le jeune abbé Jean-Armand Le Bouthillier de Rancé, y festoie avec ses amis exactement comme il le fait chaque fois qu’il se trouve au château. Et que l’on ne s’étonne pas ! Riche, joli garçon, amoureux et adulé dans les meilleurs salons de Paris et de Touraine, Jean-Armand est l’un de ces abbés « pour rire », totalement dépourvus de vocation, comme il en fleurissait tant autrefois dans les grandes familles. En fait, il est abbé parce qu’il perçoit les bénéfices de riches prébendes ecclésiastiques mais sa vie, toute mondaine, est vouée bien moins à Dieu qu’à l’amour. Un amour véritablement passionné : celui qu’il porte depuis des années à l’une des plus belles femmes du royaume : Marie de Bretagne, duchesse de Montbazon, dont le puissant château n’est pas éloigné de Véretz et auprès de laquelle il se rend lorsqu’elle séjourne à Montbazon.
Ce n’est pas le cas à cette époque. Marie est à Paris où elle mène, il faut bien le dire, une vie parfaitement dissolue pour oublier que la Fronde dont elle était l’une des reines a fait chou blanc et qu’à présent Louis XIV, sacré à Reims le 7 juin précédent, règne en maître absolu.
Ce soir-là, donc, Jean-Armand vient d’entamer, après souper, une partie d’échecs avec l’un de ses amis quand, soudain, il est pris d’un malaise étrange. Une sorte de froid comme si, en lui, quelque chose était en train de s’éteindre. Ses doigts tremblants ont laissé échapper la reine d’ivoire qui roule sur l’échiquier tandis qu’il se lève et passe sur son front couvert de sueur une main glacée…
Balbutiant une excuse à l’adresse de ses invités, il court aux écuries, fait seller son meilleur cheval et, comme un fou, à peine enveloppé d’un manteau, il se lance sur la route de Paris. Dans le vent de la course il croit entendre encore la voix désespérée de Marie qui l’appelle. Car elle l’a appelé. Il l’a entendue au moment où il prenait la reine d’ivoire. Et il l’entend encore. Et pour lui cela ne peut signifier qu’une chose : Marie est en péril, Marie a besoin de lui…
Franchies les portes de Paris, il court encore jusqu’à la rue de Béthisy où se trouve l’hôtel de Montbazon. C’est une fastueuse demeure mais le jeune homme ne l’aime pas parce que l’histoire d’un crime s’y rattache : c’est là qu’au soir de la Saint-Barthélemy, l’amiral de Coligny a été assassiné. Ce soir, elle lui paraît plus sinistre encore que d’habitude. Les portes, pourtant, sont ouvertes. Dans la fièvre née de son épuisement, Rancé aperçoit de vagues formes de serviteurs. Où est la duchesse ? Dans sa chambre. Cette chambre qu’il connaît si bien. Et il court encore. Et il pousse la porte de bois précieux. Et là, il tombe à genoux, le cœur arrêté devant l’horreur qui s’offre à ses regards…
En face de lui, il y a un cercueil ouvert encadré de cierges de cire jaune. Un cercueil contenant un corps sans tête. Le corps de Marie… décapité ! La tête, cette tête adorable dont les lèvres lui étaient si douces, est posée à côté… sur un coussin. Jamais cauchemar fut-il plus affreux ? Un instant… un long instant, le jeune abbé doute de sa raison, se croit en train de devenir fou…

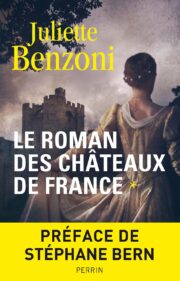
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.