Il eut la gloire d’y recevoir le roi Louis XVI en route pour Cherbourg où celui-ci voulait examiner les importants travaux du port. On y construisait alors une digue gigantesque dont les fondations se composaient d’énormes cônes de bois et de fer que l’on immergeait en les remplissant de pierres. Toutes choses qui passionnaient un souverain très attaché à la marine et lui permirent peut-être d’oublier un instant qu’au même moment le parlement de Paris jugeait les protagonistes de la malheureuse « affaire du collier de la reine » qui allait ébranler son trône…
Pendant la Révolution, le duc de Beuvron et sa famille durent quitter la Normandie en raison des troubles. En 1795, une bande de vandales fit irruption dans le château où elle commit les pires dégâts en pillant et saccageant les meubles, les objets d’art, les tentures, sans oublier la cave !
Mais les Harcourt-Harcourt ? me direz-vous. Où étaient-ils implantés puisque l’on ne voit ici que la branche cadette ? Assez loin ! En plein Calvados et à peu près à mi-chemin entre Caen et Condé-sur-Noireau, les ducs avaient construit un château à Thury-Harcourt d’une dimension respectable qu’un incendie détruisit complètement en 1944. N’en subsiste que le charmant « Pavillon de Fantaisie » reconstruit par le dernier duc…
Le Champ de Bataille, lui, était toujours debout. Après son dépouillement, les enfants du duc de Beuvron le vendirent au comte de Vieuxpont auquel succédèrent en 1850 M. et Mme Prieur, puis un Anglais, M. W. Consette. En 1903, le comte d’Harcourt, descendant du duc de Beuvron, acquit ce qui restait du domaine puis le vendit à la ville de Neubourg voisine qui le transforma en hospice avant de servir de prison à la Libération puis d’être simplement abandonné.
Le duc d’Harcourt – le dixième ! – put alors le racheter grâce aux dommages de guerre versés par le ministère de la Reconstruction et celui des Beaux-Arts. Il put ainsi le remettre en état. N’était-il pas enfin devenu la demeure du chef de nom et d’armes des Harcourt ?
C’est là que le 2 juillet 1966 le duc put célébrer le « premier millénaire » devant 120 Harcourt, français et anglais, qui avaient répondu à son invitation. Ils seront accueillis, rapporte le cher Arnaud Chaffanjon, par la « jeune duchesse souriante et brune dans sa robe rose et avec tout son charme ; fille d’une Harcourt et descendante de Madame de Sévigné, elle avait tous les atouts en mains pour faire revivre les heures du Grand Siècle ».
La mort de son époux s’y opposa. Pendant vingt ans le château fut entretenu par un particulier qui créa l’actuel golf dans les bois tandis que s’y déroulaient des spectacles « Sons et Lumières » ainsi que de nombreux concours d’attelages… Jusqu’à ce qu’en 1992 le célèbre décorateur Jacques Garcia l’achète « par amour » et lui consacre sans compter son temps, son talent et sa fortune. Le résultat est fabuleux : les immenses jardins à la Le Nôtre n’ont jamais été aussi magnifiques et le château remeublé en authentique renferme à nouveau des collections d’œuvres d’art tout comme autrefois.
Un certain exotisme y parle de terres lointaines qui ne devraient pas déplaire aux ombres de ces Harcourt qui portèrent le titre prestigieux d’Amiral de France, ni à celle de Louis XVI qui y dormit une nuit et qui, au pied même de l’échafaud et les mains liées dans le dos, demandait :
— A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ?
HORAIRES D’OUVERTURE DES GRANDS APPARTEMENTS
De Pâques à la Toussaint les week-ends et jours fériés de 15 h 30 à 17 h 30 Juillet et août tous les jours de 15 h 30 à 17 h 30
HORAIRES D’OUVERTURE DES JARDINS
De Pâques à la Toussaint les week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h Mai, juin et septembre tous les jours de 14 h à 18 h
Juillet et août
tous les jours
de 10 h à 18 h
À ne pas manquer : les nouveaux jardins réalisés par Patrick Pottier.
http://www.duchampdebataille.com/
Châteaubriant
La belle que voilà !
L’âme est en haut ; du beau corps c’en est fait
Icy dessous
Ah ! Triste pierre auras-tu cette audace
De m’empêcher cette tant belle face
En me rendant malheureux et défait
Car tant digne œuvre en rien n’avait méfait
Qu’on l’enferma avec sa bonne grâce
Icy dessous
La musique des vers qui traverse l’esprit du roi a peu à peu chassé la prière dans laquelle il s’est abîmé durant de longues minutes, les yeux brouillés par le brasillement des cierges. Dieu, soudain, s’éloigne, repoussé par les souvenirs de l’ancien amour. De si beaux, si tendres et si ardents souvenirs ! Les irremplaçables, inoubliables souvenirs des folles amours de la jeunesse…
François Ier se relève et époussette machinalement ses genoux glacés par la pierre froide de la chapelle. Ce printemps breton est pénible. Ou bien, le roi est-il si vieux qu’il ne sait plus, l’âge venant, supporter les petites misères d’un climat différent ? Pourtant il ne parvient pas à s’écarter de ce tombeau pour retrouver les bruits de la vie et sa chaleur. Il y a ces mots fraîchement gravés sur la pierre, ces mots qui le retiennent encore : « Icy repose, dans la paix du Seigneur, Très Haute et Très Noble Dame Françoise de Foix. »
Françoise ! Dieu, ce grand artiste, a-t-il jamais créé femme plus belle, plus gracieuse, plus passionnée aussi ? Après un quart de siècle écoulé, François Ier retrouve intactes les premières impressions de ce temps béni où tout, autour de lui, n’était que jeunesse : le règne, la cour, les hommes, les femmes… la France qui s’était donnée d’un si bel élan mais surtout lui-même. Et comme ils s’étaient aimés, tous les deux !
Tout avait commencé bien peu de temps après le double coup de tonnerre de 1515 : l’avènement et, six mois plus tard, le soleil de Marignan qui a porté au pinacle un jeune géant fougueux, un roi de vingt et un ans. François aimait – avec quelle violence ! – la chasse, la guerre, les arts, l’amour. L’amour plus que tout le reste peut-être. Et il a voulu que sa cour fût un parterre de jeunes et jolies femmes :
« Une cour sans femmes est une année sans printemps ou un printemps sans roses ! » aimait-il à répéter.
Il en vint beaucoup. Pourtant, de l’avis de son ami Odet de Foix, vicomte de Lautrec, il manquait la plus belle : sa propre sœur Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant par mariage avec le seigneur du lieu, Jean de Laval, de haute et fière noblesse bretonne. Un mariage qui avait été mariage d’amour – Françoise pourtant n’avait alors que douze ans – et durait sans accroc depuis dix ans. Mais le roi a voulu « voir toutes ses dames » et surtout la sœur de son ami, cette belle et fière Françoise dont on lui disait qu’aucune, française ou italienne, n’approchait la beauté brune. Il l’invita avec son époux. Méfiant, celui-ci vint seul, mais bientôt se trouva acculé par une de ces conspirations de cour où se perdent honneur et réputation. Françoise arriva. Le roi la vit et se prit pour elle d’une passion qui devait être la plus ardente de toute sa vie. Semblable à celle qu’il sut éveiller chez une femme qui se croyait jusqu’alors amoureuse de son époux. Pourtant, la résistance fut longue : trois ans. Trois ans à lutter contre lui, contre elle-même. Il fallut l’échec de François à l’élection impériale pour que Françoise se rendît d’elle-même, royale consolation. Et durant sept années, elle va régner sur son roi. Amour de chair mais aussi amour d’esprit car tous deux adoraient la poésie et jamais on ne fit à la cour si folle consommation de vers. Amour de pierre enfin : c’est pour sa belle amie, pour lui donner le cadre digne de sa beauté que le roi tira d’un marais une merveille et fit surgir Chambord au cœur d’une forêt. Autre cadre prestigieux : le camp du Drap d’or dont elle sera le plus bel ornement.
Pendant ce temps, le mari guerroie, mais comme il n’est d’expédition guerrière qui ne prenne fin, le roi, pour l’empêcher de venir à la traverse de ses amours, l’a nommé gouverneur de Bretagne, ce qui l’oblige à résider sur place. Jean de Laval ronge son frein car il n’a jamais cessé d’aimer sa femme et la jalousie le ronge. Mais que faire contre un roi ? Attendre ? Il attend…
Un jour, Mme de Châteaubriant rentre au bercail. Les heures noires sont venues avec le désastre de Pavie en 1525 : François Ier est prisonnier à Madrid et la régence est aux mains de sa mère, Louise de Savoie, qui exècre la favorite. Celle-ci n’a plus qu’à rentrer chez elle pour attendre elle aussi.
Quand le roi recouvre la liberté, quand la cour se rend à Bayonne pour l’accueillir, Françoise n’est pas là. Louise de Savoie non seulement ne l’a point fait prévenir mais encore présente à son fils une jeune fille toute rose, toute blonde, toute fraîche, tout exquise : Anne de Pisseleu, qui va l’asservir d’un regard et dont il fera bientôt une duchesse d’Étampes. Quand Mme de Châteaubriant apprend enfin son malheur, quand elle accourt, il est trop tard.
Bien sûr, durant quelque temps, le roi maintient la balance égale entre les deux rivales mais peu à peu le fléau penche vers la plus jeune. Et Françoise de se plaindre, toujours en vers :
Mais qui eût su penser pouvoir trouver au miel
Tant de mortel venin, d’amertume et de fiel ?
Elle est vaincue et elle le sait. Même Chambord est abandonné pour reconstruire un Fontainebleau éclatant. Elle part, elle rentre en Bretagne où l’accueillent son époux et un vaste chantier : auprès des ruines de la vieille forteresse féodale qui avait abrité tous les seigneurs de Châteaubriant passés – celui qui combattit à Mansourah, celui qui combattit à Saint-Aubin-du-Cormier, celui qui défendit sa fille veuve d’un Plantagenêt, tous ceux enfin qui firent que les lys de France s’inscrivaient sur leur bannière –, auprès de cette bastille grandiose qui va peu à peu devenir une superbe ruine, Jean de Laval construit, de 1532 à 1537, le palais Renaissance que l’on peut encore admirer et trace des jardins. Françoise, dont la douleur a vaincu son ressentiment, pourra y rêver aux jours si doux d’autrefois. Pour sa part, Jean espère que le temps leur permettra d’oublier tout cela.

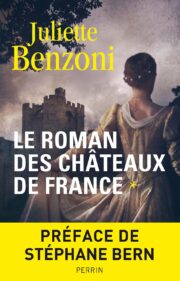
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.