Pour mettre son héritière à l’abri, M. Ponsardin la confie à une brave femme toute dévouée à la famille et qui est couturière. Nicole, habillée en petite fille pauvre, vivra chez elle tant que durera le cauchemar dont les siens, connus comme des gens de bien, se tireront sans mal… Et elle a depuis plusieurs années – ayant alors vingt-deux ans – regagné l’hôtel de la rue Cérès quand on décide de la marier. On décide mais elle est d’accord, car elle aime depuis longtemps François Clicquot qui possède des vignes et constitue l’un des plus beaux partis de la ville. C’est donc un vrai mariage d’amour, car Nicole est charmante, mais aussi un mariage curieux. Seule l’union civile est en usage et Nicole, à la mairie, se conforme à la coutume locale qui veut qu’une femme ajoute son nom de jeune fille à celui de son mari. Mais dès l’instant où l’on prétend faire bénir une union, surtout par un prêtre « non jureur », mieux vaut se cacher.
C’est ainsi que le mariage de Nicole et de François va se dérouler… dans une cave. Et là se produit le miracle : après la bénédiction nuptiale, le vieux prêtre qui officie remet à François un rouleau de papier jauni que lui et sa jeune femme vont dérouler avec émotion. Il a pour titre « Mémoire sur la manière de choisir des plants de vigne convenables au sol, sur la façon de les provigner, de les tailler, de mélanger les raisins, d’en faire la cueillette et de gouverner les vins. » En fait, ce n’est rien d’autre que l’un des très rares exemplaires de la manière de fabriquer le champagne selon la méthode de Dom Pérignon, le moine génial de l’abbaye d’Hautvillers.
Les jeunes époux se mettent tout de suite à la tâche et s’installent à Bouzy pour surveiller vignes et récoltes. En même temps, François, qui s’est mis à voyager pour trouver des clients, rencontre à Bâle un « petit homme tout rond, jovial et affable », M. Bohne, sans doute le meilleur voyageur de commerce d’Europe, qui met son talent au service de la maison : il vend à tout le monde, Allemands, Russes, Anglais… Mais, en 1805, c’est la double catastrophe : François, le cher François meurt d’une fièvre maligne, laissant Nicole veuve avec une petite fille. En outre, la guerre reprend avec l’Angleterre, fermant ainsi l’un des grands débouchés du champagne.
Le père Clicquot se laisse aller au désespoir et prétend, puisqu’il n’a plus d’héritier, vendre les vignes et les caves. C’est alors que Nicole montre sa vraie nature. Elle s’oppose formellement à la vente, déclare qu’elle entend honorer la mémoire de son époux en poursuivant sa tâche et, quatre mois après la mort de François, celle qu’on appellera désormais la Veuve crée sa propre maison en compagnie d’un associé. C’est la Maison Veuve Clicquot-Ponsardin, Fourneaux et Cie. Et rien ne l’abattra.
Napoléon porte la guerre à travers toute l’Europe ? Parfait ! Il sera sans le savoir et par le truchement de son armée le premier commis voyageur de la maison, sous les ordres de M. Bohne. Le Blocus continental empêche les bateaux français d’exporter le fameux champagne ? Ça s’arrangera ! Nicole, en effet, passe contrat avec des corsaires américains et son champagne va courir les mers sous la protection de la bannière étoilée. Les problèmes, bien sûr, ne manquent pas. Les commandes sont nombreuses, pressées, et peuvent nuire à la qualité du vin. En effet, il se forme dans les bouteilles un dépôt qu’il faut un certain temps pour expulser. Comment faire pour l’enlever rapidement ? Installée dans sa maison d’Ogeron, Nicole passe des nuits sans sommeil à conférer avec son maître de chais Jacob. Et, une nuit, elle trouve la solution, descend quatre à quatre à la cave : ce qu’il faut c’est percer des trous dans de longues et larges planches et y installer les bouteilles la tête en bas. Ainsi pourra-t-on faire partir le dépôt sans perdre trop du précieux vin…
Et le temps passe, l’Empire passe. Nicole a fait élever sa petite Clémentine à Paris, au couvent des Anglaises, d’où elle la tire en 1817, au grand déplaisir de la jeune fille qui s’ennuie à périr en province. « Pleure pas, Mantine, lui dit sa mère pour la consoler, je t’achèterai de l’esprit quand je te marierai… » Et elle tient parole car il se trouve justement parmi les soupirants de Clémentine un beau garçon sans aucune fortune mais plein d’esprit : le comte Louis de Chevigné, dont le père a été tué aux côtés de M. de Charette dans les guerres vendéennes.
Louis séduit la jeune fille mais, comme il a commencé par plaire à sa future belle-mère, le mariage a lieu dans la joie et les fêtes. On sait à présent comment la Veuve célébra la naissance de sa petite-fille en achetant le château de Boursault.
Louis aime beaucoup « Mère chérie » qui vit pratiquement au château mais il est un peu brouillon et, abusant de son influence, manque d’entraîner la maison dans des affaires désastreuses. Heureusement, Nicole a désormais auprès d’elle un assistant de grande valeur qui veille au grain. M. Édouard Werlé évitera de justesse quelques catastrophes dues au génie inventif de Louis et, avec l’aide de sa patronne, finira par l’aiguiller sur un chemin sans danger : la politique. Édouard Werlé deviendra l’associé de la Veuve.
En 1848, nouveau mariage à Boursault : celui de la seconde Marie-Clémentine, fille de la première, avec le comte de Mortemart. Et, pour la circonstance, la Veuve fait des folies : à côté du vieux château médiéval, s’élève maintenant un superbe château Renaissance. Le mariage sera un triomphe où se presseront les plus grands noms de France.
La vie à Boursault est fastueuse. On y donne des fêtes, des chasses, et seul le champagne maison y a droit de cité : « Madame Clicquot, par un despotisme concevable, n’admettait que ses champagnes à sa table. Paraphrasant Louis XIV, elle aimait à répéter : le Vin c’est moi… Effectivement, il n’y avait pas une goutte de vin rouge sur la nappe », écrit Charles Monselet qui fut reçu au château.
Une des nièces de la Grande Dame a laissé un récit imagé de la vie à Boursault, vue du côté des petites filles : « Vers douze ans, à l’âge où il est encore permis de regarder sans rien dire, je me retrouve en robe de mousseline rose dans le coin de l’immense salon. Tout y était froid comme dans les appartements de Versailles. On avait l’impression d’y être perdue : dans la salle à manger de proportions gigantesques également, la cheminée, aussi haute que celle du salon servait de piédestal à une statue de Diane grandeur nature. Ma cousine Anne de Mortemart et moi – Judith d’Anglemont de Tassigny – accompagnées de notre bonne Victoire, nous nous échappions dans le parc dès le matin… »
Comme on peut le voir, les grands noms de la noblesse étaient entrés dans la famille de Nicole. Elle devait être l’aïeule d’une série de grandes dames dont la moindre ne fut pas la duchesse d’Uzès. Le sang bleu et les joyeuses bulles du champagne se mélangèrent superbement.
Brissac
Grands seigneurs, grandes amours… et une dame blanche
Le chemin de l’amour est pavé de chair et de sang.
Vous qui passez par là, relevez le pan de vos robes !
« C’est un château neuf à demi construit dans un château vieux à demi détruit », a dit un jour le duc de Brissac en évoquant son grand château des bords de Loire. En fait, s’il ne manque ni d’allure ni de majesté, Brissac n’en offre pas moins une image inhabituelle : celle d’une sorte de donjon que l’on aurait construit dans le plus pur style Louis XIII coincé entre des tours essentiellement médiévales. Cela donne cinq étages de hautes fenêtres, de chaînages de pierre, de frontons et de pilastres appartenant à des ordres divers. Mais ce sont cinq étages de grandeur sur lesquels a coulé l’histoire de France car cette demeure fut, de tout temps, celle de grands serviteurs du royaume, de ces serviteurs que l’on ne saurait contester.
Comme beaucoup de châteaux en pays angevin, Brissac fut à l’origine l’un de ces énormes quadrilatères de pierre comme aimait à en construire le Faucon noir, le redoutable comte d’Anjou. Évidemment, il ne reste rien en surface de cette première forteresse sinon peut-être quelques pierres qui eurent l’honneur de voir passer le roi Philippe Auguste au jour de l’Ascension de l’an 1200.
Il faut attendre le XVe siècle pour voir monter dans le ciel angevin les grosses tours de Brissac. À cette époque – en 1434 – le roi Charles VII, enfin maître chez lui et pratiquement débarrassé des Anglais, s’est donné pour ministre un homme qui représente à lui seul la chevalerie dans ce qu’elle eut de plus achevé, Pierre de Brézé.
Pour l’avoir rencontré plus d’une fois au détour de l’Histoire, j’avoue un faible pour cet homme exceptionnel, pour cette absolue réussite de la création. Rarement, en effet, on a vu autant de hautes qualités réunies en un seul homme. Pierre de Brézé fut un guerrier redoutable, un véritable preux, un ministre intelligent et avisé, un grand seigneur achevé. En outre, il portait le cœur le plus noble sous l’apparence la plus séduisante, la plus prestigieuse qui soit. C’était une assez bonne incarnation de Lancelot du Lac. Et pour que la ressemblance soit plus complète, ajoutons que Pierre de Brézé ne vécut que pour l’amour d’une femme mais que cette femme était reine d’Angleterre.
Elle est bien jeune la petite Marguerite d’Anjou, nièce de Charles VII, quand le 23 mai 1445 – il y a alors onze ans que Brézé a acheté la terre de Brissac – les cloches de Saint-Martin de Tours sonnent ses fiançailles avec le jeune roi d’Angleterre Henri VI ; mais sa beauté est déjà célèbre. Les mots sont impuissants d’ailleurs à traduire l’éblouissement de ceux qui eurent le privilège de contempler cette enfant de quinze ans qui joignait la grâce et l’élégance à un éclat exceptionnel.

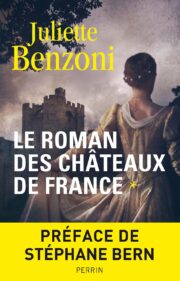
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.