— Ah ! fit-il. Elle est arrivée ! C’est donc pour ce soir…
— Si cela ne vous dérange pas trop, monsieur le recteur. Vous savez depuis longtemps quelle hâte est la mienne…
— Alors, venez avec moi, dit-il après avoir pressé la main de Sylvie d’un geste doux et réconfortant.
En dépit de l’étrange émotion qui s’emparait d’elle, Sylvie voulut parler mais François mit un doigt sur sa bouche :
— Chut !… Pour l’instant tu dois te taire.
Derrière le vieil homme, ils gagnèrent l’église dont celui-ci ouvrit la porte simplement maintenue par un loquet. Il les fit entrer puis referma soigneusement en se servant cette fois d’une lourde clef. Tous trois se retrouvèrent dans une obscurité à peine troublée par la veilleuse rouge allumée devant le tabernacle.
— Ne bougez pas ! Je vais allumer les cierges.
Il en alluma deux sur l’autel puis fit signe à ses visiteurs de le rejoindre après avoir passé à son cou l’étole rituelle :
— Je vais, à présent, vous entendre en confession, madame. Ensuite j’entendrai… votre compagnon.
Comprenant que cette histoire de confession évoquée tout à l’heure en plaisanterie était sérieuse, Sylvie demanda :
— Mais… pourquoi ?
— Parce que je ne peux vous marier si vous n’êtes pas en paix avec le Seigneur, ma fille. J’espère que vous n’y voyez pas d’empêchement ?
— Nous marier ?… Mais, François…
— Chut ! Ce n’est pas à moi qu’il faut parler. Va, mon cœur… Et n’oublie pas que le secret en est inviolable pour un prêtre ! Et je connais celui-là…
Après la confession la plus incohérente de toute sa vie, Sylvie se retrouva devant l’autel au côté de François qui la regardait en souriant…
— Allons-nous vraiment faire cela ? souffla-t-elle. Tu sais bien que c’est impossible. Le… baron d’Areines n’existe pas…
— Qui parle ici du baron d’Areines ? Sache que j’ai promis à ton fils de t’épouser durant notre long voyage jusqu’ici.
— Est-ce qu’il sait ? fit-elle avec effroi.
— Non. Il sait seulement que j’aime sa mère depuis longtemps. Il sait aussi qu’il n’aura jamais honte de notre étrange situation.
Le prêtre revenait avec un petit plateau sur lequel reposaient deux modestes anneaux d’argent. Il fit agenouiller les futurs époux devant lui et joignit leurs mains tandis que, les yeux au ciel, il invoquait le Seigneur. Puis ce fut le moment de l’engagement et Sylvie, avec une sorte de terreur sacrée, l’entendit prononcer ce qu’elle ne croyait plus possible d’entendre.
— François de Bourbon-Vendôme, duc de Beaufort, prince de Martigues, amiral de France, acceptez-vous de prendre pour épouse très haute et noble dame Sylvie de Valaines de l’Isle, duchesse douairière de Fontsomme, et jurez-vous de l’aimer, de la garder en votre logis, de la défendre et de la protéger pour le temps qu’il plaira à Dieu de vous accorder sur cette terre ?
— … et au-delà ! ajouta François avant d’articuler fermement : « Je le jure ! »
Comme dans un rêve, Sylvie, que l’émotion étranglait, s’entendit prononcer le même serment. Le prêtre bénit les anneaux avant de les leur donner ; il couvrit leurs mains jointes d’un pan de son étole et prononça enfin les paroles qui les unissaient devant Dieu et devant les hommes. François, alors, salua profondément celle qui devenait sa femme.
— Je suis l’humble serviteur de Votre Altesse Royale, dit-il gravement. Et aussi le plus heureux des hommes !
Appuyés l’un contre l’autre, le duc et la duchesse de Beaufort sortirent de l’église et la nuit tiède les enveloppa de sa splendeur étoilée qui leur offrait, tandis qu’ils revenaient lentement à travers la lande solitaire, une cour plus brillante et plus majestueuse que ne l’eût jamais été celle de Saint-Germain, de Fontainebleau ou même de ce Versailles encore inachevé dont la magnificence étonnerait le monde. Belle-Isle leur offrait ses senteurs nocturnes de pin, de genêt et de menthe sauvage, cependant que la grande voix de l’océan chantait, mieux que les orgues, la gloire de Dieu et l’union de deux êtres qui s’étaient si longtemps cherchés…
Oubliés du monde et voués à une éternelle clandestinité, François et Sylvie allaient vivre leur amour avec intensité, modestement mêlés au petit peuple des pêcheurs et des paysans qui ne chercherait jamais à percer un mystère qu’il sentait pourtant de façon confuse. Il les aima surtout quand vint, en 1674, l’épreuve d’une meurtrière descente hollandaise menée par l’amiral Tromp dont les vaisseaux, comme jadis ceux des Normands, parurent un matin devant la plage des Grands Sables. Les hommes passèrent sur l’île comme un vent de malheur, pillant et brûlant, sans que la vieille citadelle des Gondi – à peu près vide –, que Fouquet voulait faire si forte, pût grand-chose pour sa défense. François et Sylvie, dont la maison au fond de la crique fut épargnée, accomplirent des prodiges pour aider, soulager et soutenir ceux que le fléau atteignait. Ensuite pour les aider à réparer. Dès lors, Belle-Isle meurtrie se referma vraiment sur eux et leur amour s’en trouva exalté.
Ce bonheur si bien caché allait durer quinze ans…
ÉPILOGUE
Sylvie mourut le 22 juin 1687. Ou, plutôt, elle cessa de vivre car la mort la prit doucement sans qu’aucun signe avant-coureur eût laissé présager sa venue. C’était la fin d’une belle journée. Assise auprès de François, sur le banc de pierre adossé à leur maison, elle contemplait avec lui la mer incendiée par le plus glorieux des couchers de soleil quand sa tête se posa sur l’épaule de son époux comme elle le faisait souvent, avec un soupir heureux… qui fut le dernier.
On l’enterra sous la bruyère, à l’ombre d’une croix de granit plantée près de l’église où elle s’était mariée. Accablé par le chagrin, François, alors, entra dans un silence que troubla à peine la venue d’une lettre comme il en arrivait parfois du continent. Après l’avoir lue, il prépara un petit bagage, monta dans sa barque à la marée du soir, comme s’il allait pêcher, et gagna la terre ferme où il abandonna le bateau. Belle-Isle ne le revit plus…
La lettre était de Philippe de Fontsomme, à présent marié et père de deux garçons. Lorsque le chevalier de Raguenel s’était éteint trois ans plus tôt, dans sa maison de la rue des Tournelles en revenant de sa dernière visite aux exilés – il faisait le voyage de Bretagne environ une année sur deux –, Philippe avait fait savoir à Saint-Mars qu’il prenait le relais des nouvelles. On sut ainsi qu’après la mort de Fouquet survenue en 1680 et le retour en grâce de Lauzun, un an plus tard, le geôlier et son prisonnier avaient quitté Pignerol pour un autre château-prison. Cette fois, le message de Philippe annonçait que Saint-Mars venait d’être nommé gouverneur de l’île Sainte-Marguerite, l’une des îles de Lérins situées en Méditerranée, face à un village de pêcheurs nommé Cannes. Le prisonnier masqué l’avait suivi dans une chaise fermée, couverte de toile cirée et accompagnée d’une forte escorte.
François connaissait bien ces îles constituant des places fortes au large des côtes de Provence. Il savait que, dans Saint-Honorat, la plus petite et la plus éloignée, subsistait une poignée de moines têtus, souvent en butte depuis des siècles aux coups d’ennemis variés venus de la mer, dont les protégeait tant bien que mal une série d’écueils et d’anciennes fortifications…
Quelques semaines après le départ de Belle-Isle, le père abbé de Saint-Honorat prenait place dans une barque menée à la rame par l’un de ses moines dont le capuchon ne laissait voir que la barbe grise et gagnait Sainte-Marguerite, pour demander au gouverneur une entrevue au moyen d’une lettre que porta une sentinelle. Le jour était magnifique, la Méditerranée d’un bleu si intense qu’il pâlissait le ciel, mais le soleil d’été faisait étinceler les baïonnettes des gardes et luire les gueules massives des canons sur les chemins de ronde. Jamais prisonnier n’avait été mieux gardé.
Pourtant, lorsque les deux religieux quittèrent l’île-prison, un observateur scrupuleux eût noté que la barbe du moine rameur était peut-être un peu moins claire et un peu moins fournie. Cette nuit-là, M. de Saint-Mars dormit mieux qu’il ne l’avait fait depuis toutes ces années : le visage que recouvrait le masque était bien celui auquel on l’avait destiné. Pierre de Ganseville, heureux de respirer le même air que son prince, ne quitta plus Saint-Honorat.
Il vivait encore lorsque, en 1698, Saint-Mars reçut la récompense de ses longs et loyaux services : il devenait gouverneur de la Bastille, la reine des prisons d’État, celle qui rapportait le plus. Mais s’il avait accumulé une énorme fortune, l’éternel geôlier de l’homme au masque n’en profitait guère. Il ne connaissait même pas les terres bourguignonnes qui devenaient siennes et ne passa une nuit dans son château de Palteau qu’à l’occasion de la remontée vers Paris où, bien entendu, il ramenait un prisonnier auquel il était lié comme un forçat à sa chaîne. Ceux qui aperçurent, alors, le mystérieux captif admirèrent sa haute stature, l’élégance de son allure dans ses vêtements de velours noir, la barbe blanche, longue et soyeuse, qui semblait couler du masque.
Cinq ans plus tard, le lundi 19 novembre 1703, l’homme à qui l’on avait ôté jusqu’à son visage mourait à la Bastille. Le lendemain, on portait son corps au cimetière Saint-Paul comme il était d’usage pour ceux qui décédaient dans la vieille prison. Il était quatre heures de l’après-midi et, sur le registre des Jésuites qui avaient en garde le champ des morts, on écrivit un nom parce qu’il fallait en écrire un, et ce nom était : Marchiali[87].
Quelques nuits plus tard, des inconnus vinrent ouvrir la tombe, mais ils n’y trouvèrent qu’un corps sans tête : elle avait été coupée et remplacée par une grosse pierre, ronde comme un boulet de canon…

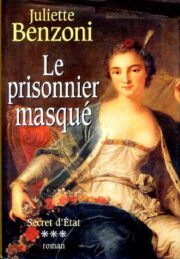
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.