Sur ces entrefaites, le jeune Rancé, ayant appris son accident et sa maladie, accourut de Touraine pour lui porter le réconfort de son amour. Épuisé par la longue route à cheval, il arriva au soir tombant rue de Bethisy où se trouvait l’hôtel de Montbazon. Une demeure qu’il n’aimait pas parce que, à la Saint-Barthélémy, on y avait assassiné l’amiral de Coligny. Elle lui parut plus sinistre encore que de coutume.
Pourtant les portes sont ouvertes. Dans la fièvre née de sa fatigue, Rancé aperçoit de vagues formes de serviteurs. Où est la duchesse ? Dans sa chambre, cette chambre qui parfois lui a été si douce. Il court, pousse la porte et aussitôt tombe à genoux, le cœur arrêté devant l’horreur du spectacle. Il y a là un cercueil ouvert éclairé par de grands cierges de cire jaune. Un cercueil contenant un corps sans tête : le corps de Marie ! La tête aux yeux clos repose à côté, sur un coussin. Jamais cauchemar fut-il plus affreux ? Un moment, un long moment, le malheureux s’est cru en train de devenir fou.
Mais il n’est pas fou, pas plus qu’il ne rêve, et à cette horreur existe une explication affreuse mais tellement simple : lorsque l’ébéniste livra le cercueil de bois précieux, on s’aperçut qu’il était trop court : l’homme de l’art n’avait pas tenu compte de la gracieuse longueur du cou. Donc, pour ne pas refaire un meuble si onéreux, le chirurgien-barbier de la maison coupa tout simplement la tête.
Ce fut un autre homme qui sortit, ce soir-là, de l’hôtel de Montbazon. L’abbé de cour venait de mourir, pour laisser place à un prêtre poursuivi par le remords et la honte de sa vie passée. Il repartit pour la Touraine, vendit ses biens, ne conservant que la plus misérable de ses abbayes, quelques bâtiments en ruine érigés sur des fonds marécageux dont, avec le temps, il allait faire le plus sévère, le plus rude des monastères français : Notre-Dame-de-la-Trappe…
Cette affreuse histoire, Sylvie l’apprit de la duchesse de Vendôme. Celle-ci la tenait de son fils François que Rancé, sur le chemin du repentir, était allé visiter à Chenonceau. La famille portait alors le deuil de la jeune duchesse de Mercœur mais celui de Beaufort fut deux fois plus sévère et, au fond de son cœur, Sylvie l’en aima mieux sans même s’en rendre compte. De toute sa jalousie, elle avait détesté Marie de Montbazon parce qu’elle avait pu mesurer la profondeur et la sincérité de son amour pour François, mais il lui eût déplu que celui-ci n’eût pas salué d’un vrai chagrin une liaison de quinze ans…
Cependant, elle-même souhaitait l’oublier le plus vite possible.
CHAPITRE 2
LE CHOCOLAT DU MARÉCHAL DE GRAMONT
Se loger à Saint-Jean-de-Luz alors que la maison du Roi, celle de sa mère, celle du cardinal Mazarin plus une partie de la Cour s’étaient abattues sur la vigoureuse petite cité maritime représentait une sorte d’exploit. Cependant, Sylvie et Perceval ne rencontrèrent pas la moindre difficulté, grâce toujours à Nicolas Fouquet. Dès qu’il sut que ses amis devaient assister au mariage royal, le tout-puissant Surintendant envoya un courrier à son ami Etcheverry, l’un des armateurs baleiniers du port. Leurs relations s’étaient nouées à l’automne précédent lorsque Fouquet, averti de ce que Colbert concoctait contre sa gestion un mémoire meurtrier destiné à Mazarin, en avait appris la teneur grâce à son ami Gourville, s’était alors jeté sur les routes pour rejoindre le Cardinal à l’autre bout de la France et prendre le contre-pied du fameux mémoire en gagnant Colbert de vitesse. Depuis le début de l’été, en effet, Mazarin était à Saint-Jean-de-Luz pour discuter avec l’envoyé espagnol, don Luis de Haro, les clauses du traité des Pyrénées et préparer le mariage royal qui en serait le couronnement. Fouquet relevait de maladie, aussi Mazarin, de plus en plus délabré, apprécia-t-il le courage du Surintendant en homme qui sait ce que forcer un corps épuisé veut dire : le mémoire tomba à l’eau. Mais, pendant ce séjour où il jouait sa vie, Fouquet apprécia à sa juste valeur l’hospitalité de la maison Etcheverry[53] et le caractère à la fois fier et joyeux de ses habitants.
En quittant Paris, Sylvie et Perceval étaient assurés qu’un appartement les attendait et qu’aucun prince ou courtisan si riche soit-il ne pourrait les en priver.
— Cela plaide en faveur d’une grande force de caractère chez notre futur hôte, remarqua le chevalier de Raguenel. La ville doit être prise d’assaut par tous ceux qu’un campement sur la plage ne tente guère. Il est vrai que lorsque l’on connaît la générosité de Fouquet !
Le voyage par un temps radieux enchanta Sylvie qui n’avait jamais parcouru d’autres routes que celles menant aux terres de Vendôme, celles de Picardie et celle de Belle-Isle. En outre, la solitude n’y était pas à craindre : on aurait dit que tout ce que le royaume comptait d’un peu illustre ou de fortuné se déversait en direction de la côte basque. Au point même que les terres les plus inhospitalières comme les landes sablonneuses et marécageuses au sud de Bordeaux ne présentaient plus de danger : des caravanes de carrosses et de cavaliers se formaient tout naturellement. On voyagea même un jour avec une troupe de pèlerins en route pour Compostelle de Galice où ils s’en allaient prier au tombeau de saint Jacques. C’était avant la traversée d’une épaisse forêt et cette poignée de braves gens – les temps de grands pèlerinages étaient révolus ! – demandèrent à profiter de la protection représentée par plusieurs voitures accompagnées de valets bien armés.
Pour son retour dans la nouvelle Cour sans doute jeune et gaie, Mme de Fontsomme ne pouvait rêver mieux que Saint-Jean-de-Luz. D’abord, le site était magnifique avec sa baie lumineuse adossée aux contreforts si verts des Pyrénées. En outre, elle y retrouvait l’océan qu’elle aimait tant. N’était-il pas celui-là même qui baignait Belle-Isle ? Il dansa pour elle sous le soleil son plus beau ballet de grandes vagues nobles et majestueuses en lui soufflant au visage son air chargé d’iode qu’elle retrouvait avec délices. Et que la petite ville promue pour un temps capitale du royaume était donc joyeuse et colorée ! Entourant quelques belles demeures de brique et de pierre à tourelles carrées coiffées de toits roses à peine pentus, les maisons à colombages, dont les boiseries gaiement colorées et les balcons ajourés tranchaient sur le blanc éclatant des hourdis, formaient une cour révérencieuse à la vieille église Saint-Jean-Baptiste, sévère avec ses hauts murs, ses rares ouvertures et sa tour puissante. Et, au milieu de tout cela, un vrai carnaval commencé depuis le 8 mai, date à laquelle le carrosse doré du Roi était entré dans la ville au son des cloches et du canon, salué par le bayle et les jurats en chaperons et toges rouges et par les danses bondissantes des crasquabillaires revêtus d’habits blancs couverts de rubans éclatants et de grelots. Le blanc, le rouge et le noir étaient les couleurs du pays. S’y mêlaient à présent les tuniques bleu et or des mousquetaires, les vestes rouge et or des chevau-légers, les plumes de toutes couleurs dont le moindre seigneur, la dame la moins fortunée ornaient leurs chapeaux, et puis des habits de satin, de velours, de brocart, de taffetas, le tout brodé, soutaché, cousu de perles ou de pierres fines, évoluant dans un air de fête incessante avec, voltigeant dans l’air ensoleillé, des accords de guitare ou de violon. Le cardinal Mazarin avait bien fait les choses et Saint-Jean-de-Luz rayonnait de joie, de grâce et de jeunesse puisqu’un roi de vingt ans, le plus séduisant de tous, y venait épouser l’Infante…
Lorsque la voiture et le « fourgon » de Mme de Fontsomme s’arrêtèrent devant la maison Etcheverry après avoir traversé une foule qui se ruait vers la plage pour admirer, dans la baie, les joutes nautiques disputées autour de la galère dorée du Roi, il y faisait relativement calme. Accueillis par l’armateur avec une courtoisie parfaite, Sylvie et Perceval pénétrèrent dans une grande salle claire aux murs blanchis à la chaux, aux meubles luisants, où leur furent offerts du vin et des pâtisseries pour les remettre du voyage en attendant le souper, tout en échangeant les politesses un peu banales qui sont de mise entre gens qui ne se connaissent pas.
Mais, tout en grignotant un massepain, le nez sensible de Sylvie frémissait légèrement, cherchant à identifier une odeur agréable et tout à fait inconnue. Sa curiosité l’emporta sur le code des convenances.
— Pardonnez-moi, monsieur, dit-elle à son hôte, mais je sens ici un parfum que…
Manech Etcheverry sourit, amusé :
— Que vous ne connaissez pas et que j’ai moi-même découvert depuis peu. Il s’agit du chocolat de M. le maréchal de Gramont qui loge aussi chez moi les jours où il trouve plus commode de ne pas regagner son gouvernement de Bayonne. C’est une boisson dont il a fait l’expérience lors de son ambassade en Espagne pour demander la main de l’Infante…
— Le cho…
— Chocolat, madame la duchesse. M. le maréchal s’est mis à en raffoler et en a rapporté une provision, avec la manière de le préparer…
— En avez-vous déjà bu ?
— Oui. Le maréchal m’a fait cet honneur mais j’avoue que je n’en suis pas aussi fervent que lui. C’est terriblement sucré ; enfin, on dit que c’est excellent pour la santé. Cela donnerait des forces…
— Oh, fit Raguenel, je crois savoir de quoi il s’agit. Les Aztèques l’appelaient « le nectar des dieux » et c’est le conquistador Hernán Cortés qui l’a rapporté du Mexique… Il paraîtrait même que là-bas ces… grosses fèves, je crois, servaient de monnaie. Un produit rare… et fort cher !
— L’Espagne en développe les plantations outre-Atlantique mais, pour l’instant le chocolat est pratiquement réservé à la famille royale et aux Grands. Ce sont surtout les dames…

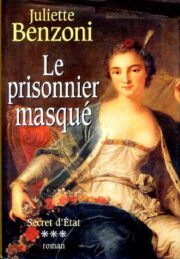
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.