Elle se tut, effrayée des paroles qu'elle murmurait. Au passage de la voiture, les lanternes des rues, dont M. de La Reynie avait ordonné l'établissement, projetaient des taches de lumière sur sa robe. Elle leur en voulait de dissiper cette obscurité où elle aurait souhaité s'enfoncer en aveugle.
Elle avait peur. Peur de Philippe, mais surtout de Joffrey, qu'il fût mort ou vivant !... À l'hôtel du Beautreillis, Florimond et Cantor vinrent au-devant d'elle. Ils étaient vêtus tous deux de satin rose avec cols de dentelle, portaient de minuscules épées, et étaient coiffés de feutres à plumes rosés.
Ils s'appuyaient au cou d'un grand dogue à pelage roux, presque aussi haut que Cantor. Angélique s'arrêta, le cœur battant, devant la grâce de ces petits êtres adorables. Qu'ils étaient graves et pénétrés de leur importance ! Comme ils marchaient lentement afin de ne pas froisser leurs beaux habits !
Entre Philippe et le fantôme de Joffrey, ils surgissaient, forts de leur faiblesse. « Que la vie s'accomplisse », avait dit le vieil intendant huguenot. Et la vie, c'était eux. C'était pour eux qu'elle devait continuer à tracer son chemin, lentement, sans défaillance.
Chapitre 21
Les affres et les scrupules qui durant cette période assaillirent Angélique et troublèrent ses nuits ne furent soupçonnés ni de son entourage ni de ses amies. Jamais elle n'avait paru si belle, si sûre d'elle-même. Elle affronta, avec un sourire à la fois condescendant et naturel, la curiosité des salons où se répandit comme une traînée de poudre, en même temps que la nouvelle de son futur mariage, la révélation de son origine aristocratique. Mme Morens ! La chocolatière ! Une Sancé ?... Famille devenue obscure au cours des derniers siècles, mais alliée par un réseau de rameaux glorieux aux Montmorency, et même aux Guise. Aussi bien les derniers rejetons de cette famille avaient commencé à la parer d'un nouveau lustre. Anne d'Autriche n'avait-elle pas réclamé à son chevet d'agonisante, un grand jésuite aux yeux de feu, le R. P. de Sancé, dont toutes les grandes dames de la cour souhaitaient recevoir la direction. Ainsi Mme Morens, dont l'originale existence et l'ascension brusquée étaient, quoi qu'on s'en défendît, un petit sujet de scandale, était la propre sœur de ce fin et souple ecclésiastique, déjà presque illustre ?... On en doutait. Mais, à une réception donnée par Mme d'Albret, qui s'était arrangée pour les mettre en présence, on vit le jésuite embrasser la future marquise du Plessis-Bellière, la tutoyer ostensiblement et s'entretenir longuement avec elle sur le ton de la plaisanterie fraternelle.
*****
C'était d'ailleurs vers Raymond qu'Angélique s'était précipitée le lendemain de sa rencontre avec Molines. Elle savait qu'elle aurait en lui un allié sûr, qui, sans avoir l'air d'y toucher, organiserait admirablement sa réhabilitation mondaine. Ce qui, d'ailleurs, ne manqua pas de se produire.
Une semaine ne s'était pas écoulée que la barrière d'arrogance dressée entre la roture présumée de la jeune femme et la sympathie des nobles dames du Marais s'était effondrée. On lui parla de sa sœur, la délicieuse Marie-Agnès de Sancé, dont la grâce avait enchanté, deux saisons, la cour. Sa conversion n'était que passagère, n'est-ce pas ? De toute façon, la cour allait s'honorer de la présence d'une autre Sancé, dont la beauté n'avait rien à envier à la première et dont l'esprit était déjà célèbre dans les ruelles. Ses frères Denis et Albert, ce dernier étant page de Mme de Rochant, vinrent la voir et, après des effusions pleines de franchise, lui réclamèrent de l'argent. On ne parla pas du frère peintre qu'on ignorait, et à peine de l'aîné, un jeune fou parti jadis pour les Amériques. De même qu'on ne s'appesantit guère sur le premier mariage d'Angélique, ni sur les raisons qui avaient pu pousser la descendante d'une authentique famille princière à fabriquer du chocolat. Ces courtisans et ces dames frivoles savaient parfaitement oublier, dans les chuchotements d'une confidence, ce que les uns et les autres avaient intérêt à oublier.
*****
À l'exception d'un seul, de Guiche, tous les favoris de jadis, redoutant la disgrâce, avaient appris à être plus discrets. Vardes était en prison depuis l'affaire du petit marchand d'oubliés, qui avait dévoilé celle de la lettre espagnole. La bonté profonde de la Grande Mademoiselle lui dicta le silence, malgré son amour des commérages. Elle embrassa longuement Angélique et lui dit :
– Soyez heureuse, très heureuse, ma chérie, tout en essuyant quelques larmes d'émotion.
Mme de Montespan avait bien souvenir d'un détail assez bizarre dans la vie de cette Angélique de Sancé, mais, toute à ses propres intrigues, elle ne s'en occupa guère. Elle se réjouissait qu'Angélique fût bientôt présentée à la cour. Avec la triste Louise de La Vallière et une reine maussade et pleurnicheuse, la cour manquait d'entrain. Or, le roi, sérieux et un peu gourmé, était aussi épris de gaieté et de folie qu'un adolescent trop longtemps contraint. Le caractère enjoué d'Angélique ferait merveille pour permettre à celui, étincelant, d'Athénaïs de s'épanouir. Leur attelage, formé par ces deux beautés rieuses, et qui se donnaient si vivement la réplique, n'était-il pas déjà recherché dans les salons comme un gage d'animation et de réussite d'une soirée ?
Athénaïs de Montespan accourut et donna à son amie une foule de conseils sur ses toilettes et sur les bijoux qui lui étaient nécessaires pour sa présentation à Versailles.
Quant à Mme Scarron, on pouvait avoir confiance en sa discrétion. L'intelligente veuve avait un souci trop constant de ménager Te présent, le passé ou l'avenir des personnes qui pouvaient lui être utiles, pour se risquer à commettre une imprudence. Par cet accord tacite et général, le récent passé d'Angélique parut tomber dans un trou noir. Un soir, après avoir regardé une fois encore le poignard de Rodogone-l'Égyptien, la jeune femme comprit que tout cela n'avait été qu'un rêve atroce et qu'il n'y fallait plus songer. Sa vie se ressoudait selon une ligne continue et prescrite d'avance, la vie d'Angélique de Sancé, jeune fille noble du Poitou, à laquelle déjà, autrefois, Philippe du Plessis-Bellière paraissait promis.
Chapitre 22
Cependant, cette disparition d'une tranche de son existence ne s'accomplit pas sans quelques remous.
Un matin qu'elle était à sa toilette, le maître d'hôtel du comte de Soissons, Audiger, se fit annoncer.
Sur le point de passer une robe et de descendre pour le recevoir, Angélique se ravisa et resta assise devant sa coiffeuse. Une grande dame pouvait fort bien recevoir en peignoir un subalterne.
Quand Audiger entra, elle ne se retourna pas et continua à poudrer doucement, avec une énorme houppe, son cou et la naissance de sa gorge. Dans le grand miroir ovale dressé devant elle, elle pouvait fort bien voir le visiteur s'avancer, raidi dans son simple habit bourgeois. Il avait l'expression sévère qu'elle lui connaissait bien, celle qui précédait entre eux l'explosion des « scènes conjugales ».
– Entrez donc, Audiger, dit-elle cordialement, et asseyez-vous près de moi, sur ce tabouret. Il y a fort longtemps que nous ne nous sommes vus, mais ce n'était pas nécessaire. Nos affaires marchent si bien avec ce brave Marchandeau !
– Je déplore toujours de rester trop longtemps sans vous rencontrer, dit le jeune homme d'une voix contenue. Car vous en profitez généralement pour faire des bêtises. Est-il vrai, si j'en crois la rumeur publique, que vous allez épouser le marquis du Plessis-Bellière ?
– C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, mon ami, répondit négligemment Angélique en ôtant avec une petite brosse douce une trace de poudre sur son cou de cygne. Le marquis est un mien cousin et je crois, en vérité, que j'en ai toujours été amoureuse.
– Ainsi, vous êtes enfin parvenue à réaliser les projets de votre petite cervelle ambitieuse !
Il y a longtemps que j'avais compris que rien ne serait jamais assez haut pour vous. À tout prix, et comme si cela en valait la peine, vous vouliez faire partie de la noblesse...
– Je SUIS de la noblesse, Audiger, et j'en ai toujours été, même au temps où je servais les clients de maître Bourjus. Vous qui êtes si bien au courant de tous les racontars, vous n'avez pas été sans apprendre également, ces jours derniers, que je me nomme en réalité Angélique de Sancé de Monteloup.
Le visage du maître d'hôtel se crispa. Il était très rouge.
« Il devrait se faire saigner », pensa Angélique.
– Je l'ai appris, en effet. Et cela m'a éclairé sur le sens de vos dédains. C'est pour cette raison que vous refusiez de devenir ma femme !... Parce que je vous faisais honte.
D'un doigt, il desserra son rabat qui, dans sa colère contenue, l'étranglait. Après avoir soufflé, il reprit :
– J'ignore pour quelles raisons vous étiez tombée si bas que je vous ai connue servante pauvre et vous cachant de votre famille même. Mais je connais trop le monde pour ne pas deviner que vous avez été victime d'intrigues sordides et criminelles, comme il s'en trouve toujours à l'ombre des cours. Et voilà que vous voulez retourner dans ce monde !... Non, je ne puis encore vous considérer ainsi. C'est pourquoi je continue à vous parler sur un ton familier qui, peut-être, vous choque déjà... Non, vous n'allez pas disparaître, Angélique, plus cruellement que si vous étiez morte. La belle gloriole, vraiment, d'appartenir à un milieu vil, hypocrite et stupide ! Comment, vous, Angélique, dont j'admirais la lucidité et le solide bon sens, pouvez-vous demeurer aveugle aux défauts de cette classe dont vous vous réclamez ?... L'atmosphère saine dont vous avez besoin pour vous épanouir et la bonté fraternelle des simples que vous avez trouvée parmi nous – voyez, je n'ai pas honte, moi, de me mettre sur le même pied qu'un maître Bourjus ! – comment pouvez-vous rejeter tout cela si aisément ?... Vous demeurerez seule parmi ces intrigants dont la futilité et la vilenie heurteront votre goût de la réalité, votre franchise, ou bien, comme eux, vous vous corromprez...

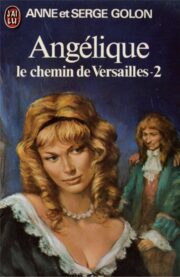
"Le chemin de Versailles Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le chemin de Versailles Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le chemin de Versailles Part 2" друзьям в соцсетях.