JULIETTE BENZONI
L’ANNEAU D’ATLANTIDE
PLON
PREMIÈRE PARTIE
UNE RUE À VENISE
1
Un cri dans la nuit
En sortant de chez son notaire où il venait de dîner, Aldo Morosini releva le col de son manteau, alluma une cigarette, exhala la première bouffée dont il respira l’odeur avec délices en homme privé depuis plus de deux heures de sa drogue préférée pour ménager les voies respiratoires de son hôte, puis enfonça ses mains dans ses poches et entreprit de réintégrer ses pénates. Maître Massaria habitait au Rialto, sur la riva del Vin, une jolie maison ancienne, voisine du palais Barbarigo et jouissant du privilège, rare à Venise, d’ouvrir sur le large quai où l’on déchargeait jadis les tonneaux venus de tous les ports de la Méditerranée, au lieu, la porte franchie, de se retrouver les pieds dans l’eau du Grand Canal. Le vieil homme appréciait de pouvoir aller s’asseoir, quand cela lui chantait, à la terrasse de l’une ou l’autre des trattorias qui avaient remplacé les anciens entrepôts, afin d’y boire un verre de vin au soleil.
C’était, en effet, un épicurien raffiné goûtant la bonne chère aussi bien que les bons crus et être invité chez lui était un plaisir qu’il réservait à quelques amis éprouvés partageant les mêmes goûts et d’un âge approchant le sien. Aldo Morosini, beaucoup plus jeune, était une exception, le vieux notaire – son étude restait la plus importante de la ville – lui vouait une affection quasi paternelle en mémoire de sa mère, la princesse Isabelle, dont il était tombé respectueusement amoureux à vingt ans sans qu’aucune autre femme ait pu réussir à prendre sa place. Ce qui l’avait condamné à un célibat dont il s’était toujours parfaitement accommodé.
On avait discrètement évoqué son souvenir au cours du dîner, entre la langouste grillée et le risotto aux truffes blanches. Maître Massaria avait une façon bien à lui de dire « notre chère princesse Isabelle » – elle était française – ou « votre chère maman » sur une sorte de soupir qui amusait et attendrissait Aldo. Il s’émerveillait d’ailleurs de ce rare talent qu’Isabelle avait eu de s’attirer des amours incorruptibles. Le notaire vénitien n’était pas le seul homme à lui avoir voué son cœur. Il y en avait un second, écossais celui-ci, lord Killrenan, coureur des mers impénitent, qui avait passé son existence à sillonner le monde sur son yacht, le Robert Bruce. Lui non plus ne s’était jamais marié et, après la mort du père d’Aldo, il jetait l’ancre régulièrement dans le bassin de San Marco pour apporter à sa bien-aimée un énorme bouquet de fleurs et de menus présents, mais surtout pour savoir si, princesse Morosini, elle n’était toujours pas disposée à devenir lady Killrenan. Indéfectiblement fidèle, jamais découragé, il avait fini assassiné à son bord au cours d’une escale à Port-Saïd, victime d’un joyau historique comme Isabelle. Mais de ce roman, Maître Massaria n’en avait pas eu connaissance. Cela lui permettait de se croire unique en son genre.
Il n’était pas tard. Onze heures sonnaient au campanile de San Silvestro quand Aldo quitta le quai pour s’enfoncer dans le lacis des étroites rues de la Venise sèche et rejoindre l’entrée arrière de son palais. Son vieil ami était d’un âge où l’on n’aime guère veiller, il n’en avait pas moins apprécié cet intermède chaleureux passé en compagnie d’un homme intégré depuis si longtemps à l’histoire de sa famille et, depuis sa naissance, à la sienne propre. Cela lui avait fait du bien.
Le moral, en effet, n’était pas au zénith. D’abord il était seul chez lui et son palais-magasin d’antiquités lui semblait vide en l’absence de sa femme Lisa et des enfants : les jumeaux Antonio et Amelia, cinq ans, deux têtes brunes habitées par un égal esprit d’entreprise, et Marco, le petit dernier, bébé rouquin, ravissant, autoritaire et braillard, à qui Aldo reprochait de trop accaparer une jeune mère dont il ne cessait d’être très amoureux.
On avait passé les fêtes de fin d’année à Vienne, chez la comtesse Valérie von Adlerstein, grand-mère de Lisa, et l’on aurait dû rentrer après l’Épiphanie mais, la vieille dame ayant dû subir une intervention chirurgicale d’urgence, Lisa avait, tout naturellement, prolongé son séjour, laissant Aldo rentrer sans elle à Venise. Solitude relative d’ailleurs, puisque vivaient à demeure au palais Morosini le discret et charmant Guy Buteau, jadis précepteur d’Aldo et à présent son fondé de pouvoir et son meilleur conseiller, Zaccharia, son vieux maître d’hôtel, Livia, la cuisinière, élève surdouée de la regrettée Cecina, défunte épouse de Zaccharia morte au champ d’honneur de son dévouement aux Morosini, Prisca, première femme de chambre, et Zian, le gondolier-chauffeur. Angelo Pisani, le secrétaire d’Aldo, et les autres satellites logeaient en ville.
En principe, Guy Buteau était lui aussi invité chez le notaire, mais il avait pris un bain de pieds involontaire en ratant une marche de l’entrée principale et, fragile des bronches, se trouvait confiné à l’intérieur depuis déjà une semaine. C’est donc seul qu’Aldo suivit le chemin du retour à travers les rues d’une Venise hivernale désertée par les touristes, ce qui n’était pas pour lui déplaire… Il aimait en effet marcher dans « sa » ville dont il connaissait chaque ruelle, chaque recoin, chaque demeure. Il pouvait mettre un nom sur chaque façade. Venise était pour lui un grand livre ouvert dont il ne se lassait jamais de tourner les pages.
Ce soir, pourtant, il se sentait moins sensible à la magie habituelle, justement à cause de cette humeur morose qu’il traînait derrière lui depuis qu’il avait quitté Vienne. Non qu’il se plût particulièrement au palais Adlerstein, vaste et sombre résidence gardée par des atlantes de pierre aux muscles athlétiques sur laquelle régnait Joachim, l’irritant majordome de Grand-Maman auquel le liait une aversion largement partagée, mais si les affaires toujours importantes de sa maison de prestigieuses antiquités occupaient largement son temps et celui de Guy Buteau, il n’y trouvait plus le plaisir coutumier et, se connaissant bien, il s’avouait, avec un rien de honte, qu’il lui manquait le piment de l’aventure, celle-ci courût-elle sur le fil du rasoir entre deux précipices comme cela s’était produit à plusieurs reprises.
Certes, il aimait toujours autant son métier : acheter de beaux objets ou de belles pierres, les revendre à qui saurait les apprécier. Parfois il les gardait pour sa collection personnelle, mais les joyaux historiques se faisaient rares, surtout ceux auxquels s’attachait une légende. Ses plus violentes émotions, il les avait cependant connues dans la chasse au trésor – le plus souvent maléfique d’ailleurs – en compagnie d’Adalbert Vidal-Pellicorne, le « plus que frère » ! selon Lisa et Tante Amélie, alors que la vie de l’un, de l’autre ou des deux était menacée. Le jeu passionnant prenait alors un air de roulette russe particulièrement excitant, même si on sortait de l’aventure à moitié mort en se jurant de ne jamais, au grand jamais, se laisser emporter à nouveau par quelque mirage que ce soit ! Aujourd’hui où son existence se déroulait sans surprises, où il se mouvait dans un calme olympien, Aldo découvrait qu’il s’était agi de serments d’ivrogne. Quoi de mieux pour fouetter le sang qu’un joyau rare, chargé d’histoire, pour faire battre le cœur sur un rythme accéléré… et se sentir pleinement vivant ! Un point de vue qu’il jugeait plus sage de garder pour lui et que Lisa partageait de moins en moins.
En ce mois de janvier, ceux qu’elle appelait « son gang » étaient dispersés. Adalbert, en bon égyptologue, devait être quelque part dans la vallée du Nil ou dans les monts de Nubie. La marquise de Sommières – Tante Amélie – nantie de son fidèle bedeau, Marie-Angéline du Plan-Crépin, sa cousine et lectrice à tout faire, respirait le soleil d’un pays méditerranéen comme il convenait à une octogénaire, en pleine forme sans doute mais soucieuse de se protéger des rhumatismes. On aurait une carte postale un de ces jours, griffonnée mélancoliquement par ladite Marie-Angéline qui – Aldo en était persuadé ! – regrettait au moins autant que lui ces mêmes aventures auxquelles elle se mêlait non sans talent et qu’elle estimait essentiellement vivifiantes.
Venise était étrangement silencieuse ce soir sous le croissant de lune plaqué sur un ciel sans nuages. Pour chasser ses idées lugubres, Aldo s’ébroua comme un chien au sortir de l’eau et alluma une seconde cigarette, repris par le charme de sa ville bien-aimée. Le temps s’était effacé avec le bruit de la civilisation. Seul, le miaulement indigné d’un chat noctambule trouvant porte close vint rappeler à Aldo qu’il ne se mouvait pas dans un monde de pierre et d’eau figé dans sa splendeur. Et puis soudain, aigu, désespéré, il y eut un cri suivi presque aussitôt d’un râle affreux – mais déjà Aldo courait dans sa direction. La lune déversait suffisamment de lumière pour qu’il aperçût trois hommes en train d’en malmener un autre. À pleins poumons, il hurla :
— Tenez bon ! J’arrive !
Simultanément, il tirait d’une poche le revolver plat qui ne le quittait plus guère lorsqu’il sortait la nuit, tira deux coups en l’air dans l’espoir d’attirer l’attention des gens dans ce quartier trop silencieux. Un juron lui répondit aussitôt, suivi d’un bruit de galopade et, en arrivant sur place, il constata que les malandrins s’étaient enfuis, abandonnant à terre un homme inanimé qui, curieusement, ne portait sur lui que sa chemise et ses sous-vêtements.
Un instant, il le crut mort à la vue du sang coulant de sa poitrine, mais le pouls battait encore faiblement. Aldo hésita, sa demeure n’était pas loin et l’homme, âgé, ne devait pas peser lourd… Le silence était toujours aussi accablant : les cris qui l’avaient alerté n’avaient attiré personne et il ne put retenir une grimace de mépris. Depuis que le Fascio de Mussolini régnait sur l’Italie, un de ses tentacules s’était enroulé autour de l’ancienne Sérénissime République où l’on avait appris à redouter ces hommes en chemise noire, déambulant par deux, espions sans cesse à l’affût qui ne cherchaient surtout pas à dissimuler ce qu’ils faisaient. C’était à pleurer !

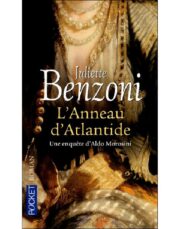
"L’Anneau d’Atlantide" отзывы
Отзывы читателей о книге "L’Anneau d’Atlantide". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "L’Anneau d’Atlantide" друзьям в соцсетях.