Les cultures étaient encore modestes. Un peu de seigle, de l'avoine pour les chevaux. À part les choux, les citrouilles, les raves et racines, genre navets et carottes, les agriculteurs de Wapassou avaient surtout porté leur effort à préparer de grandes prairies d'élevage, en asséchant le plus possible de terres aux alentours des lacs, afin de pouvoir amasser une quantité suffisante de fourrage pour la survie des bêtes domestiques. Le pichet de lait posé sur les tables familiales chaque matin était à ce prix.
Et y avait-il son plus agréable, bien que monotone, à ouïr dans les lointains de la maison, que le pilonnement alterné de deux barattes à beurre travaillant activement à transformer ce lait en une belle motte jaune pâle de ce beurre parfumé à l'odeur des fleurs de Wapassou ?
La forte Yolande ne fut pas longue à se porter volontaire et à prendre le relais dans la fatigante besogne qui demande vigueur et patience.
Des hommes et des jeunes gens étaient revenus de la dernière chasse que, chaque année, ils menaient avec les Indiens Métallaks. Une ultime séance de dépeçage, découpage, fumage, aurait lieu, puis un dernier festin avant que les Indiens ne repartent, par petites bandes, prendre leurs quartiers d'hiver.
Leur chef était ce Mopountook qui avait initié Angélique à la saveur des eaux de source du pays. Ware ! Ware ! L'eau ! L'eau ! répétait-il en algonquin, l'entraînant toujours plus loin. Et il disait aussi : « La nourriture, c'est pour le corps... L'eau, c'est pour l'âme ! »
*****
Le festin eut lieu sur la colline, près de ces grandes marmites de bois taillées dans des souches d'arbres non déracinés, et où les Indiens du Nord faisaient cuire leur bouillie de maïs avant que les Blancs n'eussent apporté à l'Amérique le chaudron de fer ou de fonte.
Les villages dans ce temps-là se groupaient autour des récipients inamovibles où l'eau versée était portée à ébullition par des boulets de pierre incandescents. Les tribus, alors, étaient peut-être moins nomades qu'aujourd'hui où il suffisait de jeter sur son échine les précieuses et indispensables chaudières pour décabaner.
Des quartiers de grandes citrouilles couleur d'aurore rôtissaient sur des braises. Dans l'une des chaudières des ancêtres, bouillaient des haricots, dans l'autre cuisaient les différents morceaux d'un orignal entier.
On offrit au Sagamore Mopountook les noix de gras de l'intestin de l'élan qui gardent un certain parfum de boyaux et se dégustent crues, mets de choix irremplaçable pour soutenir l'effort au cours des longues marches ou des longs portages et aussi les pieds de l'animal, grillés près du foyer et dorés, sous leur gélatine transparente, arrosés d'une sauce de fruits acides des bois. Le tout sans sel pour complaire aux Indiens.
Pour les estomacs délicats, des outardes rôtissaient sur les broches.
Les plus délicieuses odeurs s'élevaient, se mêlant aux fumées des huttes charbonnières de la hauteur d'en face où l'on fabriquait du charbon de bois pour l'hiver.
Des cris, des rires et des accents de flûtes et de clarinettes orchestraient le repas.
Barthélémy, Thomas et Honorine, et en général tous les enfants, se réjouissaient beaucoup à regarder manger les Indiens. Ces hôtes de marque n'avaient-ils pas, quand ils mangeaient, des manières beaucoup plus répréhensibles que les leurs, enfants de Blancs, à qui on reprochait si souvent de se mal tenir à table ! On aurait beau jeu maintenant de venir leur recommander de ne pas manger avec leurs doigts, de s'essuyer les mains, de fermer la bouche en mâchant et de ne pas roter !
Les enfants regardaient leur mère respective du coin de l'œil avec triomphe : c'était si amusant d'arriver à roter comme de vrais Indiens. Et les mères faisaient mine de ne s'apercevoir de rien.
Soit ! Les Indiens étaient malpropres, mais si gais, si convaincus de leur bienséance, qu'on ne ressentait pas de gêne à les voir s'essuyer les doigts sur leurs mocassins, ou prendre dans l'écuelle une part de viande pour vous la tendre après l'avoir un peu goûtée afin de s'assurer de sa qualité.
Et ce jour-là, entre les Blancs, ce fut le concours à qui arriverait à manger le mieux à l'indienne, c'est-à-dire d'une façon tout à fait déconseillée par le manuel de La civilité puérile et honnête.
La palme revenait à Joffrey de Peyrac.
Celui-ci, sans se départir de sa dignité de grand seigneur qui, sous n'importe quelle défroque, faisait partie de sa nature, avait une façon inimitable de s'accroupir auprès d'un Indien, tendant vers la face cuivrée son visage intelligent où se lisait une attention à la fois déférente et fraternelle.
Il prenait du bout des doigts dans la marmite les morceaux, les mangeait avec la même componction religieuse que ses hôtes, puis lançait derrière lui les ossements, avec une négligence qu'il semblait avoir pratiquée toute sa vie.
Il tirait sur le calumet, passé de bouche en bouche, sans manifester la moindre hésitation. En réalité, ces rites pour lui n'avaient d'autre importance que de resserrer les liens de compréhension humaine entre deux races étrangères, et s'il fallait manger avec ses doigts et cracher dans le même tuyau de pipe, il n'y voyait aucun inconvénient.
C'était donc surtout son attitude qui encourageait les Européens à se sentir à l'aise. Mélange d'indulgence et de considération.
Les enfants y arrivaient d'emblée. Une parenté d'esprit existe entre les enfants et les sauvages.
Elvire disait qu'elle sentait que ses garçons pourraient aussi bien la quitter d'un jour à l'autre sans retourner la tête pour suivre les Indiens dans leurs wigwams, et l'on connaissait maintes histoires d'enfants canadiens, français ou anglais, capturés au cours de raids, et qui s'étaient habitués chez leurs ravisseurs, s'attachant plus à leurs tribus d'adoption qu'ils ne l'avaient jamais fait vis-à-vis de leurs familles blanches.
Vers la fin des agapes, un quidam parmi les nouveaux venus qui connaissait mal la mentalité des Indiens de l'intérieur, proposa, pour couronner la fête, de distribuer à chacun une petite « goutte », une roquille d'alcool.
C'était une erreur. Mopountook s'indigna.
L'eau-de-feu des Blancs était pour les Indiens source de délire sacré. N'en boire qu'une « roquille », la valeur d'un dé à coudre, mesure française, ne leur provoquerait aucune transe ! N'avaler qu'une si petite quantité était considérée par le chef des Métallaks, non seulement comme un triste gaspillage, mais comme une insulte aux dieux. Lorsqu'on sert les dieux, on doit les servir sans lésiner !
Il interdit à ses guerriers d'accepter l'offre ridicule et mesquine. Certains, en cachette, allèrent réclamer leur « dé à coudre » dans l'intention de l'ajouter à leur réserve de plusieurs pintes, patiemment constituée au cours de l'été, d'un traitant à l'autre, et qu'ils conservaient en vue de la grande soûlerie sacrée à laquelle leurs frères et eux se livreraient avant la dispersion de l'hiver.
L'incident clos, les Métallaks ayant mangé à en être terrassés puis ayant digéré au cours d'une longue sieste béate tout environnée de fumée du tabac de Virginie, Mopountook et les autres chefs prirent Honorine ainsi que ses amis sur leur dos ou sur leurs épaules afin de leur faire faire un tour de galop dans la prairie.
Les cris, les rires et les chants reprirent. Les femmes avaient rangé les ustensiles, nettoyé les pots.
La subtile clarté du jour s'assombrit.
Lorsque Angélique regardait autour d'elle, ce n'était pas seulement la montée du froid qui la faisait frissonner légèrement.
Sous le poudroiement doré du soleil, le paysage somptueux des derniers jours d'automne avait pris un visage plus dépouillé. Le soleil pâlit et les Indiens chasseurs s'en allèrent.
On leur fit des signes du haut de la colline tandis qu'ils longeaient une dernière fois la rive du lac avant de disparaître sous les arbres gris. Dans cette eau que déjà ternissait une mince pellicule de glace, le reflet de leurs vivantes silhouettes paraissait troublé.
*****
Durant toute la saison d'été jusqu'à la fin de l'automne, les sentinelles, du haut des bastions et du donjon, n'avaient cessé de faire le guet sans relâche, et de nombreuses patrouilles de soldats mercenaires commandés par Marcel Antine poussaient chaque jour des reconnaissances aux alentours.
La surveillance se relâcha un peu ensuite quand la première neige fut tombée. C'est que la neige, hors la beauté paradisiaque qu'elle confère au paysage par sa blancheur étincelant de mille feux, amène avec elle un silence et comme une trêve qui n'est pas seulement imaginaire.
La neige et le froid garantissaient pour les humains la paix. Dure saison pour les bêtes et pour ceux qui n'ont pas leur suffisance de nourriture et de chaleur, elle avait cette clémence d'éloigner un fléau encore plus destructeur, la guerre.
Comme quoi, puisque les commandements n'y suffisent pas, il ne reste plus pour dresser une barrière entre l'homme et l'exécution de ses desseins de violence, que les décisions aveugles de la nature qui est une gardienne vigilante. Capricieuse, caustique, elle se rit de la puissance d'insecte de l'homme et parfois elle se fâche, si l'on essaie de passer outre. Si l'on savait comprendre les signes de son apparente déraison plus que la maudire, on devrait la remercier pour la désinvolture et l'arbitraire avec lesquels elle se met en travers des résolutions humaines et fait fi de leurs plans et de leurs décrets. Par exemple, la tempête, qui coula l'Invincible Armada espagnole devant les côtes d'Angleterre, anéantit des années de préparations minutieuses et fort bien agencées, gaspilla des flots d'or et changea le cours de l'histoire...

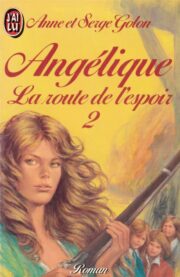
"La route de l’espoir 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "La route de l’espoir 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La route de l’espoir 2" друзьям в соцсетях.