Quand il ouvrit péniblement les yeux après un temps indéterminé, ce fut pour les refermer aussitôt avec l’horrible impression d’être devenu aveugle. Devant ses paupières il ne trouvait qu’une obscurité totale. En même temps il ressentit les élancements d’un furieux mal de tête joint à une forte nausée provoquée par l’odeur du chloroforme attachée à ses habits. Il rouvrit les yeux, y porta les mains et s’aperçut qu’elles étaient enchaînées : à chacune d’elles un bracelet de fer relié à une double chaîne lui laissait une certaine liberté de mouvements mais, en suivant les anneaux, il découvrit qu’elle était scellée dans la muraille. Et certainement depuis longtemps parce qu’elle était rouillée.
Il crut d’abord à un cauchemar : le temps n’était plus des forteresses médiévales où l’on enchaînait les prisonniers dans des culs-de-basse-fosse. Pourtant la réalité s’imposa à lui degré par degré. L’endroit où il se trouvait était froid et humide, et en se redressant il sentit sous lui une paillasse posée à même un sol en terre battue. Comment avait-il pu en arriver là ?
Au prix d’un pénible effort, il rassembla quelques souvenirs. Le coup de téléphone… la voix terrifiée de Tania… l’échange de vêtements avec Adalbert… le parcours jusqu’à la rue Greuze, une violente douleur… et puis plus rien ! Mais vraiment rien. Aucun souvenir de ce qui avait pu se passer depuis qu’on l’avait frappé et anesthésié ensuite. Aucune idée non plus du temps écoulé.
D’un geste machinal il chercha sa montre, bien qu’il fût incapable d’y lire l’heure, mais de toute façon il ne l’avait plus. On la lui avait ôtée, comme d’ailleurs la sardoine gravée à ses armes qu’il portait toujours à l’auriculaire, comme aussi son alliance !… Pour la première fois depuis bien longtemps il eut peur. Cette geôle qu’il ne pouvait pas voir était aussi noire, aussi sourde qu’un tombeau ! Et si c’en était un, après tout ?… Perdu au bout du monde dans un lieu désert, loin de la vie et des hommes ? Une tombe où il allait pourrir lentement jusqu’à ce que Dieu le prenne en pitié et le délivre. Lorsqu’on l’avait jeté, deux ans plus tôt dans la prison d’Istanbul, même derrière les murs énormes de Yédi Koulé, il pouvait percevoir autour de lui la vie, l’activité des autres, la respiration du monde extérieur. Ici rien ! Jamais il n’aurait imaginé que se trouver captif pût éveiller dans son cœur un sentiment d’abandon aussi total. Jamais le sang n’avait battu dans ses oreilles au rythme désordonné d’une vraie terreur…
Alors quelque chose se déclencha en lui et il pleura. Et les larmes, en relâchant ses nerfs tendus par l’effroi, lui firent du bien, le rendirent à ce qu’il avait toujours été : un homme sachant affronter le pire. Et le pire, il semblait l’avoir atteint, mais ce n’était pas une raison pour accepter ce naufrage au fond de lui-même. En cherchant un mouchoir dans sa poche – cela au moins il l’avait encore ! – il sentait le poids, la gêne des fers à ses poignets et en tira de l’assurance : pourquoi enchaîner quelqu’un, sinon pour l’empêcher de fuir ? Et on ne s’enfuit pas d’une tombe. Donc ceci n’en était pas une et il devait exister un moyen d’en sortir. Il se leva, tâta le mur près de l’attache des chaînes et acquit ainsi la certitude qu’il était fait de grosses pierres et que l’endroit avait une forme ronde qu’il put suivre sur une certaine distance grâce à la longueur de ses entraves. Il sut qu’il était dans une sorte de puits et son cœur manqua un battement : rien ne ressemble plus à un puits qu’une oubliette. Pourtant son pied heurta sans le renverser un seau dans lequel il y avait de l’eau, Cela lui rappela qu’il avait soif et, s’agenouillant près du seau, il y plongea son visage pour y boire. C’était froid, mais un peu revigorant car il ne s’agissait pas d’eau croupie. Il en conclut que, si on lui donnait à boire, on lui donnerait peut-être aussi de quoi manger. En attendant, il trempa son mouchoir pour en tamponner son front douloureux, revint s’asseoir sur sa paillasse et attendit…
Quoi, il n’en savait trop rien, n’ayant plus aucun moyen de compter le temps ; mais petit à petit, il fit moins noir dans sa prison et ce n’était pas seulement parce que ses yeux s’accoutumaient, c’était parce que le jour se levait et glissait un mince rayon de lumière entre deux pierres. Mince en vérité, mais suffisant pour qu’Aldo sût qu’il n’était pas au fond de la terre comme il le craignait, mais peut-être dans une de ces tours féodales comme il en existait encore aux environs de Paris. Malheureusement ses chaînes étaient trop courtes pour lui permettre d’aller coller son œil à cette bienheureuse fissure.
Voyant mieux, il put examiner son logis, qui était rond en effet et d’à peu près trois mètres de diamètre. Seulement il n’y avait pas de porte. Quant au mobilier, il se composait de la paillasse, du seau contenant de l’eau et d’un autre destiné sans doute à l’hygiène ; mais pas la moindre nourriture en vue, hélas ! Et il se sentait affamé…
Cherchant l’issue par laquelle on l’avait fait entrer, il regarda au-dessus de sa tête, mais les ombres étaient épaisses là-haut et ne permettaient pas de distinguer quoi que ce soit. Pourtant, ce fut de là-haut que soudain la lumière lui arriva après qu’un bruit de tôle se fut fait entendre et il sut qu’il était bien au fond d’un puits ou d’une citerne dont il évalua la hauteur à cinq ou six mètres.
Il y avait un homme qui se tenait accroupi au bord du trou, un homme qui portait un masque grimaçant de carnaval :
— Eh bien, mon cher prince, ricana-t-il, que pensez-vous de votre nouveau logis ? Un peu austère peut-être ?
L’oreille d’Aldo était trop sensible aux sons pour qu’il ne reconnût pas cette voix bien timbrée et somme toute agréable :
— Il m’est déjà arrivé d’être prisonnier, répondit il avec une désinvolture qu’il était bien loin d’éprouver mais qui était chez lui une seconde nature. Toutes les prisons se valent. Il est vrai qu’on pourrait attendre mieux de l’hospitalité d’un grand d’Espagne.
— Parce que vous pensez que j’en suis un ?
— Hélas oui ! Ôtez donc ce masque, mon cher marquis ! Vous êtes ridicule !
— Dans quelques jours vous me trouverez moins ridicule, messer Morosini. Quand vous apprécierez mieux les agréments de votre séjour. Il se peut que vous me suppliiez à genoux de vous en tirer. Seulement cela ne servira à rien tant que…
— Tant que quoi ?
— Tant que je n’aurai pas reçu ce que je veux !
— Et que voulez-vous de plus ? Vous avez déjà la « Régente », les bracelets de la princesse Brinda et l’émeraude d’Ivan… sans compter ma montre, mon alliance et ma chevalière.
— J’admets que c’est intéressant. La perle surtout qui ne quittera plus les Joyaux de la Couronne. Le reste va entrer dans mon trésor de guerre ainsi que ce que j’attends de vous.
— Là où j’en suis, je ne vois pas très bien ce que je pourrais vous donner. Ma chemise ? Si ça peut vous faire plaisir.
— Il faudra qu’elle vous serve encore un bout de temps. Non, ce que je veux, c’est votre collection de bijoux. On dit que vous avez des pièces magnifiques…
— Pas mal, oui, mais j’aurais quelque peine à aller vous la chercher. C’est loin, Venise !
— N’exagérons rien ! L’un de mes serviteurs y est justement parti. Je l’ai chargé de déposer chez vous, sous l’aspect anodin d’un commissionnaire un petit paquet contenant votre sardoine ancestrale et une lettre. Le tout adressé à votre femme…
— Ma femme n’est pas à Venise !
— C’est contrariant, mais comme le paquet va arriver en urgence, il y aura bien quelqu’un pour lui faire parvenir mon message ? Votre séjour risque seulement de se prolonger un peu plus !
— Et que dit ce message ?
— Qu’elle doit, si elle veut vous revoir vivant m’apporter elle-même ces babioles là où je le lui indiquerai. Si elle tardait trop, d’ailleurs, j’ai spécifié qu’elle pourrait recevoir votre alliance… et le doigt qui va avec !
Si quelque chose trembla dans le cœur d’Aldo ce ne fut pas à la pensée de la mutilation annoncée, mais bien à l’évocation de Lisa invitée à se jeter dans les griffes de ce fou. Sa voix cependant resta ferme :
— Pourquoi elle-même ? J’ai un fondé de pouvoir qui peut sortir de mes coffres ce que je veux…
— Je préfère que ce soit elle. D’abord parce qu’elle est, paraît-il, une fort jolie femme et que rien ne me plaît plus qu’un joli visage. Ensuite, parce que j’ai des projets pour elle.
— Vous voulez la couronner impératrice ? Je vous signale qu’elle est déjà mariée…
— Cessez de me prendre pour un imbécile ! gronda Agalar. Je me marierai lorsque le souci de la dynastie sera à l’ordre du jour. Quand je parle de projets pour votre femme, ils sont de tout autre nature.
— On peut savoir ?
— Pourquoi pas ? Cela va vous permettre d’apprécier. Si mes renseignements sont bons, la princesse est la fille de Moritz Kledermann, le banquier suisse ?
— Tout le monde le sait ! fit Aldo en haussant les épaules.
— Et une fille unique ? Eh bien, mais c’est très simple : lorsqu’elle m’apportera ce que je veux, je l’inviterai à un petit séjour dans ma demeure jusqu’à ce que son père ait payé la rançon que je me ferai un plaisir de fixer… assez haut ! Mais rassurez-vous, continua-t-il en réponse au grondement sourd qui monta du puits, elle sera traitée en… impératrice. D’ailleurs… il se pourrait que je l’épouse quand vous aurez disparu. Ce qui pourrait se produire dans un laps de temps assez court.
— Vous êtes un fier misérable ! s’écria Morosini envahi de dégoût. Ainsi, rançon payée, vous me tuerez, simplement ?
— Je n’en aurai même pas besoin : il suffira de sceller l’entrée de ce puits désaffecté et de vous y oublier. Personne n’aura l’idée de vous y chercher : il est au fond du parc et à flanc de coteau où un éboulis s’est produit, dénudant la muraille à moitié de sa profondeur. Vous n’y manquerez donc jamais d’air. Évidemment, quand on aura cessé de vous nourrir et de vous abreuver, le séjour sera moins agréable… Et je vous préviens que crier ne vous servirait à rien : il n’y a pas une âme à moins de deux cents mètres…

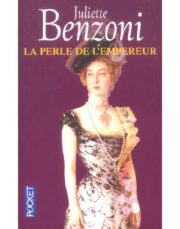
"La Perle de l’Empereur" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Perle de l’Empereur". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Perle de l’Empereur" друзьям в соцсетях.