— Pas si bon que si j’arrive à atteindre le cerveau en pénétrant l’association. Amener Napoléon VI devant nos objectifs, voilà qui vaut la peine de se donner du mal. Mais il y faut de la patience.
— En ce qui me concerne je n’en ai plus guère, parce que je voudrais bien rentrer chez moi et que ce nouveau meurtre n’arrange rien…
Il se tut soudain sous l’impact des applaudissements qui saluaient l’entrée de Masha, dont la voix s’élevait réduisant au silence les soupeurs aussitôt sous le charme. Un charme auquel Aldo n’essaya pas d’échapper, bien au contraire. Il ne comprenait pas les paroles mais il y avait dans cette voix aux sonorités de violoncelle une sorte de magie qui lui faisait du bien. Pourquoi fallut-il que le journaliste chuchotât à son oreille :
— Vous connaissez cette chanson ? Elle s’appelle « La fin de la route » et elle est chargée de douleur. Je suppose que Masha la dédie à son frère ? Voulez-vous que je traduise ?
— Vous parlez russe ?
— Je parle cinq langues. C’est utile dans mon métier. Écoutez, elle dit :
Mes rêves se sont tus car tu es parti maintenant,
Nous ne faisons plus route commune,
Une simple intention mal interprétée
Et le regard s’est glacé de haine…
— Par pitié, taisez-vous ! intima tout bas Morosini, désagréablement impressionné parce qu’a cet instant il pensait à Lisa et au plaisir qu’ils auraient goûté si elle était auprès de lui en ce moment. Je préfère ne rien comprendre : cette voix est un poème à elle seule…
— Oh ! Je suis désolé ! Toujours cette manie de faire étalage de mes petits talents…
— Ne faites pas attention ! Mon humeur tend à la morosité ces temps-ci…
— Je peux comprendre et je ferai de mon mieux pour vous aider !
Leurs regards se croisèrent. Ce qu’y lut Aldo lui plut. Il sourit :
— J’espère ne pas vous donner trop de travail…
En quittant le Schéhérazade aux environs de trois heures du matin, il se sentait réconforté. Vers la fin de la soirée, il avait échangé quelques mots avec Masha. Celle-ci l’avait reçu avec des larmes dans les yeux en lui appliquant pour la première fois le tutoiement qui noue les liens :
— Il faut que tu me pardonnes ! J’ai peur de t’avoir entraîné dans une affaire non seulement grave mais dangereuse. Le meurtre d’aujourd’hui montre que nous avons devant nous des gens qui ne reculent devant rien…
— Ne culpabilise pas, Masha Vassilievich ! répondit-il en prenant dans les siennes une main singulièrement froide. Dans mon métier, ces dangers sont fréquents parce que tous les joyaux historiques sont plus ou moins dangereux. J’espère que ma chance tiendra bon !
— Dieu t’entende ! Mais moi je veux encore te dire ceci : le jour, la nuit, quelle que soit l’heure où tu auras besoin de nous, les Vassilievich ne te feront pas défaut. Mes frères parlent par ma voix. On se battra avec toi !
Elle l’attira contre sa vaste poitrine et l’embrassa, l’enveloppant d’une odeur d’ambre et d’encens qui sacralisait curieusement cette étreinte. Puis traça sur son front un signe de croix.
— Merci, murmura Aldo ému. Je ne l’oublierai pas !
Deuxième partie
DU SANG À LA UNE…
CHAPITRE VI
LES INVITÉS DU MAHARADJAH
Le bureau du commissaire Langlois, quai des Orfèvres, ne lui ressemblait pas en dépit des violettes de Parme, ornement de sa table, qui trempaient dans une attendrissante opaline azurée. Pour le reste, classeurs de carton vert bouteille, meubles d’ébène et moleskine fatigués par les âges, rien ne cadrait avec l’élégant maître des lieux. Si pourtant : un assez joli tapis persan, rouge et bleu, étendu sous le simple bureau occupé surtout par un épais dossier, réchauffait un parquet que l’on ne cirait certainement pas plus d’une fois l’an. Et encore ! L’atmosphère ambiante sentait bien un peu la poussière mais une subtile odeur de tabac anglais la rendait respirable. Aux murs tapissés d’un papier vert foncé à palmettes, une grande carte de Paris et trois ou quatre photos jaunissantes dans des cadres de bois sombre.
— Les bureaux de la Préfecture ne ressemblent sans doute pas aux vôtres, fit Langlois qui, adossé à un classeur, fumait une courte pipe en examinant son visiteur. Mais, que voulez-vous, la République n’est pas riche. J’ajoute que le tapis est à moi.
Il portait ce matin-là un costume de serge bleu marine avec une cravate d’un grenat discret. Pour la première fois Morosini remarqua à son revers une petite rosette de la Légion d’honneur.
— Les fleurs aussi je suppose ? Elles s’épanouissent rarement dans les locaux de la police…
— Pourtant dans cette pièce il y en a toujours eu et je ne fais que suivre les habitudes de mon prédécesseur qui fut aussi mon maître : le commissaire principal Langevin dont vous voyez ici un portrait. Un grand policier maintenant à la retraite.
— Oh, je connais M. Langevin !
Et comme les sourcils de Langlois se relevaient, il expliqua :
— C’est un vieil ami de ma grand-tante, la marquise de Sommières. Je lui dois même quelques bons conseils dans une affaire difficile. Si vous le voyez, voulez-vous le saluer pour moi ?
— Je n’y manquerai pas, soyez-en certain. À présent me direz-vous ce qui me vaut votre visite ?
— Ceci !
Aldo venait de tirer de sa poche l’écrin de cuir vert dans lequel, chez le commissaire-priseur, on avait logé la « Régente ». Il l’ouvrit et le posa sur le bureau.
— Je vous l’apporte, soupira-t-il. Faites-en ce que vous voulez !
Posant sa pipe, Langlois prit l’écrin pour l’approcher de la lumière froide dispensée par la lampe qui éclairait sa table de travail. Puis il saisit doucement la perle par son chapeau de diamants :
— Quelques grammes de splendeur et tant de sang versé ! C’est à peine croyable.
— Dans la profession que j’exerce c’est plus fréquent que vous ne le croyez, mais on dirait que cet objet est particulièrement redoutable. Ce matin j’ai été éveillé aux aurores par Maître Lair-Dubreuil…
— … qui a été victime cette nuit d’une tentative de cambriolage. Si on peut appeler ça comme ça ! Il s’agissait surtout de lui faire peur en lui laissant un message du fou qui ose signer Napoléon VI. S’il veut éviter d’en répondre sur sa vie, il doit remettre la perle à son propriétaire ou à celui qui l’a mise en vente. Alors il vous a appelé ?
— C’est exact et moi, maintenant, je viens vous voir parce que j’en ai assez de cette histoire, commissaire ! Mes affaires me réclament et je voudrais bien revoir Venise.
— Vous auriez pu le faire plus tôt. Il suffisait de me dire la vérité au lieu de jouer à cache-cache avec moi. Mais, pour la bonne règle, revenons un peu en arrière : c’est bien cela que les assassins de Piotr Vassilievich cherchaient chez lui ?
— En effet. Sa sœur voulait me la confier pour que je la vende. Nous l’avons trouvée ensemble et vous connaissez la suite. Sachant que son dernier propriétaire légal était le prince Youssoupoff, je suis allé chez lui pour la lui rendre mais il n’en a pas voulu. C’est un homme… extrêmement séduisant et un peu étrange…
— Je l’ai rencontré et je suis pleinement d’accord avec vous. Je sais aussi qu’il a vendu certains des joyaux emportés par lui de Russie et, si je vous suis bien, il a refusé celui-ci ? Mais pourquoi ?
— Il n’a pas voulu y toucher. Superstition ou prémonition, toujours est-il qu’il m’a dit de m’en charger et de le vendre au plus vite, l’argent récolté devant servir à alléger la misère de ses compatriotes et assurer le sort du petit Le Bret, le jeune garçon qui a osé suivre les ravisseurs du tzigane. Je suis donc reparti avec et je l’ai confiée à Maître Lair-Dubreuil. Et voilà où nous en sommes…
— Pourquoi n’achetez-vous pas vous-même on ne faites-vous pas acheter par votre beau-père ! Vous êtes tous deux collectionneurs et plutôt riches ?
— Parce que moi non plus je n’en veux pas. Traitez-moi de Vénitien superstitieux si vous voulez, mais je ne veux pas faire entrer la « Régente » dans la maison où vivent ma femme et mes enfants. Pas davantage chez Moritz Kledermann mon beau-père. Sa passion des joyaux historiques lui a coûté suffisamment cher et ce qui s’est passé hier me renforce dans ma conviction : quiconque possédera la « Régente » sera en danger. Tout au moins tant que vous n’aurez pas mis la main sur ce maniaque de la couronne !
— Soyez sûr que je m’y efforce. En attendant vous souhaitez que je la garde ?
— Exactement. Au fond c’est une pièce à conviction et je ne pense pas que l’assassin oserait s’en prendre à votre forteresse. Quant au petit Le Bret, je vais dès à présent me charger de son avenir. Les réfugiés, eux, attendront qu’il soit possible de monnayer ce damné bijou…
— Oh, je vous comprends. Cependant je ne peux le garder.
— Mais… pourquoi ? fit Aldo affreusement déçu.
— Je pourrais vous dire que nos coffres ne sont pas assez solides mais surtout la loi ne nous autorise pas à nous charger de ce qui n’est pas vraiment une pièce à conviction puisque l’assassin ne l’a pas eue en main. Vous pourriez la confier à la Banque de France avant de partir ? Parce que, bien sûr, vous souhaitez que je vous rende votre liberté, ajouta Langlois avec un demi-sourire.
— Vous voulez dire que j’en rêve !
— Eh bien partez ! Si j’ai besoin de vous, je saurais toujours où vous trouver ! Je crains même d’avoir un peu abusé de mes pouvoirs…
Emporté par une grande vague de soulagement, Morosini aurait volontiers embrassé le commissaire qu’il remercia avec chaleur. Du coup, il récupéra l’écrin sans se faire prier davantage.

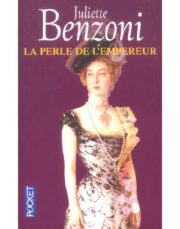
"La Perle de l’Empereur" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Perle de l’Empereur". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Perle de l’Empereur" друзьям в соцсетях.