— Non, mais en 1662 la France a connu une terrible famine. La princesse a vendu tous ses joyaux, toutes ces perles qu’elle aimait tant, pour nourrir les pauvres du Berry, de la Champagne et de la Picardie. La grande perle a disparu sans que l’on puisse savoir où jusqu’à ce qu’elle reparaisse un siècle et demi plus tard entre les mains de Nitot…
— Belle histoire ! apprécia Morosini. Mais comment le savez-vous ? Le maréchal d’Estrées ne devait plus être de ce monde ?
— Le maréchal d’Estrées est mort à quatre-vingt-dix-sept ans en 1670. Quand la princesse a vendu ses trésors il n’en avait que quatre-vingt-neuf et jusqu’à cette dispersion il s’est arrangé pour ne jamais perdre de vue une perle qu’il ne se consolait pas d’avoir donnée de façon si inconsidérée. Je me suis beaucoup intéressé à lui. J’ai réussi à retrouver d’autres notes et papiers grâce auxquels j’ai pu reconstituer cette affaire. Que vous m’apportiez la « Régente » aujourd’hui représente beaucoup pour moi. Une espèce de couronnement. Elle est si belle !
La perle reposait au creux de sa main et il la caressait d’un doigt léger. Aldo gardait le silence, respectant cet instant d’évident bonheur mais ce fut Maître Lair-Dubreuil qui rompit le charme en soupirant :
— Malheureusement je vais la reperdre ? Si vous êtes ici, c’est que vous désirez que je la vende ?
— À moins que ne vouliez l’acheter personnellement ? fit Aldo en souriant.
— Ma femme ne me le pardonnerait pas ! Elle est aussi une rareté, car elle déteste les bijoux. Puis-je vous demander qui vend cette pièce d’exception ? Vous-même ?
— Non. Et le vendeur souhaite garder l’anonymat. Vous n’y voyez pas d’inconvénient ?
— Dès l’instant où vous le représentez, les meilleures conditions sont requises. Il se trouve justement…
Il s’interrompit pour choisir sur sa table de travail un épais dossier qu’il se mit à feuilleter :
— … que nous avons dans dix jours une vacation regroupant plusieurs bijoux d’une certaine importance provenant de deux écrins dont les propriétaires sont décédées depuis peu. La « Régente » pourrait en être la pièce maîtresse… À moins que vous ne préfériez qu’elle soit vendue seule ?
— Non. Je souhaite qu’elle soit vendue le plus vite possible. Voilà plus d’une semaine que j’ai quitté Venise et j’ai hâte d’y rentrer…
— Alors nous allons faire en sorte de ne pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous demander quelques signatures et ensuite je m’occuperai d’organiser une publicité discrète auprès de quelques collectionneurs…
En quittant l’étude de Maître Lair-Dubreuil, Morosini se sentait plus léger. La « Régente » reposait à présent dans le coffre-fort ultra-perfectionné du célèbre commissaire-priseur et il ne lui restait plus, à lui, qu’à rentrer tranquillement chez Adalbert… et à téléphoner à Vienne. Entendre la voix de Lisa et peut-être les piaillements joyeux de ses poussins était ce dont il avait le plus besoin ! Après il anticipait avec plaisir un bon dîner, une soirée paisible au coin du feu à évoquer des souvenirs ou à parler archéologie et ensuite une bonne nuit… sans soucis, sans musique tzigane, sans policiers et même sans rêves ! Il y avait longtemps qu’il n’avait éprouvé une telle sensation de fatigue…
Peut-être était-ce trop demander ? Quand, après une attente de trois heures, il obtint enfin sa communication, ce fut pour entendre au bout du fil la voix compassée de Joachim le maître d’hôtel qui lui déversa les nouvelles du jour : non, Madame la princesse n’était pas là, ni d’ailleurs Madame la comtesse ! Non, elles ne rentreraient pas ce soir ! Ni demain ou après-demain… Ces dames s’étaient rendues à Salzbourg chez des amis qui donnaient une série de concerts Mozart terminée par un grand bal.
— Et quand doivent-elles rentrer ?
— Je ne sais pas, Excellence ! Ces dames ont emporté des bagages assez… importants.
— Et les jumeaux ? Elles les ont emportés aussi ?
La voix déjà crispante se chargea de réprobation :
— Bien entendu ! Madame la princesse est une mère admirable et…
— Je le sais aussi bien que vous ! Puis-je vous prier de mettre un comble à vos bontés en me confiant chez qui elles sont ?
Il y eut un temps de silence coupé d’une petite toux sèche qui agaça prodigieusement Aldo :
— À quoi réfléchissez-vous ? S’agirait-il d’un secret d’État ?
— N… on ! Non… mais on ne peut pas leur téléphoner.
— Et pourquoi, s’il vous plaît ?
— Il n’y a pas de téléphone dans un palais voué entièrement à la musique où ces sonneries énervantes seraient malvenues.
— On peut quand même y recevoir du courrier ou bien les lettres font-elles aussi trop de bruits discordants ? Alors où sont-elles ?
— Chez S. A. S. le prince Colloredo-Mansfeld, ce qui dit tout ! annonça le maître d’hôtel avec l’emphase qui convenait à tant d’illustration. On ne saurait déranger inconsidérément une si haute maison !
— Dites-moi, mon bon Joachim, je suis quoi moi ?
— Je… Évidemment ! Et je prie Votre Excellence de pardonner un regrettable oubli. Je voulais seulement dire…
— Vous avez très bien dit ce que vous vouliez dire !
Aldo raccrocha avec tant d’énergie que le téléphone faillit rendre l’âme. Il était furieux. Pas parce que Lisa s’offrait quelques jours de villégiature en compagnie de Mozart – encore qu’il n’aimât guère les Colloredo, auxquels il reprochait d’en faire un peu trop pour un génie de la musique à qui leur ancêtre avait fait mener une vie impossible ! – mais elle aurait pu l’en avertir au lieu de laisser à l’insupportable Joachim la délectation de le lui annoncer.
— Tu lui en veux ? dit Adalbert qui venait d’entrer porteur d’une pile de livres qu’il déposa sur le bureau.
— À qui ?
— À mon téléphone. Qu’est-ce qu’il t’a fait pour que tu le malmènes ?
— Il m’a mis en communication avec cet imbécile de Joachim. Lisa, sa grand-mère et les jumeaux sont à Salzbourg, chez les Colloredo et ce pompeux crétin m’en a fait tout un plat parce que sont des princes médiatisés…
— Alors que tu n’es, toi, qu’un pauvre petit prince vénitien pas médiatisé du tout et boutiquier par-dessus le marché… Tiens ! On vient d’apporter pour toi ce poulet – et il pécha sur le tas de livres une longue et étroite enveloppe bleutée ! Une dame sans doute : il sent diablement bon !
Il embaumait, en effet, et le nez d’Aldo identifia celle qui lui écrivait avant même d’avoir jeté un œil sur la signature.
— La comtesse Abrasimoff ! commenta-t-il à mi-voix. Comment a-t-elle eu mon adresse ? Ou plutôt la tienne ?
— D’où la connais-tu ?
— Je l’ai rencontrée cet après-midi chez Youssoupoff.
— C’est simple : il la lui a donnée.
— Alors il est voyant parce que je ne me souviens pas de la lui avoir confiée. Pour quelle raison l’aurais-je fait ? Il n’a aucune envie de nous revoir moi et la « Régente ».
— Alors c’est elle qui est voyante… Que te veut-elle, si je ne suis pas indiscret ?
— Elle m’invite à prendre le thé demain parce qu’elle déplore la trop grande brièveté de notre entrevue de tout à l’heure. Elle dit aussi qu’elle me connaît de réputation et qu’elle a grand besoin de conseils…
— C’est vague. Que vas-tu répondre ?
Aldo replia la lettre et la mit dans sa poche :
— Il n’y a pas de réponse. Apparemment cette belle dame ne doute pas de mon acceptation. Elle m’attend, un point c’est tout.
— Ah, ah !… Et elle est belle ?
— Insolemment. Elle doit être géorgienne, circassienne ou quelque chose comme ça…
— Et bien sûr, tu vas y aller ?
— Tu n’irais pas, toi ? Ne fût-ce que par curiosité ?
Adalbert haussa les épaules et entreprit de ranger ses bouquins dans la bibliothèque :
— Poser la question, c’est y répondre…
CHAPITRE IV
UN SOUPER CHEZ MAXIM’S
La belle Circassienne – en fait c’en était une ! – habitait près du Trocadéro(6) dans une rue tranquille, un petit appartement au troisième étage d’un immeuble haussmannien pourvu d’un ascenseur aux vitres gravées et d’escaliers réchauffés d’un chemin de tapis rouge sombre fixé aux creux des marches par des tringles de cuivre brillant. La porte en fut ouverte devant Aldo par une créature hybride qui aurait pu être la fille de Gengis Khan et de Bécassine. Il vit une figure lunaire, enserrée dans un châle de soie noire agrafé d’une épingle d’or sous le menton. Un petit nez rond y voisinait avec de cruels yeux mongols, noirs comme des pépins de pomme. Quant à la bouche elle semblait inexistante, on ne s’apercevait de sa présence que lorsque la femme parlait : une simple fente dans une boule de suif. Et qui ne s’ouvrait pas souvent.
— Je suis le prince Morosini, annonça Aldo.
— Madame la Comtesse attend Monsieur le Prince…
Elle l’introduisit dans un salon dont la banalité le surprit : un ensemble de chaises et de fauteuils couverts de soie bouton d’or entourant un canapé du même Louis XVI de grand magasin, des rideaux de velours assortis, une copie de tapis persan, un lustre à cristaux que l’on retrouvait sous forme de chandeliers de chaque côté de la cheminée sur laquelle trônait une pendule en marbre blanc. Deux tableaux de paysages sans intérêt aux murs et, tout de même, sur un guéridon, un grand vase de cristal contenant des roses à longues tiges d’un beau pourpre foncé.
C’était la seule note vivante dans cette pièce où rien n’indiquait la présence d’une jeune et jolie femme. Et encore ! Dans les salons de n’importe quel palace on en aurait trouvé autant. Il pensa que la belle Tania avait dû louer cet appartement meublé. Mais, quand elle apparut le décor sembla s’éclairer par la magie de son extrême beauté.

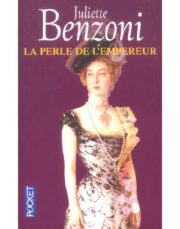
"La Perle de l’Empereur" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Perle de l’Empereur". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Perle de l’Empereur" друзьям в соцсетях.