— Si j’ai bien compris, dit-il, tout en dégustant, les yeux mi-clos, son verre d’un vieil armagnac que Talleyrand avait fait porter dans la soirée à son intention, ni l’inspecteur Pâques ni Savary n’ont voulu vous écouter lorsque vous avez essayé d’accuser votre... enfin lord Cranmere ?
— C’est bien cela ! L’un m’a prise pour une folle et l’autre n’a rien voulu entendre.
— Leur conviction s’est renforcée du fait qu’il a été impossible de trouver la moindre trace de son passage. Le personnage doit être singulièrement habile dans l’art de brouiller sa piste ! Pourtant, il était bien à Paris. Il existe bien, quelque part, quelqu’un qui l’a vu.
— Il me vient une idée, s’écria soudain Marianne. A-t-on cherché chez notre voisine ? Cette Mrs Atkins, avec laquelle Adélaïde était du dernier bien et chez qui Francis logeait, doit tout de même être capable de nous dire si oui ou non il est encore chez elle et, s’il n’y est plus, combien de temps il y est resté !
— Magnifique ! s’exclama Jolival. Voilà pourquoi il fallait que je vienne. Vous n’aviez point parlé de Mrs Atkins dans votre lettre. Votre cousine, qui s’est cachée jadis chez elle, n’en aura que pour un moment de la confesser tout à fait. Son témoignage peut être d’une importance d’autant plus grande qu’elle est anglaise, elle aussi.
— Reste à savoir, fit Marianne soudain assombrie, si elle acceptera de témoigner contre un compatriote.
— Si Mlle Adélaïde n’y parvient pas, personne n’y arrivera et il faut, en tout cas, essayer. D’autre part, lord Cranmere a fait un bref séjour à Vincennes quand Nicolas Mallerousse l’avait arrêté boulevard du Temple. Il serait peut-être possible de trouver sa trace au registre d’écrou.
— Croyez-vous ? Il s’en est échappé si facilement ! Peut-être n’a-t-il même pas été inscrit ?
— Pas inscrit ? Alors que Nicolas Mallerousse en personne l’escortait ? Je vous parie bien que si ! Et cette inscription au registre, c’est la preuve formelle de la nature exacte des relations entre lord Cranmere et votre pauvre ami. Si nous pouvons faire examiner le registre, nous avons une chance d’être entendus de la Police d’abord, de la Justice ensuite ! Et, au besoin, nous irons à l’Empereur. Il vous interdit de l’approcher, mon amie, mais moi il ne m’a rien interdit du tout ! Et je demanderai audience. Et il m’entendra !... Et nous aurons gain de cause !
Tout en parlant, Arcadius se laissait emporter par les espoirs tout neufs qui venaient de se lever avec les deux suggestions émises par lui et par Marianne. Ses petits yeux vifs brillaient comme des braises et les lignes bizarres de son visage, si affaissées tout à l’heure par le souci, se relevaient pour arriver presque au sourire. Pour Marianne, cet enthousiasme communicatif fut une soudaine bouffée de joie et d’espoir et fit l’effet d’un tonique. Un élan la jeta au cou de son ami :
— Arcadius ! Vous êtes merveilleux ! Je savais bien que, si je vous retrouvais, je retrouverais du même coup l’espoir et le goût de la lutte ! Grâce à vous, je sais maintenant que tout n’est pas perdu, que nous arriverons peut-être à le sauver !
— Peut-être ? pourquoi, peut-être ? renchérit Jolival chez qui l’armagnac du prince décuplait les effets de l’enthousiasme, il faut dire que nous le sauverons sûrement !
— Vous avez raison : nous le sauverons... à n’importe quel prix ! ajouta Marianne avec un accent de détermination si farouche qu’Arcadius, à son tour, l’embrassa, heureux de la voir reprendre meilleur moral.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis son départ de Paris, Marianne se coucha sans éprouver la pénible impression d’accablement et d’impuissance qu’elle retrouvait chaque soir, plus aiguë et plus pénible quand tombait le jour. La confiance, au moins, lui était revenue et elle savait que, même éloignée de Paris, même exilée, elle pourrait désormais agir, par personne interposée peut-être mais pour le plus grand bien de Jason. Et cela, c’était la plus réconfortante des pensées.
Quand, au matin, Jolival reprit la route de Paris, avec un courage qui faisait honneur à son endurance et à ses qualités de cavalier, il emportait, outre une lettre de Marianne pour Adélaïde, tous les espoirs revenus de sa jeune amie. En revanche, il laissait derrière lui une femme qui avait repris le goût de vivre.
Les jours qui suivirent furent, pour Marianne, un bienfaisant moment de rémission. Confiante dans l’action conjuguée d’Arcadius et d’Adélaïde, elle s’accorda le loisir de subir le charme de la petite ville thermale, laissant couler paisiblement les heures à l’horloge de la tour Quiquengrogne. Elle trouva même un certain plaisir à regarder vivre, dans une bien plus grande liberté qu’à Paris, la maisonnée de Talleyrand.
Du matin au soir, elle pouvait entendre les rires et les chants de la petite Charlotte qui semblait avoir pris à tâche de donner une nouvelle jeunesse à son grave M. Fercoc et qui, pour une fois, imposait à son précepteur une loi où les jeux et les escapades en campagne avaient infiniment plus de place que le latin ou les mathématiques.
Tous les matins, de sa fenêtre, Marianne amusée assistait au départ du prince pour les bains. A la mode du pays il s’installait dans une chaise à porteurs fermée après avoir revêtu une incroyable quantité de châles, de flanelles et de lainages en tous genres qui en faisaient une sorte d’énorme et réjouissant cocon. Ce qui ne l’empêchait nullement de s’habiller comme tout le monde quand les différentes phases du rite étaient accomplies. Et il n’était plus question ni de soins ni de régime lorsque toute la société passait à table – Marianne prenait tous ses repas avec ses amis – pour déguster les merveilles que Carême parvenait à tirer d’une installation assez modeste qui, chaque été, le mettait dans un état de fureur permanent ne prenant fin qu’avec le retour aux cuisines fastueuses de Valençay ou de l’hôtel Matignon.
Il y avait aussi Boson, le frère sourd qui faisait à Marianne une cour discrète, surannée et totalement incohérente parce qu’il ne comprenait pas la moitié de ce qu’on lui disait. C’était d’ailleurs une cour intermittente, Boson passant le plus clair de son temps la tête dans l’eau, dans l’espoir – trouvé Dieu sait où ? – de venir à bout de sa surdité.
Les après-midi se passaient en promenades en voiture avec la princesse, ou en lectures avec le prince. On allait à Souvigny, ce Saint-Denis des ducs de Bourbon, admirer l’abbatiale et ses tombeaux, à travers la campagne bocagère du Bourbonnais où de grands bœufs blancs émaillaient les prairies peuplées d’arbres et bordées de haies vives. Le temps, d’une infinie douceur, donnait à cette terre puissante et riche son plein épanouissement de beauté sereine. Et il n’était jusqu’au bavardage puéril de Mme de Talleyrand qui ne parût à Marianne reposant et sain durant cette éclaircie dans les noires intrigues où elle se débattait.
Avec Talleyrand, Marianne lisait, comme il le lui avait annoncé, la Correspondance de Mme du Deffand qui amusait beaucoup le prince, parce qu’elle lui rappelait « sa première jeunesse, son entrée dans le monde et toutes les personnes qui, alors, y tenaient le haut rang ». Et la jeune femme, en sa compagnie, plongeait avec une surprise émerveillée dans ce XVIIIe siècle charmant et frivole où ses parents avaient vécu leur amour. Souvent, d’ailleurs, la lecture s’achevait sur une causerie où le prince prenait plaisir à évoquer, pour sa jeune amie, les souvenirs qu’il gardait de ce couple « le plus beau et le mieux assorti » qu’il eût connu et que leur fille, elle, connaissait si mal. A travers sa parole, qui savait se faire singulièrement prenante et tendre, Marianne croyait voir sa mère s’avancer, ravissante et blonde, en robe de mousseline blanche, une haute canne enrubannée à la main, dans les allées de Trianon, ou bien s’asseoir dans une profonde bergère, au coin de la cheminée de son salon, pour y recevoir avec grâce les hôtes qui se pressaient chez elle pour des « thés à l’anglaise » qu’elle savait rendre intimes et charmants même pour cinquante personnes. Puis Talleyrand faisait revivre un instant Pierre d’Asselnat et son altière règle de vie, vouée tout entière à deux amours : sa dévotion intransigeante à la royauté et l’ardente passion qu’il portait à sa femme. Alors, c’était le grand portrait du guerrier de la rue de Lille qui reprenait vie dans l’imagination de Marianne, émerveillée mais un peu jalouse.
« Vivre un amour comme celui-là ! pensait-elle en écoutant son vieil ami. Aimer et être aimée comme ils se sont aimés... et puis mourir ensemble, même, s’il le fallait, dans cet éclaboussement de sang et d’horreur de l’échafaud ! Mais d’abord quelques années... quelques mois au moins d’un bonheur impossible à recommencer ! »
Ah ! comme elle comprenait cet élan de sa mère qui, voyant son époux arrêté, avait revendiqué avec hauteur le droit de le suivre à la mort, refusant même de penser à l’enfant qu’elle laissait derrière elle pour vivre son amour jusqu’au bout ! Elle-même, durant ces nuits si longues qu’elle endurait depuis le drame de Passy, avait mille fois songé qu’elle ne survivrait pas à Jason. Elle avait imaginé cent fins tragiques à son pauvre roman. Elle se voyait jaillissant de la foule et se jetant devant les fusils du peloton d’exécution au moment de la salve mortelle, si Jason avait droit à la mort d’un soldat, ou encore se tranchant la gorge au pied de l’échafaud s’il était traité comme un criminel vulgaire. Mais maintenant que Jolival lui avait rendu l’espoir, elle tendait toute sa volonté vers la réalisation, envers et contre tous, de ce bonheur qui la fuyait, cependant, avec tant d’obstination. Vivre avec Jason leur amour et qu’ensuite croule le monde pourvu qu’ils en aient bu le philtre jusqu’à la dernière goutte !

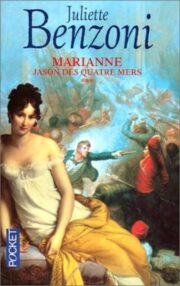
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.