Abd-el-Malek s'écria :
– Pour l'amour d'Allah, n'oublie pas que je suis ton parent !
– Tu l'as bien oublié toi-même, chien !
– Souviens-toi que nous avons été comme des frères, Moulay Ismaël !...
– Mes propres frères, j'en ai tué six de ma main et fait occire dix autres. Alors que m'importe toi, un neveu !
– Pour l'amour de Mahomet, pardonne-moi.
Le roi ne lui répondit pas. Il fit signe qu'on le prît et qu'on le fît monter sur la charrette.
Deux gardes s'y juchèrent avec lui. Ils lui prirent le bras droit, l'un par le coude, l'autre par la main et appuyèrent son poignet sur un billot...
Le roi appela l'un des bouchers et lui ordonna de faire l'exécution. Le Maure hésitait. Il était de ceux qui avaient secrètement désiré la victoire d'Abd-el-Malek. Seul, ce jeune prince avait drainé avec lui toutes les aspirations des tribus, avides de se fonder une dynastie de noble extraction comme celle des Almoravides ou des Almohades. Avec sa mort, ce rêve disparaissait. L'obscur boucher-bourreau avait dissimulé ses sentiments, mais il fallait croire que l'œil de Moulay Ismaël l'avait percé à jour. Il s'apprêta à monter, puis s'arrêta et faisant un pas en arrière dit qu'il ne couperait jamais la main à un homme d'une aussi noble naissance, au propre neveu de son souverain, qu'il préférait qu'on lui coupât la tête.
– Qu'il en soit donc fait ainsi ! cria Moulay Ismaël, et tirant son sabre il la lui trancha d'un seul coup précis qui révélait une longue habitude de ce cruel exercice.
L'homme s'effondra, sa tête roula, le sang s'élargit sur le sable brûlant. Un autre boucher désigné, intimidé par cet exemple, monta en chancelant sur la charrette. Pendant qu'il montait, le roi fit approcher les enfants, les femmes et les parents d'Abd-el-Malek et leur dit :
– Venez voir couper la main de ce cornard qui a osé prendre les armes contre son roi et voyez couper ce pied qui a osé marcher contre lui !
Des hurlements désespérés s'élevèrent dans l'air surchauffé et couvrirent le cri du prince, auquel le boucher venait de couper la main. On lui coupa ensuite le pied. Le Sultan s'approcha et lui dit :
– Eh bien, Cara, me reconnais-tu à présent pour ton roi ? Tu ne me connaissais pas auparavant ?
Abd-el-Malek ne répondit pas, regardant couler le sang de ses artères. Moulay Ismaël se mit à caracoler sur place, tournant vers le ciel son visage terrible, en proie à une agitation qui glaçait de terreur tous ceux qui le regardaient. Soudain, il leva sa lance et tua d'un coup au cœur le boucher qui avait fait l'exécution.
Ce que voyant, son ancien rival écroulé dans son sang cria :
– Voyez donc le vaillant homme, voyez sa bravoure ! Il tue celui qui lui obéit, il tue celui qui ne lui obéit pas. Tout ce qu'il fait est vain. Allah est juste. Allah est grand !
Moulay Ismaël se prit à rugir pour couvrir la voix de sa victime. Il criait qu'il avait apporté la chaudière pour y faire connaître au traître le suprême supplice, mais que parce qu'il était grand et magnanime, la poix de ce supplice servirait au contraire à le sauver, qu'il avait agi comme un roi outragé devait agir, mais qu'il laisserait à Allah le soin de décider si Abd-elMalek devait vivre ou mourir. Ainsi il ne serait point dit que c'est lui qui avait tué son frère car trop de choses les liaient et il connaissait aujourd'hui la plus grande douleur de sa vie. Le couteau du boucher lui avait tranché, à lui aussi, la main et le pied semblait-il. Et pourtant Abdel-Malek n'était qu'un traître qui, s'il avait triomphé, l'aurait égorgé de sa propre main. Il le savait. Pourtant il lui faisait grâce !...
Il ordonna qu'on mît le bras et la jambe de son neveu dans le goudron bouillant, afin d'arrêter le sang.
Ensuite, il fit faire une décharge générale par ses mascarins et chargez quatre alcaïds de conduire son neveu vivant à Miquenez.
Les officiers s'informèrent du sort qu'il réservait au lieutenant Mohammed-el-Hamet. Moulay Ismaël le livra à ses chasserots qui étaient des petits nègres de douze à quinze ans. Ils entraînèrent le cheik sous les murs de la ville. On ne sait ce qu'ils lui firent, mais quand ils le ramenèrent à la tombée du jour il était mort et bien mort et aucun des siens n'eût pu le reconnaître...
Moulay Ismaël et son escorte, et la caravane brune et multicolore d'Osman Ferradji avaient atteint Miquenez à l'heure du couchant, à l'heure où les bannières montaient aux boules d'or des minarets, et que l'appel impérieux et plaintif des muezzins planait sur la ville couleur de bel ivoire, allongée sur son éperon rocheux dans l'ardeur d'un ciel écarlate. La gueule noire de la massive porte de guerre engouffrait les silhouettes fourmillantes, avalait sa ration de guerriers et de cavaliers, d'esclaves et de princes, de chameaux et d'ânes, avant de laisser le bled désertique à la nuit. La ville emmagasinait derrière ses remparts tous ces bruits humains, les cris et les pleurs, la fièvre et les passions. En passant sous la Porte Neuve, Angélique détourna les yeux. Un esclave nu et qui lui parut gigantesque était cloué au vantail par les deux mains. Sa tête blonde et embroussaillée retombait en avant comme celle d'un christ mort.
Chapitre 11
Angélique se boucha les oreilles. Du fond du palais les cris hystériques des femmes d'Abd-el-Malek montaient, vrillaient, se prolongeaient, en une mélopée coupée de hoquets, qui durait depuis des heures.
Une migraine lancinante martelait les tempes d'Angélique. Des frissons la secouaient. Fatima essayait en vain de lui proposer quelque boisson chaude ou glacée, des fruits ou des gâteaux. Leur seule vue, la vue de ce confort sucré et gourmand des odalisques, la révulsait comme si tout cet amas de pâtisseries rosés et vertes, de parfums choisis, d'onguents douceâtres dont les servantes mauresques l'avaient massée pour la reposer des fatigues du voyage, lui rappelaient obstinément sa condition effroyable : enfermée dans un harem du prince le plus cruel que l'Univers ait enfanté.
– J'ai peur. Je veux m'en aller d'ici, répétait-elle d'une voix hachée, enfantine.
La vieille esclave provençale ne comprenait pas les raisons de cette subite dépression alors qu'on était arrivé enfin au terme d'un long voyage durant lequel sa maîtresse avait fait preuve de courage et de résignation édifiante. Fatima-Mireille estimait déjà qu'on ne pouvait trouver mieux que cet immense caravansérail où la poigne de fer du Grand Eunuque faisait régner une discipline rassurante. Malgré le désordre des événements récents, l'effervescence dans laquelle se trouvait la ville, l'appréhension que faisait peser sur tous la fureur de Moulay Ismaël bafoué par son neveu, bien que le Grand Eunuque eût été immédiatement retenu par le roi pour l'entretenir et le conseiller après cette longue absence, les arrivantes et tous les membres de la caravane avaient trouvé accueil opulent et efficace. Les bains des sultanes étaient prêts, la vapeur fumait dans les hammam de mosaïques vertes et bleues où une armée de jeunes eunuques et de servantes s'empressaient. La vieille Mireille s'était immédiatement découvert placés sous ses ordres trois négresses et autant de négrillons et de négrillonnes qu'il lui fallait pour aller chercher les innombrables choses qui manquent fatalement dans tout nouveau lieu, fût-il royal. Les cuisines déversaient sans cesse des plateaux de victuailles odorantes. Chaque courtisane nouvelle avait trouvé son appartement personnel préparé selon sa valeur, les jeunes garçons de grands dortoirs où des magisters, la règle à la main, commençaient déjà à dresser cette jeunesse turbulente tandis que des jongleurs étaient promus à les distraire en cette première période de leur adaptation. Les chevaux avaient été conduits vers « l'estable » magnifique pour y être pansés et bichonnés. Il était de source connue que Moulay Ismaël avait encore plus de passion pour ses chevaux que pour ses femmes. L'éléphant nain dévorait une montagne de douce herbe sèche et odoriférante, la girafe un enclos de bananiers, et les autruches avaient la joie de renouer dans une autrucherie modèle, d'agréables relations avec leurs congénères venant du lointain Sud. C était une maison bien réglée que le sérail du Grand Eunuque. Fatima jouissait d'en sentir l'abri se refermer sur elle après les années difficiles qu'elle avait vécues dans la casbah puante d'Alger, petite vieille sans racines, nourrie d'une poignée de figues et d'une gorgée d'eau pure. Ici il y avait beaucoup de vieilles femmes, pleines d'expérience et de ragots à colporter en toutes les langues anciennes, esclaves élevées au rang de servantes ou de gouvernantes de grande maison ou, au contraire, anciennes concubines du roi et de son prédécesseur ; celles-ci n'ayant pas droit à la retraite dorée des sultanes préférées, dans de lointaines forteresses, apportaient leur fiel et leur goût des intrigues dans les rangs de la domesticité.
Responsables de chacune des courtisanes ou des favorites, de leurs vêtements, de leur parure, de leur beauté, elles avaient fort à faire, occupées de les farder, de les épiler, de les coiffer, de les conseiller, de satisfaire leurs caprices, de leur glisser de précieuses recettes d'amour pour retenir les faveurs de leur seigneur et maître. Fatima se sentait en force. On lui avait même parlé déjà d'une suivante de la sultane Leïla Aïcha, très appréciée de sa maîtresse et qui était comme elle marseillaise. Et puis c'était un harem où les eunuques se montraient en général fort polis. Ce n'est pas le cas dans tous les harems. Mais Osman Ferradji ne mésestimait pas l'influence des vieilles servantes sur ses pensionnaires et savait se les attacher pour en faire d'excellentes geôlières.
Plus elle y réfléchissait, plus Fatima trouvait ce sérail plein de qualités. Elle n'était pas loin de penser que même celui du grand Sultan de Constantinople ne pouvait le dépasser en opulence et en raffinement. La seule ombre au tableau était le comportement de la captive française. Bientôt elle aussi semblait sur le point de se mettre à pleurer, à hurler et à s'égratigner le visage, comme les femmes indigènes d'Abd-el-Malek dans la pièce voisine, ou comme la petite Circassienne promise au lit royal dès ce soir, et que les eunuques avaient emportée hurlante de terreur à travers le dédale des couloirs et des patios. Quand les femmes se mettent à s'énerver, quand il y en a plus de mille assemblées, on peut prévoir un beau tapage et de regrettables excès. En Alger, Fatima avait vu des captives se jeter du haut des balcons et se fracasser le crâne sur les dalles des cours. D'étranges nostalgies saisissent parfois les étrangères. Angélique lui paraissait sur le point de céder à l'une de ces humeurs dangereuses et sombres. Fatima ne savait plus où donner de la tête. Il lui fallut dégager sa responsabilité. Elle requit les avis du second parmi les eunuques, le bras droit d'Osman Ferradji, le gros Rafaï. Celui-ci prescrivit de lui faire boire un calmant. On en avait déjà préparé pour la Circassienne.

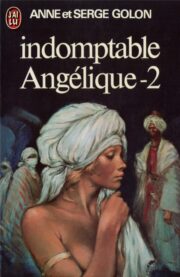
"Indomptable Angélique Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Indomptable Angélique Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Indomptable Angélique Part 2" друзьям в соцсетях.