Un homme de mauvaise mine s’avança :
— Faites-le, sinon on vous le saigne… Si vous êtes des ennemis du peuple…
— J’étais hier boulevard de Gand où j’ai reçu une balle, gronda Félicia. Mon amie soignait les blessés à l’Hôtel de Ville. Alors nous n’avons que faire de vos menaces. Allez où vous voulez mais prenez garde : les Suisses sont bien armés.
— Nous aussi ; nous avons un canon…
Ledit canon, une pièce de musée, n’avait qu’un coup à tirer et ne fit pas grand mal. En revanche, il déchaîna chez l’ennemi un feu particulièrement bien nourri qui joncha de cadavres et de blessés la paisible rue de Babylone.
— Je crois qu’il vaut mieux que je renonce à me reposer, soupira Félicia. Quant à vous, Hortense, vous allez pouvoir faire usage de vos talents d’infirmière. Aidez-moi à m’habiller et allons voir ce que l’on peut faire pour ces braves gens…
Tant que dura la bataille, ce fut l’affolement. On recueillit des blessés, on distribua de la nourriture, du vin. Calmé, Timour, après avoir reconnu qu’il se trompait d’ennemi, alla prêter main-forte. Durant deux heures le combat fit rage. Malheureusement pour les Suisses, tout le quartier, peut-être pour éviter le pillage car il y avait dans la foule des figures inquiétantes, s’était mis contre eux. Les coups de feu crépitaient. On tirait des maisons, on jetait sur le moindre uniforme rouge qui se montrait tout ce qui tombait sous la main. Reprise par sa fièvre belliqueuse, Félicia, grimpée sur son toit avec les émeutiers, surveillait les opérations.
Seule, Hortense ne partageait pas l’enthousiasme général. Toute cette violence, tout ce sang – innocent après tout – lui faisaient à présent horreur. La Liberté ne pouvait-elle naître qu’au milieu du massacre ? Dans cette rue bordée de jardins fleuris, la mort commençait à perdre sa noblesse car certains de ceux qui la donnaient obéissaient au simple plaisir de tuer… Soudain, son cœur se souleva, à la fois de dégoût et d’indignation : là, dans la cour de la maison, un groupe d’énergumènes venait d’entraîner un jeune Suisse déjà blessé qu’ils avaient fait prisonnier. On lui arrachait son uniforme, on l’attachait… Un homme armé d’une hache s’avançait :
— On va tailler de beaux morceaux là-dedans ! brailla-t-il avec un clin d’œil ignoble…
Alors Hortense s’élança, sauta le perron, se jeta les bras en croix devant la victime désignée :
— Ne touchez pas à cet homme ! cria-t-elle. Je vous l’interdis !…
L’homme à la hache la saisit par le bras et voulut l’écarter. Mais déjà elle s’était attachée de toute la force de ses bras au jeune Suisse et résistait.
— Fous-le camp de là, la belle ! Sinon je te fais ton affaire à toi aussi !…
La voix de Félicia, chargée d’angoisse, tomba du toit.
— Retirez-vous Hortense ! Vous allez vous faire massacrer.
— Alors vous en porterez la responsabilité, Félicia Orsini, puisque vous ne savez pas faire respecter votre maison… Je ne le lâcherai pas !
— C’est ce qu’on va voir…
La hache de l’homme tournoyait déjà autour de sa tête. Hortense ferma les yeux. Un coup de pistolet claqua et la brute s’abattit… C’était Félicia qui avait tiré. Mais Hortense et son protégé n’étaient pas sauvés. Les compagnons de l’homme à la hache n’étaient pas calmés. Leur cercle menaçant se rétrécissait… Soudain, par le portail ouvert, surgit Charras un fusil à la main. D’un regard il comprit la situation :
— Camarades ! cria-t-il. Nous sommes ici pour balayer une monarchie, pas pour assassiner des femmes et des blessés !…
— Vinchon a été tué, riposta un homme qui avait déniché on ne savait trop où une carmagnole et un bonnet rouge. On va le venger !…
— Non ! Tente la moindre chose et je t’abats ! Ça fera deux morts !
Brusquement, sa voix perdit son ton menaçant pour redevenir vibrante.
— Ceux de cette maison nous ont aidés, et nous avons mieux à faire. Écoutez les cloches ! Ce n’est plus le tocsin ! Le fort Raguse est tombé ! Il faut aller assurer notre victoire et rejoindre les autres ! Ici, il n’y a plus rien à faire !
Il y eut un silence. Chacun écoutait. L’une après l’autre les cloches des églises de Paris s’ébranlaient, non plus pour le sinistre tocsin mais pour des volées joyeuses telles qu’on en entend au matin de Pâques et aux grandes fêtes.
— Marmont est vaincu ? reprit l’homme à la carmagnole sur un ton de doute.
— Et en fuite. Il se replie vers Saint-Cloud. La Fayette se rend à l’Hôtel de Ville ! Paris est à nous !…
Une immense clameur lui répondit. D’un seul coup, la maison se vida. Les insurgés avaient hâte à présent de participer à la victoire, de rejoindre les autres vainqueurs. Ils se précipitaient, se bousculaient. Ce fut, dans la rue, une débandade indescriptible… Puis, graduellement, tout rentra dans le silence. Hortense, toujours couchée sur le blessé se releva… pour constater qu’il était mort et que sa robe était pleine de sang.
Alors, se laissant tomber sur les marches du perron, elle éclata en sanglots… Un instant plus tard, Félicia vint s’asseoir auprès d’elle. En silence, elle la regarda pleurer pendant quelques minutes. Puis, presque timidement, elle demanda :
— Est-ce que vous me détestez, Hortense ?… Il ne faut pas. Je suis comme je suis, c’est-à-dire très différente de vous en dépit de notre amitié. Depuis des siècles, les Orsini ont fait couler le sang et ont versé le leur. Nous n’y avons jamais attaché beaucoup d’importance.
— Je sais, Félicia, je sais… mais ne me dites pas que vous auriez laissé massacrer ce malheureux sous vos yeux et sans rien faire pour lui porter secours ?
— Il y a des cas qui sont au-delà de tout secours. La vraie charité aurait consisté à lui loger une balle dans la tête pour lui éviter la souffrance. C’est ce que j’aurais fait, sans vous.
— Ne valait-il pas mieux faire ce que vous avez fait ?
— Non car, si le jeune chef n’était pas arrivé à temps avec sa bonne nouvelle, cela n’aurait sauvé ni vous ni moi, ni aucun des habitants de la maison, Même les héros peuvent, dans certains paroxysmes, se transformer en bêtes sauvages…
— Des héros ? Ça ? fit Hortense en désignant du pied l’homme à la hache qui gisait à présent auprès de sa victime.
— Pourquoi pas ? J’ai vu tout à l’heure cet homme s’élancer seul, lui, premier, contre la mitraillade des Suisses sans autre défense, pour sa poitrine, que cette chemise… Venez, à présent, rentrons. Timour et Gaetano nous débarrasseront de ces cadavres…
Les deux femmes rentrèrent en silence pour constater que l’intérieur de la maison semblait avoir subi le passage d’un ouragan… et que l’argenterie et certains bibelots avaient disparu. Hortense se garda de faire remarquer que les héros savaient parfois aussi s’occuper de leurs intérêts…
Delacroix ne revint pas ce soir-là. Ni Hortense ni Félicia ne le regrettèrent en dépit de l’amitié qu’elles lui portaient. Elles avaient besoin que la paix et le silence leur permettent de se retrouver et d’oublier qu’un instant elles s’étaient détestées…
La nuit fut calme. La Révolution était terminée mais personne ne le savait encore avec certitude même si la statue de Louis XVI, place des Victoires, et celle d’Henri IV sur le Pont-Neuf s’ornaient toutes deux d’un drapeau tricolore…
Les nouvelles arrivèrent le lendemain avec le colonel Duchamp. Le Roi avait enfin, la veille au soir, rapporté ses stupides ordonnances mais il était trop tard. Plus personne ne voulait le voir revenir à Paris et c’en était fini de son règne. Dans la ville, la joie était à son comble mais une joie encore teintée d’une légère méfiance. On ne serait vraiment tranquille que lorsque les Bourbons auraient compris qu’il ne leur restait que l’exil. Et puis les états-majors politiques entraient en jeu et, de ce côté-là, rien n’était gagné.
— On dirait que vous n’êtes pas satisfait, mon ami ? dit Hortense qui observait, depuis son arrivée, le visage de l’officier. Pourtant, la bonne cause l’a emporté ?
— Quelle cause ? Là est la question. Il semblerait que nous n’ayons fait tout cela que pour le duc d’Orléans. Il se terre à Neuilly mais la propagande que l’on fait autour de son nom est effrénée. Le vieux Talleyrand ne chôme pas en ce moment… Alors moi je pars. En fait, je suis venu vous dire adieu.
— Vous partez ! s’exclamèrent les deux femmes d’une même voix. Mais pour où ?
— Pour Vienne. J’ai mon portemanteau sur mon cheval et je ne me reposerai guère en route. Il importe que ceux qui sont là-bas, prêts à nous aider, sachent au plus vite que les Bourbons sont abattus, que la route est libre pour le fils de l’Empereur.
— Libre ? dit Félicia. Ne disiez-vous pas à l’instant que les orléanistes sont entrés en campagne ? Êtes-vous sûr que vous aurez le temps de ramener le prince, en admettant qu’il puisse partir ?
Duchamp haussa les épaules avec un dédain superbe.
— Les nôtres aussi sont au travail. On distribue des portraits du roi de Rome et d’autres, plus récents, qui montrent le prince tel qu’il est, si jeune, si blond, si fier ! Dites-vous bien ceci : quel que soit le gouvernement qu’on instaure, Napoléon II n’aura qu’à paraître sur le pont de Kehl pour que la France tombe à ses pieds. Le gouvernement sera balayé ! Je vous quitte à présent, mes belles amies. Sans adieu d’ailleurs. Nous nous reverrons à Notre-Dame, le jour du sacre…
Il sortit en courant emporté par sa fougue et par sa foi en l’avenir. Les deux femmes l’accompagnèrent jusqu’au perron, le regardèrent se mettre en selle puis agitèrent une dernière fois la main quand il franchit le portail. On entendit décroître, dans la rue, le claquement des sabots de son cheval. Félicia rentra la dernière. Elle était songeuse.

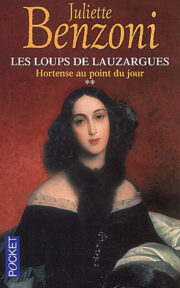
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.