— Le plus simple est d’en acheter en ville. Nous allons en charger Timour.
— Encore fallait-il retrouver d’abord Timour. Livré à lui-même, le Turc avait senti, à la proximité de la mer, se réveiller une ancienne passion qu’il avait beaucoup pratiquée dans son pays et à Venise : la pêche à la ligne. Ce talent lui avait valu la considération d’un patron pêcheur dont il avait achevé la conquête par une station prolongée dans un cabaret du port. En échange, son nouvel ami l’avait initié aux délices du cidre.
C’est dire qu’il était tard quand il reprit enfin le chemin de l’hôtel où Félicia lui réserva un accueil plutôt frais. Mais, apprenant que la nouvelle connaissance était pêcheur et possédait un petit bateau, la Romaine se radoucit.
— Arrange-toi, demain matin, pour acheter quelques bouteilles de vin que tu mettras dans la voiture. Nous partirons de bonne heure.
Timour essaya bien d’expliquer à sa maîtresse que le cidre était une boisson digne des dieux, il se fit rabrouer vertement : du vin, bon autant que possible, et rien d’autre !
Le lendemain, les deux femmes habillées comme il convient pour une partie de campagne – robes claires, chapeaux de paille et ombrelles plus, bien entendu, leur matériel de peinture – quittaient l’hôtel de Bourbon suivies de Timour chargé d’un lourd panier contenant le repas et des encouragements de leur hôtesse.
— Vous aurez beau temps, leur prédit-elle. Je vous ai préparé un bon déjeuner mais gardez-moi tout de même un peu d’appétit pour ce soir : vous aurez du homard.
Le temps était beau, en effet, avec cette brume légère qui sur la mer annonce la chaleur. On suivit le chemin indiqué par Duchamp et, après le quai du Léon, la voiture s’engagea dans l’étroit chemin côtier qui menait à Carantec. Les ornières n’y manquaient pas et l’on ne pouvait pas aller très vite mais ce sentier, qui parfois plongeait entre deux haies d’ajoncs jaunes et d’autres fois laissait voir la mer d’un joli bleu argenté, ne manquait pas de charme. On traversa une lande coupée de petits champs de seigle ou de navets. Parfois aussi, c’était de l’herbe rase où pâturaient des chevaux d’une belle race vigoureuse. Les chapelles étaient nombreuses et aussi les calvaires aux croisées de chemins. Les hirondelles volaient haut dans le ciel mais on pouvait apercevoir les taches blanches des mouettes posées sur l’eau calme. La mer ressemblait à un lac immense tant elle était unie et l’air vif sentait bon l’iode et le varech. On ne rencontra presque personne car les maisons étaient rares.
Sur son siège, Timour sifflait à pleins poumons en homme qui sait apprécier une belle journée mais, dans la voiture, les deux femmes gardaient le silence, tout leur entrain factice du départ envolé.
Assise dans son coin de berline, Hortense réfléchissait. On n’avait toujours reçu aucune nouvelle de Patrick Butler. Le silence de l’armateur était incompréhensible… à moins qu’il ne se comprît que trop bien. Rouen l’aîné de même que Buchez devaient s’illusionner sur les convictions profondes de cet homme. Il appartenait sans doute à cette catégorie d’individus qui ménagent la chèvre et le chou et qui, supportant mal un gouvernement détesté mais fragile, s’efforcent de se créer des amis chez les opposants sans pourtant aller jusqu’à prendre des risques. Il est toujours facile d’être héroïque en paroles mais quand on se trouve au pied du mur l’escalade paraît parfois trop rude, trop dangereuse. Il est vrai que la silhouette noire de la Junon et les soldats que l’on pouvait voir arpenter les quais n’avaient rien de rassurant…
D’une certaine manière, la démission de Butler apportait à Hortense une sorte de soulagement mais elle se le reprochait. Le garçon que l’on gardait si bien avait perdu la liberté à cause d’elle. Poussé par sa générosité et son amour de la vérité, il avait osé la crier en face d’une foule, simplement pour qu’une orpheline eût un peu moins de peine. Et, depuis plus de deux ans, il payait cette superbe folie…
La route venait de dépasser une nouvelle chapelle et, traversant un espace de lande nue, faisait un coude dévoilant un large paysage marin brutalement coupé par la silhouette trapue, grise et courte mais redoutable d’un antique château de mer. Couché sur le miroir bleu, il ressemblait à quelque bête maléfique, mythique et monstrueuse… Le visage de Félicia se figea.
— Le voilà ! dit-elle d’une voix enrouée. Peut-on vraiment se dire homme et oser enfermer son semblable dans pareil endroit ?
— Nous l’en tirerons, Félicia. Nous sommes là pour cela…
— Je resterai ici le temps qu’il faudra. Si notre entreprise ne réussit pas, je trouverai une maison, une chaumière dans cet endroit mais j’y resterai, attendant, guettant une occasion. Oh, mon Dieu ! Je n’imaginais pas que sa prison pût être ce pavé malsain. Regardez, Hortense : il est au ras de l’eau. Qu’en est-il lorsque vient le temps des tempêtes ?…
— Calmez-vous, mon amie. Le soleil brille et nous ne renoncerons pas. Si ce Butler que le Diable emporte continue à se terrer peureusement et refuse de nous aider, nous nous en passerons. Il suffira peut-être de voler une barque pour gagner, faute de l’Angleterre, un autre point de la côte, moins surveillé. Nous pourrions conduire votre frère à Nantes et de là trouver un bateau qui vous mènerait tous deux en Italie… Enfin, nous avons avec nous quatre hommes forts et résolus. C’est une chance dont il faut se servir à tout prix…
A mesure qu’elle parlait, le front de Félicia se détendait. Elle trouva finalement un sourire.
— Pardonnez-moi cette faiblesse, Hortense ! Vous avez raison : il ne faut jamais jeter le manche après la cognée…
On eut quelque peine à trouver la pointe de Pen-Lann indiquée sur le plan. Elle était couverte d’un bois de pins maritimes qu’aucune route ne traversait. Seulement de petits sentiers dans lesquels il était impossible de faire passer la berline. Timour, après une reconnaissance à pied, l’approcha le plus qu’il pouvait puis transporta les provisions jusqu’à une plate-forme rocheuse, suffisamment découverte pour que rien ne vînt gêner la vue. Le château du Taureau était là, tout près. Un étroit bras de mer le séparait de la terre ; au milieu, s’interposait un îlot, simple caillou portant un petit phare qui ressemblait à un jouet et une maisonnette couverte de pierres plates.
On distinguait chaque détail de la forteresse : la grosse tour ronde entre deux courtines abruptes, les casemates, le pont-levis placé sur le côté le plus étroit et que l’on abattait de jour sur une maçonnerie servant de débarcadère, l’échauguette sur la plate-forme où l’on voyait briller les canons et les armes des sentinelles. Félicia se laissa tomber dans l’herbe courte avec assez de grâce pour qu’un observateur crût qu’elle s’asseyait. En fait, elle sentait ses jambes se dérober sous elle. A cette distance rapprochée, le Taureau apparaissait tel qu’il était : brutal. Une bête de combat mais aussi un tombeau dressé sous le soleil.
— Quatre hommes ! Quatre hommes seulement pour venir à bout de ça, gémit Félicia. Nous n’y arriverons jamais…
— Où est votre bravoure, Félicia ? Ne m’avez-vous pas dit cent fois qu’il ne faut jamais s’avouer vaincu ? C’est l’heure de la bataille, il me semble, pas celle des soupirs !
Le ton ferme d’Hortense fit merveille. Félicia se releva, tête haute…
— Vous pourriez bien avoir raison : je suis en train de me conduire comme une imbécile. Au travail !
Avec une sorte d’entrain, elle entreprit d’installer le chevalet pliant et ouvrit la boîte de couleurs tandis que Timour étalait à terre une nappe blanche et qu’Hortense commençait à déballer les provisions. Il y avait du poulet froid, des petits pâtés, de la salade et un gâteau doré qui embaumait le beurre. Plus, naturellement, deux bouteilles de vin que Timour alla tirer du coffre.
— C’est peut-être un peu beaucoup ? dit Hortense.
— Ce n’est certainement pas pour nous seules… Ah ! on nous a vues…, ajouta-t-elle avec satisfaction.
En effet, l’agitation que menaient ces femmes en amples robes claires, avec leur nappe, leur chevalet et l’espèce d’atmosphère de fête champêtre qui les enveloppait n’était pas passée inaperçue. Sur la plate-forme du château les soldats avaient arrêté leur lente promenade et, au pied du phare, dans la petite île, un homme regardait lui aussi, bras croisés. Mais, insoucieuses de l’intérêt ainsi soulevé, Hortense et Félicia décidant qu’il était temps de déjeuner s’installèrent sur l’herbe pour attaquer leur repas. Elles avaient à peine mordu dans les petits pâtés qu’une voix joyeuse se faisait entendre dans le bois, chantant à pleins poumons :
Le corsaire le Grand Coureur
Est un navire de malheur
Quand il part en croisière
Pour aller chasser l’Anglais
Le vent, la mer et la guerre
Tournent contre le Français…
Quelques secondes plus tard, la voix était toute proche et l’apparition la plus étonnante se manifestait sur le sentier qui menait au bas des rochers : un jeune homme blond au visage ouvert, chapeau noir crânement planté sur l’oreille, la canne à la main et le sourire aux lèvres, aussi élégant et tiré à quatre épingles que s’il se rendait chez une dame au lieu d’arpenter un coin de lande au bord d’une mer sauvage. Il eut, en découvrant les deux femmes, un geste de surprise, un peu excessif peut-être, l’un de ces gestes comme en ont les acteurs sur un théâtre. Un peu excessif aussi le ton de sa voix quand, se découvrant d’un geste large, il proclama :
— Que d’excuses, mesdames, si j’ai pu vous effrayer. J’ai nom François Boucher, clerc en l’étude de maître Leray, notaire à Nantes…
CHAPITRE VIII

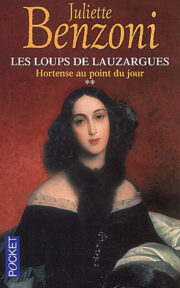
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.