Elle trouva son amie au jardin, assise sous la tonnelle aux clématites en compagnie de Mme Morizet et bavardant avec elle comme si elle la connaissait depuis toujours.
— Venez vite ! s’écria la vieille dame en l’apercevant. Vous avez une visite… et une charmante visite, je dois dire !
— Y a-t-il longtemps que vous êtes là, Félicia ?
— Non… J’arrive seulement ! Mais en voilà un accueil… et une mine ! Vous êtes toute pâle…
— C’est vrai, mon enfant, s’écria Mme Morizet. Vous voilà toute défaite ! Je vais vite vous chercher un cordial.
— N’en faites rien, je vous en prie… Je vais déjà mieux… J’ai couru, voilà tout !…
Déjà l’aimable femme se hâtait en direction de la maison tandis qu’avec un soupir Hortense se laissait tomber sur le banc auprès de son amie. Félicia fronça les sourcils :
— Enfin, Hortense que vous arrive-t-il ? Moi qui venais vous apporter de bonnes nouvelles, je vous retrouve avec l’air de quelqu’un qui a vu le diable !
— C’est un peu ça… Donnez-moi vite vos bonnes nouvelles. Ce sera pour moi le meilleur des cordiaux…
— Je me le demande… Enfin voilà : d’abord le marquis de Lauzargues est reparti depuis trois jours…
— Vous en êtes certaine ?
— Tout à fait. Depuis notre rencontre au théâtre, j’avais posté Gaetano, mon cocher, en faction rue de la Chaussée-d’Antin. Il avait trouvé moyen de se lier d’amitié avec l’une des femmes de chambre et par elle il a réussi à savoir ce qui se passait à l’hôtel de Berny. Il y a trois jours, Gaetano, que cette fille avait prévenu sans d’ailleurs s’en rendre compte, a pu assister au départ du marquis. Il a vu empiler des bagages dans une grande « dormeuse »[8] et le marquis lui-même s’y embarquer. La chose ne fait aucun doute : il retourne à Lauzargues…
— C’est une bonne nouvelle, en effet, mais alors je voudrais bien savoir ce que faisait par ici, tout à l’heure, le séide du prince San Severo…
Et Hortense raconta l’inquiétante rencontre qu’elle venait de faire. Elle dit aussi sa peur et l’incertitude où elle se trouvait à présent quant à la conduite qu’il convenait de tenir.
— Ces gens ne reculent devant rien, vous le savez, et pour rien au monde je ne voudrais mettre cette excellente Mme Morizet en danger. Ce qui ne manquerait pas de se passer si l’on me découvrait chez elle… Il faudrait peut-être que je parte encore. D’autre part, elle s’est attachée à Étienne et, chez elle, le petit est si bien ! Où l’emmener ? Où le cacher ?… Je ne sais pas… Je ne sais plus…
Accablée, elle laissa tomber sa tête dans ses mains et ferma les yeux. Il y eut un silence. Félicia réfléchissait.
— Ce n’est pas lui qu’il faut cacher, dit-elle au bout d’un moment. Lui n’est qu’un enfant et un enfant que personne ne recherche puisque le marquis ignore encore qu’il a été enlevé de chez la nourrice. Il n’y a donc pour lui aucun danger à rester ici si cette dame qui me paraît charmante veut bien vous le garder. Quant à vous…
— Si le marquis est parti, je pourrais peut-être retourner rue de Babylone ? Votre maison ne doit plus être surveillée ?
— Elle ne l’est plus. Le stratagème imaginé par la duchesse a parfaitement réussi. Lydia a porté ostensiblement une lettre. Un inconnu l’a bousculée et la lui a arrachée… Deux jours plus tard le marquis partait.
— C’est cela, je pense, votre seconde bonne nouvelle ?
— Il y en a une troisième : je sais où est mon frère.
Un tel triomphe sonnait dans la voix de Félicia qu’Hortense, malgré ses angoisses, ne put s’empêcher de sourire.
— Vous en êtes certaine ?
— Tout à fait. Notre « bon cousin » Rouen l’aîné qui est chargé de la Bretagne a enfin retrouvé sa trace et en a averti Buchez qui m’a prévenue : Gianfranco est enfermé au large de Morlaix dans une forteresse que l’on appelle le château du Taureau et il est vivant. Alors, moi je vais partir.
— Partir ?… oui, je comprends, vous voulez être plus près de lui ?
— Non. Je veux le faire évader. Le colonel Duchamp désire m’accompagner ainsi que deux de nos camarades. Et naturellement je compte emmener mes gens. Mais si vous souhaitez revenir rue de Babylone, je vous laisserai Timour. De toute façon, Lydia y restera et gardera la maison. C’est l’une des raisons de ma visite : je venais vous dire au revoir… sinon adieu et vous porter un peu d’argent…
— C’est une aventure insensée, Félicia ! Comment espérez-vous venir à bout d’une forteresse… et en pleine mer ?
— Je ne sais pas encore mais je veux au moins essayer. Je n’ignore pas que c’est une aventure folle mais comprenez-moi, mon amie : l’Autriche m’a déjà pris un époux. Je ne veux pas accepter sans combattre que la France me prenne mon frère. C’est tout… ce qu’il me reste.
Une émotion soudaine la saisit à la gorge et Hortense, bouleversée, vit, pour la première fois, de lourdes larmes rouler sur le beau visage de son amie. Doucement, Hortense posa une main sur les siennes et murmura :
— En ce cas, il serait criminel de vous priver de cette force de la nature que vous appelez Timour. Quant à moi… eh bien, le mieux serait peut-être que j’aille avec vous si Mme Morizet veut bien se charger d’Étienne ?
La stupeur sécha d’un seul coup les larmes de Félicia.
— Vous êtes folle, Hortense ? Savez-vous ce que l’on risque à aider un prisonnier à s’évader ? Vous pourriez y perdre la liberté et peut-être même la vie. Que je courre cette chance pour mon frère, c’est normal. Mais vous ? Il faut songer à votre fils !
— J’y songe mais sera-t-il plus heureux si sa mère est assassinée un jour prochain par les sbires de San Severo ! S’ils me cherchent, ils me trouveront et alors ils trouveront également mon petit Étienne… dont je ne suis pas sûre qu’ils l’épargnent. Le prince pourrait souhaiter ne partager ma fortune avec personne.
— N’exagérez pas ! Le marquis est son ami, son complice sans doute. Mais…
— Il arrive que les loups se mangent entre eux quand la faim ou la rage sont trop fortes. C’est dit, Félicia : je pars avec vous. Ce serait bien le Diable si l’on me trouvait au fond de la Bretagne… Attendez-moi ici un moment !…
Mme Morizet revenait armée d’un flacon et d’une grande cuillère. Hortense alla vers elle et, la prenant par le bras, l’entraîna à l’écart de la tonnelle jusque dans le potager. Là elle s’arrêta, sûre que personne ne pourrait les entendre sinon les grenouilles du petit ruisseau.
— Vous aimez Étienne, n’est-ce pas ?
Tout de suite des larmes montèrent aux yeux de la vieille dame. Elle joignit les mains :
— Vous… vous ne songez pas à me l’enlever ? Oh, ma chère enfant… quelque chose me dit que vous allez partir !
— C’est vrai… Non, n’ayez pas de peine, ajouta Hortense très vite en voyant une larme couler sur les douces joues ridées. Je voulais seulement vous demander de me garder mon bébé. Là où je vais, je n’en saurais que faire… Et puis, il est si heureux chez vous…
Par une fenêtre ouverte, on entendait en effet l’enfant gazouiller. C’était l’heure où Jeannette lui donnait son bain et le petit adorait barboter.
Les yeux inquiets de Mme Morizet dévisagèrent Hortense.
— Vous allez courir un danger, n’est-ce pas ? Je le sens…
— Peut-être mais ne vous tourmentez pas trop. Si vous acceptez de garder Étienne…
— J’espère que vous n’en doutez pas un seul instant ? Je garde le petit et sa nourrice, bien sûr, et je les garderai tout le temps que vous voudrez. Je n’ai pas eu d’enfants mais, grâce à lui, j’ai l’illusion d’avoir un petit-fils. C’est délicieux !
— Vous êtes vraiment bonne. Naturellement, je vais vous remettre notre pension pour quelques mois et…
Mme Morizet eut un geste qui coupait court à ce genre d’entretien :
— Plus un mot là-dessus ! Vous aurez besoin de tout votre argent… Et puis est-ce que l’on fait payer son petit-fils ? Allez en paix, ma chère enfant, votre petit Étienne ne manquera de rien. Pas même de tendresse. Surtout pas de tendresse…
D’un élan spontané, Hortense embrassa la vieille dame. Puis :
— Étant donné ce que vous faites pour nous, je vous dois la vérité. Je ne comprends pas d’ailleurs que, vous connaissant, M. Vidocq vous l’ait cachée.
Cette fois, Mme Morizet se mit à rire :
— Quelle vérité ? Que vous n’êtes pas Mme Coudert, petite bourgeoise de Saint-Flour ? Ma chère enfant, il y a longtemps que je le sais. Comme on aurait dit sous cette affreuse Révolution, vous sentez l’aristocrate à quinze lieues…
— Eh bien, j’espère que vous êtes la seule à posséder un odorat aussi fin. Je m’appelle Hortense de Lauzargues. Cependant la plus grande partie de ce qu’on vous a dit est vraie : je suis veuve et je fuis mon beau-père qui veut me priver de mon enfant. Or j’ai lieu de croire que ma trace a pu être relevée jusqu’à Saint-mandé. Mon fils, lui, ne craint rien. Quant à moi il vaut mieux que je parte. Je vais aider mon amie, la comtesse Morosini, à sauver, si elle le peut, son frère.
— Alors, allez vite vous préparer… mais tâchez de nous revenir encore plus vite. Je désire que vous considériez désormais cette maison comme la vôtre. Vous y serez toujours accueillie… comme ma propre enfant.
Le bagage d’Hortense ne demanda pas beaucoup de temps. Il en fallut un peu plus pour les adieux au petit Étienne. Hortense, le cœur navré, ne se lassait pas d’embrasser son fils entrecoupant ses baisers de chaleureuses recommandations à l’adresse de Jeannette qui pleurait un peu mais n’en jura pas moins d’exécuter point par point toutes les recommandations de sa maîtresse.

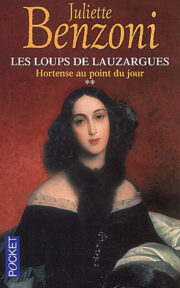
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.