Le lit était venu de France avec elle. Depuis plus de deux siècles, il constituait un refuge parfait, à la fois commode et discret, pour ce joyau royal quand le besoin s’en faisait sentir. Ainsi, il avait traversé la Révolution sans que personne se doute de sa présence.
Par piété filiale autant que pour le plaisir de l’avoir toujours sous la main, Isabelle le conservait là. Elle ne s’en parait pas, trouvant la pierre trop importante et trop lourde pour la minceur de son cou. En revanche, elle aimait à le tenir dans ses mains pour chercher à retrouver la chaleur de ces autres paumes évanouies qui l’avaient caressé, jusqu’à celles du roi barbare à cheveux plats dont il ornait le diadème.
La colonne ouverte, le sachet tombait presque de lui-même, cependant cette fois rien ne vint : la cachette était vide...
Le cœur de Morosini manqua un battement tandis que ses longs doigts fouillaient la cavité mais il ne trouva rien et se laissa tomber sur le lit, la sueur au front. Où était passé le saphir ? Vendu ? Impensable. Massaria l’aurait su. Or il avait été affirmatif : la pierre était toujours au palais. Alors ? Sa mère aurait-elle jugé bon de le changer de place ? Aurait-elle préféré une autre cachette ?
Sans y croire, il procéda à une fouille rapide des divers meubles dont aucun n’offrait la sécurité de l’ancienne cache pratiquée par un ébéniste de génie. Il ne trouva rien, revint vers le lit dont il ausculta chaque partie. L’idée lui vint alors que, se sentant mourir, sa mère aurait pu vouloir tenir la pierre une dernière fois et que, d’un geste affaibli, elle l’aurait laissé tomber sans pouvoir la retenir...
Alors, ôtant les tables de chevet, il tira le lit pour le décoller du mur, s’agenouilla et s’aplatit sur le tapis pour explorer le dessous du meuble, si pesant qu’il n’avait pas dû être déplacé depuis son installation.
Quand il eut le nez au ras du sol, l’odeur douceâtre qu’il avait remarquée en pénétrant dans la chambre s’accentua. Apercevant alors un objet qui pouvait être le sac de peau, il engagea son bras jusqu’à l’épaule et réussit à ramener... une souris morte qu’il allait rejeter avec dégoût lorsque quelque chose retint son attention : le corps menu était raide, presque desséché, mais la gueule retenait encore un morceau rougeâtre qu’il identifia aussitôt. C’était un fragment d’une de ces pâtes de fruit à la framboise que sa mère adorait et qu’on lui envoyait de France. Il y en avait toujours quelques-unes dans la bonbonnière de Sèvres posée à son chevet. Il souleva le couvercle de porcelaine dorée : fa boîte était à demi pleine.
Aldo aimait beaucoup lui aussi ces confiseries qui avaient sucré son enfance. Il en prit une dans l’intention de la déguster mais, au même instant, son regard tomba sur le cadavre de la souris. Envahi d’une idée bizarre, il suspendit son geste. C’était une idée insensée, abracadabrante, mais plus il essayait de la chasser et plus elle s’accrochait. Se traitant d’imbécile, il approcha de nouveau le bonbon de ses lèvres mais, comme si une main invisible s’était posée sur son bras, il s’arrêta encore.
– Je dois être en train de devenir fou, marmotta-t-il, mais il savait déjà qu’il ne toucherait pas à cette pâte soudain suspecte. Alors, marchant jusqu’à un secrétaire de marqueterie, il y prit une enveloppe, y déposa la souris, le petit morceau et la framboise intacte, fourra le tout dans sa poche, alla chercher un manteau et dégringola l’escalier en annonçant à Zaccaria qu’il avait une course à faire.
– Et mon déjeuner ? protesta Cecina apparue comme par enchantement.
– Il n’est pas encore midi et je n’en ai pas pour longtemps, je vais chez le pharmacien.
Elle prit feu tout de suite :
– Qu’est-ce que tu as ? Tu es malade ? ... Dio mio, je me disais aussi...
– Mais non, je ne suis pas malade. J’ai simplement envie d’aller dire bonjour à Franco.
– Bon, alors si c’est ça, rapporte-moi du calomel !
Admirant l’esprit pratique de sa cuisinière, Morosini quitta son palais par une porte de derrière et, à pied, gagna rapidement le Campo Santa Margherita où Franco Guardini tenait boutique. C’était son plus ancien camarade. Ils avaient fait ensemble leur première communion après avoir ânonné de concert les grands principes de l’Église sur les bancs du catéchisme.
Fils d’un médecin de Venise fort réputé, Guardini aurait dû suivre la trace de son père au lieu de devenir boutiquier comme celui-ci, indigné et un peu méprisant, le lui avait un jour jeté à la figure mais, passionné de chimie et de botanique alors que les corps de ses semblables ne lui inspiraient qu’un dégoût à peine dissimulé, Franco avait tenu bon même quand le professeur Guardini, tel un ange exterminateur barbu, l’avait chassé de chez lui après une assez vive altercation. Et c’est grâce à la princesse Isabelle, qui appréciait ce garçon sérieux et réfléchi, que Franco avait pu poursuivre ses études jusqu’à ce que la mort de son irascible père l’eût mis en possession d’une confortable fortune. Il avait alors remboursé jusqu’à la dernière lire, mais la reconnaissance qu’il vouait à sa bienfaitrice tenait de la vénération.
Il accueillit Morosini avec le lent sourire qui était, chez lui, le signe d’une joie extravagante, lui serra la main, lui tapa sur l’épaule, s’enquit de sa santé puis, comme s’il l’avait quitté la veille, lui demanda ce qu’il pouvait faire pour lui.
– L’idée que j’aie pu avoir l’envie de te revoir ne t’effleure même pas ? fit Aldo en riant. Mais si tu veux que nous parlions, emmène-moi dans ton cabinet.
D’un signe de tête, le pharmacien invita son ami à le suivre et ouvrit une porte prise dans la boiserie ancienne de son magasin. Une pièce apparut, réduite de moitié par les bibliothèques dont elle était entourée. Au milieu, un petit bureau flanqué de deux sièges. Le tout dans un ordre impressionnant.
– Je t’écoute ! Je te connais trop bien pour ne pas voir que tu es soucieux.
– C’est simple... ou plutôt non, ce n’est pas simple et je me demande si tu ne vas pas me prendre pour un fou, soupira Morosini en sortant son enveloppe et en la posant devant lui sur la table.
– Qu’est-ce que tu m’apportes là ?
– Regarde toi-même : je voudrais que tu m’analyses ça !
Franco ouvrit le petit paquet et examina le contenu.
– Ça vient d’où ?
– De la chambre de ma mère. C’était sous le lit. Je t’avoue que cette bestiole morte avec, dans la gueule, un morceau de ces pâtes de fruit qu’elle aimait m’a fait un effet bizarre. Je suis incapable de te dire ce que j’ai ressenti, mais une chose est certaine : quand j’ai voulu manger l’un des bonbons restés dans sa boîte quelque chose m’en a empêché.
Sans commentaires, Franco prit le tout et passa dans la pièce voisine qui était son laboratoire privé, celui où il se livrait à des recherches et à des expériences qui n’avaient pas toujours à voir avec la pharmacie. Morosini était venu souvent dans cette salle qu’il appelait « l’antre du sorcier » et où il avait pris la défense des souris et des cobayes que son ami gardait pour ses expériences mais, cette fois, il ne protesta pas quand le pharmacien alla chercher l’une de ses pensionnaires qu’il posa sur une table où il alluma une lampe puissante. Puis, à l’aide d’une pince minuscule, il fit manger à la souris le fragment trouvé sous le lit. La bestiole grignota la pâte sucrée avec un plaisir évident mais, quelques minutes plus tard, elle expirait sans souffrance apparente. Par-dessus ses lunettes, Franco regarda son ami devenu soudain aussi blanc que sa chemise.
– Tu n’es peut-être pas si fou que ça, après tout ? Voyons la suite !
À une autre souris, il fit manger la pâte rouge que Morosini n’avait pas absorbée, et, cette fois encore, l’animal passa tout bonnement de vie à trépas.
– Ce sont les confiseries que la princesse Isabelle gardait dans sa chambre ?
– Oui. Son péché mignon. Nous en avons mangé pas mal quand nous étions gamins. Je n’arrive même pas à comprendre comment elle pouvait s’en procurer encore pendant la guerre.
– Elle les faisait venir du midi de la France et apparemment elle n’a jamais eu de difficultés. Tu devrais aller me chercher le reste de ces sucreries. Pendant ce temps, je vais essayer de savoir de quoi sont mortes les souris...
– Entendu, mais je ne reviendrai qu’après déjeuner sinon Cecina va me faire un scandale. Tu penses bien qu’elle m’a préparé un festin. À propos... tu ne veux pas venir le manger avec moi ?
– Non, merci. Cette histoire m’intrigue et m’a coupé l’appétit.
– Je n’ai pas très faim non plus... Ah, j’allais oublier ! Veux-tu me donner du calomel pour Cecina ?
– Encore ? Mais elle en fait des tartines, ma parole ?
Néanmoins, il emplit un petit flacon de chlorure mercureux en poudre :
– Tu diras à cette grosse gourmande que si elle mangeait moins de chocolat, elle n’aurait pas si souvent besoin de ça...
Un quart d’heure plus tard, Morosini, l’appétit coupé et l’esprit ailleurs, s’attablait devant le fastueux repas de Cecina.
Le déjeuner à peine fini, il déclara en se levant de table qu’il avait besoin d’aller marcher un peu, après quoi il s’en irait rendre visite à sa cousine Adriana. Zian devrait tenir la gondole prête pour quatre heures.
Un moment plus tard, avec le reste des pâtes de fruit, il se retrouvait dans le laboratoire de Guardini. La mine de celui-ci, toujours si sereine, avait subi une curieuse transformation. Derrière les verres brillants de ses lunettes, son regard était soucieux et de grands plis se creusaient sur son front. Morosini n’eut même pas le temps de poser une question.
– Tu as le reste ?
– Voilà. J’ai fait deux paquets, l’un avec ce qu’il y avait dans l’armoire et l’autre avec le reliquat de la bonbonnière.

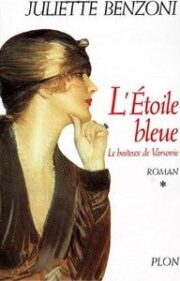
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.