– Je dirais même plus ! C’est non seulement intelligent, mais en cela votre intérêt rejoint celui de ma famille. Que veut mon père ? Que j’épouse sir Eric Ferrais qui, à la veille de nos noces, signera un contrat m’assurant une belle fortune, et je n’ai aucune raison de lui refuser cette joie. Le pauvre a besoin d’argent !... D’autre part, moi, je ne veux à aucun prix appartenir à ce vieil homme. Je ne veux pas qu’il me déshabille, qu’il mette sa peau contre la mienne... Quelle horreur !
Réduit au silence par les plans d’avenir de la jeune Polonaise et le réalisme décrivant sa nuit de noces, Aldo réussit tout juste à émettre un « Et alors ? » un peu enroué.
– Alors ? Le mariage doit avoir lieu dans un château à la campagne mais en grande pompe. Il y aura beaucoup d’invités au dîner qui suivra la cérémonie et au feu d’artifice. Vous, vous n’aurez qu’à m’attendre au fond du parc avec une voiture rapide. Je viendrai vous rejoindre et nous partirons tous les trois.
– Tous les trois ?
– Bien sûr ! Vous, moi... et le saphir. Votre saphir, notre saphir ! Enfin celui que vous réclamez. Comme je ne saurai jamais à qui il appartient au juste, c’est, je crois, la meilleure manière de tout régler : il sera à nous, un point c’est tout.
– Parce que vous supposez que Ferrais va l’emporter à la campagne
– Je ne suppose pas : je sais. Il ne veut plus s’en séparer et comme il y aura réception après le mariage civil, la veille, j’y porterai une robe couleur de lune comme dans Peau d’Âne avec l’Étoile bleue comme seul ornement. On prépare la robe et rien ne sera plus facile !
– Ah ! vous croyez ? Mais, pauvre innocente, à peine aurez-vous disparu que votre Ferrais n’aura qu’une hâte – surtout si le saphir est parti avec vous ! – demander l’annulation, et votre cher papa n’aura même pas un centime.
– Oh ! mais si ! Et plus que vous ne croyez ! Nous nous arrangerons pour que j’aie l’air d’avoir été enlevée par des bandits qui réclameront une rançon. Nous laisserons un billet dans ce sens derrière nous. On me cherchera partout et, comme on ne me retrouvera pas, on croira que mes ravisseurs m’ont tuée. Tout le monde sera très triste et sir Eric ne pourra pas faire autrement que pleurer et essayer de consoler les miens... Pendant ce temps-là, nous serons heureux tous les deux, conclut Anielka avec simplicité. Que pensez-vous de mes idées ?
Revenu de sa stupeur mais incapable de se contenir plus longtemps, Morosini éclata de rire :
– Je pense que vous lisez trop de romans ou que vous avez une imagination débordante... ou les deux. Mais surtout que vous faites trop bon marché de l’intelligence des autres. Ferrais est un homme puissant : à peine vous aurai-je emportée sur mon fougueux destrier que nous aurons à nos trousses la maréchaussée du royaume. Les frontières et les ports seront gardés...
– Sûrement pas ! Dans la lettre que nous laisserons, nous expliquerons que l’on pourrait me tuer si la police était prévenue.
– Vous avez réponse à tout... ou presque tout ! Vous n’oubliez qu’une chose : vous-même !
Anielka ouvrit de grands yeux incompréhensifs :
– Que voulez-vous dire ?
– Que vous êtes sans doute l’une des femmes les plus ravissantes d’Europe et que, devenue princesse Morosini, vous serez sur un piédestal autour duquel Venise s’agenouillera. Votre renommée dépassera les frontières et pourrait bien atteindre les oreilles de vos prétendus désespérés. Ils auront tôt fait de nous retrouver et alors adieu le bonheur !
– Serait-ce moins grave si je partais ce soir avec vous comme vous le demandiez ? Croyez-moi, vous n’avez rien à craindre ! Et même, si vous voulez une preuve, faites de moi votre maîtresse avant le mariage. Demain... le jour que vous voudrez je vous appartiendrai.
Il eut un éblouissement, follement tenté soudain de lui obéir, de la prendre dans un coin de grotte ou dans la forêt vierge miniature. Heureusement, la raison lui revint. C’était déjà enivrant de savoir qu’un jour prochain elle serait sienne...
– Non, Anielka. Pas tant que Ferrais sera entre nous. Quand nous serons l’un à l’autre, ce sera en toute liberté et pas en cachette. Et, à propos de votre départ, j’aimerais mieux que vous renonciez à cette histoire de rançon malhonnête. Je ne peux l’accepter.
– N’est-ce pas cependant la seule façon de détourner de vous les soupçons ?
– Il doit y en avoir une autre. Laissez-moi y penser et revoyons-nous bientôt ! Maintenant, il est temps de nous séparer. Votre Wanda doit avoir englouti le fonds de commerce du marchand de gaufres...
– Comment faire pour vous donner un autre rendez-vous ?
– J’habite chez votre voisine, la marquise de Sommières, qui est ma grand-tante. Faites glisser un mot dans sa boîte aux lettres. J’irai où vous voudrez...
Il ponctua cette affirmation d’un baiser léger sur le bout du nez de la jeune fille, puis l’écarta de lui avec douceur :
– À mon grand regret, il me faut vous rendre votre liberté, mon bel oiseau de paradis !
– Déjà ?
– Eh oui ! Je suis de votre avis : il sera toujours trop tôt pour vous quitter...
Avec la curieuse – et désagréable ! – impression d’être échec et mat, Aldo garda le silence. Elle avait raison. L’énormité de son projet l’avait contraint à se faire l’avocat du diable, mais ce qu’il venait de proposer sous l’aiguillon d’une soudaine poussée de passion était tout aussi insensé. D’autre part, ne valait-elle pas la peine de courir les plus grands risques, cette exquise créature venue à lui avec des mots d’amour ? Il se faisait l’effet d’être une espèce de Joseph précautionneux en face d’une jeune et adorable Mme Putiphar. En un mot, il se jugea ridicule. Sans compter que, dans ce plan délirant – en apparence tout au moins ! – résidait peut-être la solution de son problème : retrouver le saphir pour Simon Aronov en attendant de partir à la reconquête des autres pierres...
Il se leva, vint prendre la jeune fille par les mains pour la remettre debout et l’enlaça.
– Vous avez raison, Anielka, et je suis un imbécile ! Si vous acceptez de vivre cachée pendant un certain temps, nous avons peut-être une chance de réussir...
– J’accepterai n’importe quoi pour être auprès de vous, soupira-t-elle en posant la petite toque de martin-pêcheur contre le cou d’Aldo.
– Laissez-moi deux ou trois jours pour réfléchir et voir comment nous pourrons nous en tirer au mieux. Soyez sûre que, pour vous, j’aurai toutes les audaces, tous les courages... mais êtes-vous certaine de ne jamais le regretter ? Vous allez renoncer à une vie de reine...
– Pour devenir princesse ? C’est presque aussi bien...
– Si vous deviez reculer au dernier moment, vous me feriez beaucoup de mal, dit-il, soudain très grave, mais elle se haussa sur la pointe des pieds pour poser ses lèvres contre celles de Morosini.
Sur un sourire et un salut à l’orientale, la main sur le cœur, il s’éloignait déjà quand elle le rappela :
– Aldo !
– Oui, Anielka ?
– Encore une dernière chose ! Si vous n’êtes pas là au soir du mariage, si je dois subir l’assaut de sir Eric, je ne vous reverrai de ma vie ! dit-elle avec une gravité qui le frappa. Parce que, si vous me faites défaut, cela voudra dire que vous ne m’aimez pas comme je vous aime. Alors je vous haïrai...
Un instant, il se figea comme s’il voulait graver dans sa mémoire la belle image qu’elle offrait puis, sans rien ajouter, il s’inclina et quitta la grande serre.
En regagnant la rue Alfred-de-Vigny, il s’efforça de remettre de l’ordre dans ses pensées, mais son trouble persistait. Il respirait encore le frais et délicieux parfum d’Anielka, il sentait encore contre ses lèvres la douceur des siennes. Non qu’il gardât le moindre doute sur ses propres sentiments : il était prêt à tout risquer pour cette enfant, à commettre les pires folies pour pouvoir l’adorer à son aise. Cependant, il ne serait vraiment libre que lorsqu’il aurait rempli la mission confiée par Simon Aronov.
« Si je ne devais voir Vidal-Pellicorne tout à l’heure, je me précipiterais chez lui à l’instant ! J’ai grand besoin de mettre les choses au point avec lui. Pour jouer ce coup-là sans déchaîner un cataclysme, nous ne serons pas trop de deux ! »
Il trouva Mme de Sommières en compagnie de Marie-Angéline. Comme d’habitude, la marquise buvait du Champagne dans son jardin d’hiver en écoutant distraitement sa demoiselle de compagnie lui lire une de ces sublimes phrases de Marcel Proust qui époumonent le lecteur parce qu’elles s’étalent sur plus d’une page.
– Ah ! te voilà ! fit-elle avec satisfaction. Il me semble qu’il y a des siècles que je ne t’ai vu. Tu dînes avec nous, j’espère ?
– Hélas non, tante Amélie, fit-il en baisant sa belle main ridée. Je suis attendu par un ami.
– Encore ? J’aurais pourtant bien voulu que tu me racontes ton entrevue avec ce sacripant de Ferrais !... Tu veux une coupe ?
– Non, merci. Je suis seulement venu vous embrasser. À présent, je dois me changer.
– Tant pis ! Dis à Cyprien de te faire préparer cette sacrée voiture à essence qui empeste et ne vaudra jamais un bel attelage d’irlandais !
– Cela m’ennuie de refuser vos présents, mais c’est inutile. L’ami en question habite dans le quartier. Rue Jouffroy. Je vais y aller à pied en traversant le parc...
– Comme tu voudras mais si tu ne rentres pas trop tard, viens bavarder un instant ! Me faire embrasser par toi devient une habitude que j’apprécie infiniment. Plan-Crépin, laissez tomber le divin Marcel et allez dire que l’on serve sans trop tarder ! J’ai une petite faim mais je n’ai pas envie de traîner à table.
Le repas de la marquise était terminé quand Morosini quitta la maison pour rejoindre l’entrée de l’avenue Van-Dyck en contournant l’hôtel Ferrais dont les fenêtres, comme d’habitude, brillaient de mille feux. Aldo envoya mentalement un baiser à la dame de ses pensées puis s’engagea sous les arbres de Monceau avec l’intention de profiter d’une de ces promenades nocturnes chères aux cœurs amoureux.

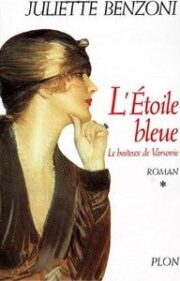
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.