Un bien joli spectacle auquel Aldo se complaisait en écoutant d’une oreille distraite le comte parler de la rupture dramatique, survenue deux mois plus tôt sous la pression des glaces, d’une digue de l’Oder qui avait provoqué de graves inondations dans le nord du pays, ajoutant que c’était une vraie chance que la ligne de chemin de fer n’ait pas été touchée. Ce genre de propos n’appelait guère de réponse et laissait Aldo à sa contemplation. D’autant que de l’Oder le comte, d’un bond acrobatique, passait au Nil et à l’instauration de la royauté dans l’ancienne dépendance de l’empire ottoman désormais sous protectorat britannique. Le tout en se livrant au jeu passionnant de la politique-fiction et des prédictions sur les conséquences éventuelles.
Pendant ce temps, son voisin déplorait la trop visible tristesse d’Anielka. Tenait-elle tellement à ce Ladislas, passionné sans doute mais doué d’un évident mauvais caractère ? C’était aussi impensable que l’union de la carpe et du lapin. Cette fille ravissante et ce garçon quelconque ? Ce ne pouvait pas être bien sérieux...
Solmanski dissertait à présent sur l’art japonais en se réjouissant à l’avance de pouvoir visiter à Paris l’intéressante exposition qui devait avoir lieu au Grand Palais, célébrant avec un lyrisme inattendu chez lui les mérites comparés de la grande peinture de l’époque Momoyama – la plus admirable selon lui – et de celle de l’ère Tokugawa quand, soudain, le cœur d’Aldo battit un peu plus vite. Sous leurs grands cils baissés, les yeux de la jeune fille glissaient vers lui. Les longues paupières se relevèrent, laissant apparaître une poignante supplication comme si Anielka attendait de lui une aide, un secours. Mais de quel ordre ? L’impression fut profonde mais brève. Déjà le fin visage se fermait, retournait à son indifférence...
Lorsque le repas s’acheva, on se sépara en se promettant de se retrouver le lendemain pour le déjeuner. Le comte et sa famille se retirèrent les premiers, laissant Morosini un peu abasourdi par le long monologue qu’il venait de subir. Il s’aperçut alors qu’il n’en savait pas plus qu’avant sur la famille Solmanski et finit par se demander si ce bavardage incessant ne constituait pas une tactique : l’épisode Dianora une fois clos, il avait permis au comte de ne rien dire de lui-même et des siens : quand on ne peut pas placer une parole, les questions deviennent impossibles...
Autour de lui, les serveurs débarrassaient pour préparer le second service. Il se résigna donc à laisser la place, bien qu’il se fût volontiers attardé devant une nouvelle tasse de café. Cependant, avant de quitter le wagon, il arrêta le maître d’hôtel :
– Vous semblez bien connaître le comte Solmanski et sa famille.
– C’est beaucoup dire, Excellence ! Le comte fait assez souvent le voyage de Paris en compagnie de son fils mais en ce qui concerne Mlle Solmanska, je m’avais pas encore eu l’honneur de la rencontrer.
– C’est étonnant. Elle s’est adressée à vous avant le repas comme si elle était l’une de vos habituées ?
– En effet. J’en ai été surpris moi-même. Mais on peut tout accepter d’une aussi jolie femme, ajouta-t-il avec un sourire.
– Je partage votre avis. Il est dommage qu’elle soit si triste. L’idée d’aller à Paris ne semble pas l’enchanter. Dites-moi : en savez-vous un peu plus sur cette famille ? ajouta Morosini en faisant surgir d’un geste de prestidigitateur un billet au bout de ses doigts.
– Ce que l’on peut apercevoir quand on est un oiseau de passage. Le comte passe pour fortuné. Quant à son fils, c’est un joueur invétéré. Je suis certain qu’il est déjà à la recherche de quelques compagnons... auxquels j’oserai vous déconseiller de vous joindre...
– Pourquoi ? Il triche ?
– Non, mais s’il est charmant et d’une grande générosité quand il gagne, il devient odieux, brutal et agressif s’il lui arrive de perdre. En outre, il boit.
– Je suivrai votre avis. Un mauvais joueur est un être détestable.
Non sans regrets d’ailleurs : une partie de bridge ou de poker eût été un agréable passe-temps, mais il était tout de même plus prudent d’y renoncer, se prendre de querelle avec le jeune Solmanski n’étant pas le bon moyen de se concilier sa sœur. Étouffant un soupir, Morosini regagna son single où l’on avait fait le lit pendant son absence. Avec son éclairage électrique adouci par des verres dépolis, sa moquette moelleuse sous les pieds, ses marqueteries d’acajou, ses cuivres brillants et son armoire-lavabo, l’étroite cabine où s’attardait encore l’odeur du neuf et où le chauffage bien réglé entretenait une douce chaleur invitait au repos. Peu habitué à se coucher si tôt, Morosini n’avait pas sommeil. Il choisit de rester un moment dans le couloir pour fumer une ou deux cigarettes.
Non que le paysage fût récréatif : il faisait nuit noire et, en dehors des rafales de pluie qui flagellaient les vitres, on ne voyait rien sinon, par instants, une lampe fugitive, un signal lumineux ou quelques pâles lucioles qui devaient être les feux d’un village. Le conducteur qui sortait d’un compartiment salua poliment son voyageur et lui demanda s’il désirait quelque chose. Aldo eut envie de lui demander où se trouvait logée la famille Solmanski mais pensa aussitôt que cela ne lui servirait à rien et répondit par la négative. Le fonctionnaire en uniforme marron se retira en lui souhaitant une bonne nuit, alla rejoindre le siège qui lui était réservé à l’autre bout du wagon et se mit à écrire dans un grand carnet. À ce moment, plusieurs personnes passèrent bruyamment en se rendant au wagon-restaurant et l’une d’elles, un gros homme en costume à carreaux, déséquilibré par le balancement du train, écrasa le pied de Morosini, bredouilla une vague excuse avec un rire bête et continua son chemin. Dégoûté et peu désireux d’en subir autant au retour, Aldo rentra chez lui, ferma sa porte, tira son verrou et entreprit de se déshabiller. Il passa un pyjama de soie, des pantoufles, une robe de chambre, et ouvrit son armoire-lavabo pour se laver les dents. Après quoi, il s’étendit sur sa couchette pour essayer de lire un magazine allemand acheté en gare qu’il ne tarda pas à trouver d’autant plus assommant qu’il n’arrivait pas à fixer son attention sur les malheurs du deutschmark alors en chute libre. Entre le texte et lui, c’était le regard d’Anielka qu’il revoyait sans cesse. Avait-il rêvé l’appel de détresse qu’il avait cru y lire ? ... Mais en ce cas, que pouvait-il faire ?
À force d’y songer sans trouver de réponse valable, il se laissait gagner par l’assoupissement quand un bruit léger le réveilla. Il tourna la tête vers la porte dont il vit la poignée bouger, s’arrêter, bouger encore comme si la personne qui était derrière hésitait. Aldo crut entendre une petite plainte faible, une sorte de sanglot contenu...
D’un bond silencieux il fut debout, tira le verrou sans faire de bruit et ouvrit d’un coup sec : il n’y avait personne.
Il s’avança dans le couloir où les lumières étaient déjà atténuées, ne vit rien du côté du conducteur qui avait dû s’absenter mais, de l’autre, il aperçut une femme enveloppée d’un peignoir blanc qui s’éloignait en courant. Une femme dont les longs cheveux clairs tombaient presque jusqu’à la taille et qu’il reconnut d’instinct : Anielka !
Le cœur battant, il s’élança sur ses pas, envahi par un espoir fou : se pouvait-il qu’elle fût venue jusque chez lui au risque d’encourir la colère de son père ? Fallait-il qu’elle fût malheureuse car, jusqu’à présent, il doutait beaucoup de lui être seulement sympathique...
Il l’atteignit au moment où, secouée de sanglots, elle s’efforçait d’ouvrir la portière dans l’évidente intention de se précipiter au-dehors.
– Encore ? gronda-t-il. Mais c’est une manie !
Une lutte s’ensuivit, courte parce que trop inégale, cependant Anielka fournissait une défense honorable au point que Morosini hésita une fraction de seconde à la frapper pour la mettre K.-O., mais elle mollit juste à temps pour éviter un bleu au menton.
– Laissez-moi, balbutiait-elle, laissez-moi... Je veux mourir...
– Nous en reparlerons plus tard ! Allons, venez avec moi pour vous remettre un peu... et puis vous me direz ce qui ne va pas.
Il la ramena en la soutenant le long du couloir. Ce que voyant, le conducteur accourut :
– Que se passe-t-il ? Est-ce que mademoiselle est malade ?
– Non, mais vous avez failli avoir un accident ! Allez me chercher un peu de cognac ! Je la ramène chez moi...
– Je vais faire prévenir sa femme de chambre, e est dans la voiture suivante...
– Non... non, par pitié !..., gémit la jeune fille, Je...je ne veux pas la voir !
Avec autant de précautions que si elle eût été en porcelaine, Aldo fit asseoir Anielka sur sa couchette et mouilla une serviette pour lui rafraîchir le visage, puis il lui donna à boire un peu de l’alcool parfumé rapporté par le conducteur avec une célérité digne d’éloges. Elle se laissait faire comme une enfant qui, après une longue errance dans les ténèbres glacées, vient de trouver enfin un endroit chaud et éclairé pour s’y abriter. Elle était ainsi infiniment touchante et aussi jolie que d’habitude, grâce à ce privilège de la grande jeunesse que les larmes n’arrivent pas à enlaidir. Finalement, elle poussa un énorme soupir.
Vous devez me prendre pour une folle ? articula-t-elle.
Pas vraiment. Plutôt pour quelqu’un de malheureux... C’est toujours le souvenir de ce garçon qui vous obsède ?
– Bien sûr... Si vous saviez que vous ne reverrez plus jamais celle que vous aimez, ne seriez-vous pas désespéré ?
– C’est peut-être parce que j’ai vécu, jadis, quelque chose d’analogue que je peux vous dire qu’on n’en meurt pas. Même en temps de guerre !
– Vous êtes un homme et je suis une femme : cela fait toute la différence. Je suis persuadée que

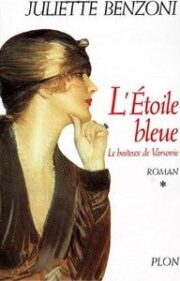
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.