Tous ces points d’interrogation occupèrent la majeure partie d’un dîner dont l’orchestre fit une sorte de douche écossaise en alternant allègres mazurkas et nocturnes déchirants.
Son café avalé – un de ces breuvages infâmes dont les hôtels ont le secret – Aldo regagna le bar où il n’aurait à craindre qu’un pianiste discret et dont l’atmosphère feutrée lui plaisait. Il y avait là quelques hommes qui discutaient à voix retenue, perchés sur de hauts tabourets, en buvant des boissons variées. Lui-même choisit un cognac hors d’âge et passa de longues minutes le ballon de cristal dans la paume à en humer le parfum tout en suivant des yeux les volutes bleutées montant de sa cigarette.
Le verre vidé, il se demandait s’il allait en commander un autre quand le barman qui venait de répondre au téléphone intérieur s’approcha de sa table :
– Monsieur me pardonnera si je me permets de supposer qu’il est bien le prince Morosini ?
– En effet.
– Je dois transmettre un message. Mme Kledermann vient de rentrer et fait dire à Votre Altesse Sérénissime qu’elle se sent trop lasse pour prolonger la soirée et qu’elle s’est retirée...
– Madame qui ? sursauta Aldo avec l’impression bizarre que le plafond venait de lui tomber sur la tête.
– Mme Moritz Kledermann, cette très belle dame que j’ai crue voir converser avant le dîner dans le hall avec Votre Altesse ? ... Elle présente ses excuses mais...
Morosini semblait tellement médusé que le barman, inquiet, se demanda s’il ne commettait pas une bévue, quand, soudain, son interlocuteur parut reprendre vie et se mit à rire :
– Ne vous troublez pas, mon ami, tout va bien !
Et ça irait même encore mieux si vous m’apportiez un autre cognac...
Quand l’homme revint avec la boisson, Morosini lui mit un billet dans la main :
– Sauriez-vous me dire quel appartement occupe Mme Kledermann ?
– Oh oui ! L’appartement royal, bien entendu...
– Bien entendu...
Le supplément d’alcool s’avérait nécessaire, contrairement à ce que l’on pouvait craindre, pour qu’Aldo retrouve son équilibre face à la troisième surprise de la soirée, et non des moindres. Que Dianora se fût remariée ne l’étonnait pas. Même, il en était venu à le supposer. Le faste déployé par la jeune femme, ses bijoux fabuleux – ceux que lui avait offerts le vieux Vendramin étaient moins impressionnants ! – tout laissait supposer la présence d’un homme extrêmement riche. Mais que cet homme fût le banquier zurichois dont maître Massaria lui avait offert la fille en mariage, voilà qui dépassait tout ce qu’on pouvait imaginer ! C’était même à mourir de rire. Qu’il eût accepté, et Dianora devenait sa belle-mère ! De quoi bâtir une tragédie... ou plutôt l’une de ces comédies de boulevard si fort appréciées des Français.
L’aventure étant plutôt amusante, elle méritait bien qu’on la prolonge un peu. Bavarder avec la femme du banquier suisse allait être un moment exaltant !
S’arrachant enfin à son fauteuil, Morosini se dirigea vers le grand escalier qu’il gravit d’un pas nonchalant. Point n’était besoin de s’adresser au portier pour trouver l’appartement royal : c’était l’enfance de l’art pour un habitué des palaces. Parvenu au premier étage, il marcha droit à une imposante double porte à laquelle il frappa en se demandant ce qui pouvait pousser Dianora, voyageant sans doute seule avec une femme de chambre, à s’installer tellement au large. Dans tous les grands hôtels, la suite royale se composait en général de deux salons, quatre ou cinq chambres et autant de salles de bains. Il est vrai qu’elle n’appréciait guère la simplicité...
Une soubrette lui ouvrit. Sans rien lui demander, elle tourna les talons et le précéda dans une antichambre puis un salon meublé en style Empire où elle le laissa. La pièce était majestueuse, les meubles ornés de sphinx dorés étaient de grande qualité et quelques toiles honnêtes représentant des paysages habillaient les murs, mais elle évoquait davantage les réceptions officielles que les causeries intimes. Heureusement, le beau feu allumé dans la cheminée arrangeait un peu les choses. Aldo alla s’asseoir près du seul élément chaleureux et alluma une cigarette.
Trois autres suivirent et il commençait à perdre patience quand une porte s’ouvrit enfin pour livrer passage à Dianora. Il se leva à son entrée :
– Avez-vous donc l’habitude d’ouvrir votre porte au premier venu ? fit-il narquois. Votre camériste ne m’a même pas laissé le temps de lui donner mon nom.
– Elle n’en avait pas besoin. Mais vous n’étiez guère pressé de me rejoindre.
– Jamais, lorsque je ne suis pas invité. Si vous m’aviez appelé, je serais venu immédiatement.
– Alors pourquoi êtes-vous venu puisque je ne vous ai pas appelé ?
– Un vif désir de causer avec vous ! Vous n’aviez pas l’habitude de vous coucher tôt jadis. Or votre soirée ne s’est guère prolongée. Vous êtes même rentrée de bonne heure. Était-ce ennuyeux à ce point ?
– Plus encore que vous ne l’imaginez ! Le comte Solmanski est sans doute un parfait gentilhomme mais il est aussi récréatif qu’une porte de prison et l’on respire chez lui une atmosphère glaciale...
– Pourquoi y être allée dans ce cas ? Vous n’aviez pas non plus l’habitude de fréquenter des gens qui vous déplaisaient ou même vous ennuyaient ?
– J’ai accepté ce dîner pour faire plaisir à mon mari avec qui Solmanski est en affaires. Mais je ne crois pas vous avoir dit que je suis remariée ?
– Je l’ai appris par le barman, avec un rien de surprise, bien sûr, mais, après tout, c’est une façon comme une autre d’être mis au courant. Et, à propos de surprise, je suppose que c’était celle que me réservait Luisa Casati l’autre soir ? Cet heureux événement est récent ?
– Pas vraiment. Je suis mariée depuis deux ans !
– Mes sincères félicitations. Ainsi, vous voilà Suissesse ? ajouta Morosini avec un sourire impertinent. Pas étonnant que vous ayez regagné l’hôtel si tôt ! On se couche de bonne heure dans ce pays-là ! C’est d’ailleurs excellent pour la santé !
Dianora n’eut pas l’air d’apprécier la plaisanterie. Elle tourna le dos à son visiteur, lui permettant ainsi d’admirer la perfection de sa silhouette dans une longue robe d’intérieur en fin lainage blanc bordé d’hermine :
– Je vous ai connu un esprit plus délicat, mur-mura-t-elle. Si vous souhaitez me dire des choses désagréables, je ne vais pas tarder à regretter de vous avoir reçu.
– Où prenez-vous que je veuille vous déplaire ? Je pensais seulement que votre humour d’autrefois était intact. Dans ce cas, parlons de bonne amitié et dites-moi comment vous êtes devenue Mme Kledermann ? Un coup de foudre ?
– En aucune façon... du moins en ce qui me concerne. J’ai connu Moritz à Genève, pendant la guerre. Il m’a tout de suite fait la cour mais je tenais alors à garder ma liberté. Nous nous sommes revus par la suite et finalement j’ai consenti à l’épouser. C’est un homme très seul !
Morosini trouva l’histoire un peu courte et cependant n’en crut qu’une partie : il n’avait jamais rencontré de collectionneur qui se sentît seul : la passion qu’il nourrissait suffisait toujours à meubler ses instants de loisir en admettant qu’il en eût beaucoup. Ce qui ne devait pas être le cas d’un homme d’affaires de son envergure. Néanmoins, il garda ses réflexions pour lui, se contentant de déclarer négligemment :
– Si seul que cela ? Dans le monde où j’évolue à présent, celui des collectionneurs, votre époux est assez connu. Il me semble bien avoir entendu dire qu’il était père d’une fille ?
– En effet, mais je ne la connais guère. C’est une créature bizarre, très indépendante. Elle voyage beaucoup pour satisfaire sa passion de l’art. De toute façon, nous ne nous aimons guère...
Ça, Morosini voulait bien le croire. Quelle fille sensée eût souhaité voir son père saisi par le démon de midi au bénéfice d’une aussi affolante sirène ? Elle revenait vers lui maintenant et son éclat le frappa plus que tout à l’heure, bien qu’elle eût dépouillé toute parure au bénéfice de cette simple robe blanche qui, en s’ouvrant à la marche, lui rappelait qu’elle possédait les plus belles jambes du monde. Pour jouir un peu plus longtemps du spectacle, il recula vers la cheminée où il s’adossa. Il se surprit à se demander ce qu’elle pouvait bien porter sous ce vêtement. Pas grand-chose, sans doute ?
Pour rompre le charme, il alluma une cigarette puis demanda :
– Serait-il indiscret de vous demander si vous vous plaisez beaucoup à Zurich ? Je vous verrais mieux à Paris, ou à Londres. Il est vrai que Varsovie est plus gaie que je ne le croyais. C’est une surprise de vous y rencontrer.
– Vous aussi. Que venez-vous y faire ?
– Voir un client. Rien de passionnant comme vous voyez... mais vous conservez toujours cette habitude que vous aviez de répondre à une question par une autre question.
– Ne soyez pas agaçant ! Je vous ai déjà répondu. Nous avions décidé d’un voyage en Europe centrale, quelques amis et moi, mais ils n’étaient pas tentés par la Pologne. Je les ai donc laissés à Prague et je suis venue seule pour cette visite à Solmanski mais je les rejoins demain à Vienne. Satisfait, cette fois ?
– Pourquoi pas ? Encore que je vous voie mal en femme d’affaires.
– Le terme est excessif. Disons que je suis pour Moritz une... coursière de luxe. Je suis un peu sa vitrine : il est très fier de moi...
– Non sans raison ! Qui pourrait mieux que vous porter les améthystes de la Grande Catherine ou l’émeraude de Montezuma ?
– Sans compter quelques parures achetées à une ou deux grandes-duchesses fuyant la révolution russe. Celle que je portais ce soir en fait partie... cependant je n’ai jamais eu le privilège d’arborer les joyaux historiques : Moritz y tient beaucoup trop ! Mais... dites-moi, vous en connaissez des choses ?

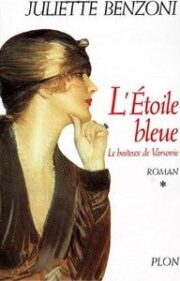
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.