– C’est moi, l’œuvre d’art ? fit-elle sur un ton un peu radouci.
– Vous voyez quelqu’un d’autre ? Allons, jeune fille, si vous essayiez de me confier vos ennuis ? Sans le vouloir, en sortant du château j’ai été le témoin involontaire d’une scène qui semble vous avoir fait beaucoup de peine. Ne parlant pas votre langue, je n’ai pas compris grand-chose, sinon, peut-être, que vous aimez ce garçon et qu’il vous aime mais qu’il entend le faire à ses propres conditions. Je me trompe ?
Anielka leva sur lui un regard tout scintillant de larmes. Dieu qu’elle avait de jolis yeux ! Ils avaient la couleur exacte d’une coulée de miel au soleil. Morosini eut soudain une furieuse envie de l’embrasser mais il se retint en pensant qu’après le baiser passionné de l’amoureux, le sien lui serait sans doute fort désagréable...
– Vous ne vous trompez pas, soupira-t-elle. Nous nous aimons mais si je ne peux pas le suivre, c’est parce que je n’en ai pas le droit. Je ne suis pas libre...
– Vous êtes mariée ?
– Non, mais...
La phrase s’interrompit tandis qu’une angoisse s’imprimait sur le ravissant visage qui regardait quelque chose par-dessus l’épaule de Morosini. Un troisième personnage venait de faire son apparition. Aldo en eut la certitude en percevant un bruit de respiration derrière lui. Il se retourna. Un homme bâti comme un coffre-fort et vêtu comme un valet de bonne maison se tenait derrière lui, son chapeau melon à la main. Sans même lui accorder un regard, il proféra quelques mots d’une voix gutturale. Anielka baissa la tête et s’écarta de son compagnon :
– Dieu que c’est agaçant de ne jamais rien comprendre, s’exclama celui-ci. Que dit-il ?
– Que l’on me cherche partout, que mon père est très inquiet... et que je dois rentrer. Veuillez m’excuser !
– Qui est-ce ?
– Un serviteur de mon père. Laissez-moi passer, s’il vous plaît !
– Je voudrais vous revoir.
– Comme je n’en ai pas la moindre envie, il n’en est pas question. Sachez que je vous en voudrai toujours de m’avoir retenue. Sans vous, je serais tranquille à cette heure... Je viens, Bogdan...
Pendant le bref dialogue, l’homme n’avait pas bronché, se contentant de tendre à la jeune fille la toque de fourrure qu’elle avait perdue dans sa course. Elle la prit mais ne s’en coiffa pas. Rejetant en arrière d’une main lasse les longues mèches soyeuses de sa chevelure dénouée et resserrant de l’autre son manteau, elle se dirigea sans se retourner vers les grilles du château.
Impressionné, Morosini s’aperçut que le jour était gris à présent, obscurci par le brouillard qui montait du fleuve. Jamais encore une femme ne l’avait traité avec ce mépris désinvolte, et il fallait justement que ce soit la seule qui lui plût depuis sa rupture avec Dianora. Il ignorait même son nom : rien qu’un prénom charmant. Il est vrai qu’elle ne s’était pas souciée du sien. Alors il se sentit intrigué encore plus que vexé.
Les deux silhouettes commençaient à se fondre dans la grande allée de peupliers quand il se décida enfin à se lancer à leur suite. Il se mit à courir comme si sa vie en dépendait.
Lorsqu’il atteignit l’imposant portail aux piliers sommés de statues qui donnait accès au château et devant lequel le cocher et son fiacre l’attendaient, il vit la jeune fille s’engouffrer dans une limousine noire dont Bogdan lui tenait la portière ouverte. Quand elle fut montée, celui-ci s’installa à la place du chauffeur et l’instant suivant, il démarrait. Morosini avait déjà rejoint Boleslas qui, faute d’autres distractions sans doute, observait lui aussi le départ en fumant une cigarette et, grimpant dans le fiacre, il ordonna : — Vite ! Suivez cette voiture ! Le cocher éclata d’un rire énorme :
– Vous n’imaginez tout de même pas que mon cheval peut suivre un monstre comme celui-là ? Il est en bonne santé et je n’ai pas envie de le tuer... même si vous m’offriez une fortune. Demandez-moi autre chose !
– Qu’est-ce que vous voulez que je vous demande ? grogna Morosini. À moins que vous ne sachiez à qui est cette automobile...
– Eh bien, voilà quelque chose de raisonnable ! Évidemment que je le sais. Il faudrait être aveugle et stupide pour ne pas connaître la plus jolie fille de Varsovie. La voiture appartient au comte Solmanski et la demoiselle s’appelle Anielka. Elle doit avoir dix-huit ou dix-neuf ans...
– Bravo ! Et vous savez leur adresse ?
– Bien entendu ! Vous voulez que je vous montre en vous ramenant à l’hôtel ?
– Faites donc ça ! Je vous en serai très reconnaissant, dit Morosini en lui tendant un billet que le bonhomme empocha sans complexes.
– C’est ce qui s’appelle comprendre la reconnaissance, fit-il en riant. Les Solmanski n’habitent pas bien de L’Europe : c’est dans la Mazowiecka...
Et l’on partit à la même allure qu’à l’arrivée, ce qui laissa aux occupants de la limousine le temps de rentrer. Aussi, quand le fiacre passa sans s’arrêter devant leur maison, tout y était-il calme et tranquille. Morosini se contenta de noter le numéro et de repérer les ornements du porche en se promettant de revenir, à la nuit. C’était peut-être stupide, étant donné qu’il repartait le lendemain, mais il éprouvait le vif désir d’en savoir un peu plus sur Anielka et de parvenir, peut-être, à revoir son ravissant visage...
C’était compter sans la double surprise qui l’attendait à l’hôtel. Dans sa chambre d’abord où quelques coups d’œil rapides lui apprirent qu’elle avait été visitée. Rien ne manquait dans ses bagages, tout était en ordre, mais pour un homme aussi observateur que lui, le doute n’était pas possible : on avait fouillé ses affaires. Pour y trouver quoi ? Là était la question. Le seul objet de quelque intérêt, la copie du saphir, ne quittait pas ses poches. Alors ? Qui pouvait s’intéresser à un voyageur – inconnu de surcroît ! – arrivé la veille au point d’inspecter ses affaires ? C’était assez délirant, cependant Morosini refusa de s’attarder trop longtemps là-dessus. Peut-être s’agissait-il d’un banal rat d’hôtel à la recherche d’une aubaine chez un client que l’on pouvait deviner fortuné. Dans ce cas, il pouvait être instructif de voir un peu de quoi se composait aujourd’hui la faune de L’Europe.
Aldo décida de dîner sur place, fit une brève toilette, changea ses vêtements de sortie pour un smoking, quitta sa chambre et descendit dans le hall, ce cœur battant de tout palace qui se respecte, et là réclama un journal français avant d’aller s’installer dans un fauteuil abrité des courants d’air par un énorme aspidistra. De là, il pouvait surveiller la porte à tambour, le comptoir du portier, le grand escalier et l’entrée du bar.
Comme tous les palaces d’une génération qui avait vu le jour au début du siècle, L’Europe faisait preuve d’un manque total d’imagination en ce qui concernait sa décoration. Comme son homonyme de Prague, il accumulait les dorures, les vitraux modern style, les fresques et les statues, les appliques et les lustres en bronze doré. Pourtant, il y avait quelque chose de différent et d’assez sympathique : une atmosphère plus chaleureuse, presque familiale. Les gens qui prenaient place autour des guéridons ou dans les fauteuils se saluaient sans se connaître d’un sourire, d’un signe de tête, ce qui laissait supposer qu’ils appartenaient à ce peuple polonais qui est bien l’un des plus courtois et des plus aimables du monde. Seuls un couple américain qui semblait s’ennuyer prodigieusement et un voyageur belge dodu et solitaire qui dévorait des journaux en buvant de la bière rompaient un peu le charme.
À observer ces gens – il y avait quelques jolies femmes qui semblaient les sœurs plus blondes de celles que l’on rencontrait à Paris au Ritz ou au Claridge – Morosini, qui faisait semblant de lire, cherchait qui pouvait être son visiteur quand soudain il se passa quelque chose : toutes les têtes se tournaient vers le grand escalier dont une femme descendait lentement les marches couvertes d’un tapis pourpre. Une femme ? Plutôt une déesse et qu’Aldo, ramené cinq années en arrière, identifia du premier regard : le fabuleux manteau de chinchilla n’était plus le même que celui de Noël 1913, mais le port de reine, la blondeur nacrée et les yeux d’aigue-marine étaient semblables au souvenir qu’il en gardait : c’était bel et bien Dianora qui venait là, laissant traîner derrière elle sa longue robe de velours noir ourlée de même fourrure.
Tout comme à Venise, jadis, elle ne se pressait pas, goûtant sans doute le silence provoqué par son arrivée et les regards admiratifs levés vers sa lumineuse image. Elle s’arrêta au milieu des degrés, une main sur la rampe de bronze, examinant le hall comme si elle cherchait quelqu’un.
Accourant du bar, un jeune homme en habit se précipitait, escaladant les marches deux à deux avec la hâte un peu maladroite d’un chiot qui voit arriver sa maîtresse. Dianora l’accueillit d’un sourire mais ne bougea pas : elle regardait toujours en bas et Aldo dont le regard croisa le sien vit que c’était lui qu’elle fixait, un sourcil un peu relevé par la surprise, un sourire aux lèvres.
Il hésita un instant sur la conduite à tenir puis reprit son journal d’une main qui tremblait un peu mais avec détermination, bien décidé à ne rien montrer de l’émotion éprouvée. Cependant, s’il espérait échapper à son passé, il se trompait : achevant de descendre l’escalier, la jeune femme dit quelques mots au jeune homme en habit qui parut un peu surpris mais s’inclina et retourna vers le bar. Imperturbable, Morosini ne bougea pas, bien qu’un léger courant d’air lui apportât une bouffée d’un parfum familier.
– Pourquoi faites-vous semblant de lire comme si vous ne m’aviez pas vue, mon cher Aldo ? fit la voix bien connue. Le n’est guère galant. Ou bien ai-je tellement changé ?

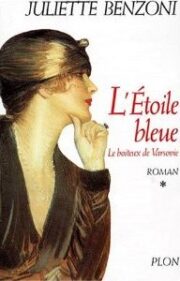
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.