– Vous comptiez... avec juste raison, sur la réputation de...
– ... mon maître. C’est le terme qui convient ! fit gravement le petit homme sans s’expliquer davantage.
– Et, bien entendu, sur la curiosité que suscite le mystère dont il s’entoure. Un mystère qu’il ne semble pas disposé à dissiper puisque vous êtes ici et non lui.
– Que croyez-vous donc ? Ma mission est de vous mener à lui dès que vous aurez fini de boire votre vin...
– Vous en offrirai-je ? Il est délicieux...
– Pourquoi pas ? approuva joyeusement le petit homme, qui partagea le tokay et les pâtisseries dont il s’accompagnait avec un visible plaisir. Après quoi, prenant une feuille de papier de soie dans l’espèce de porte-bouquet en étain placé au centre de la table, il s’essuya les lèvres et les doigts avant de consulter sa montre, un gros oignon ancien en argent niellé.
– Si nous partons maintenant, nous serons à peu près à l’heure prévue, dit-il. Merci pour cet agréable moment.
Quittant la taverne, les deux hommes plongèrent dans la quasi-obscurité du Rynek, à peine troublée par les petites lampes à pétrole qui éclairaient les guérites à guichets des vendeurs de cigarettes. L’un derrière l’autre, ils gagnèrent les abords proches du quartier juif, grouillant d’activité dans la journée mais qui, avec la nuit, s’enfonçait dans le silence.
À l’entrée d’une rue marquée par deux tours, ils croisèrent un homme maigre aux yeux de feu dont le visage oriental s’ornait d’une barbe rousse. Long et un peu voûté, il portait une lévite noire et une casquette ronde, droite et rigide, d’où pendaient de longues mèches tortillées. Le pas de cet homme était feutré comme celui d’un chat et, après avoir salué Élie Amschel, il disparut aussi vite qu’il était apparu, laissant à Morosini l’étrange impression d’avoir croisé en lui le symbole du ghetto, l’ombre même du Juif errant...
Toujours derrière son guide, il emprunta une ruelle tortueuse, si étroite qu’elle ressemblait à une faille creusée entre deux rochers sous un ciel invisible. Le pavage de la rue principale où s’incrustait le chemin d’acier du tramway faisait maintenant place à de gros galets irréguliers provenant selon toute vraisemblance du lit de la Vistule et sur lesquels il ne devait pas faire bon s’aventurer avec des talons hauts. Des boutiques fermées n’en jalonnaient pas moins le boyau, annonçant des marchands de meubles, des bijoutiers, des fripiers et des marchands de curiosités. L’enseigne de ces derniers éveilla chez le prince-antiquaire le vieux démon de la chasse à l’objet. Peut-être des merveilles s’abritaient-elles derrière ces volets crasseux ? ...
La ruelle débouchait sur une placette pourvue d’une fontaine. On s’y arrêta. Tirant une clef de sa poche, Amschel s’approcha d’une maison haute et étroite, grimpa les deux marches de pierre menant à la porte basse, flanquée de l’inévitable niche rituelle, et ouvrit.
– Nous voici chez moi, dit-il en s’effaçant pour laisser son compagnon pénétrer dans un étroit vestibule presque entièrement envahi par un sévère escalier de bois, puis dans une pièce assez confortable où des bibliothèques s’ordonnaient autour d’un grand poêle carré répandant une agréable chaleur et d’une vaste table chargée de papiers et de livres. Des fauteuils en tapisserie invitaient à s’asseoir, ce que Morosini s’apprêtait à faire, mais Élie Amschel se contenta de traverser cette salle pour atteindre une sorte de réduit occupé par plusieurs lampes à pétrole posées sur un coffre.
Le petit homme en alluma une puis, repoussant le tapis usé, il découvrit une trappe armée de fer qu’il souleva. Les marches d’un escalier de pierre enfoncé dans le sol apparurent.
– Je vous montre le chemin, dit-il en élevant la lampe.
– Dois-je refermer la trappe ? demanda Morosini un peu surpris de ce cérémonial, mais Amschel lui dédia un bon sourire :
– Pour quoi faire ? Personne ne nous poursuit. Le mystérieux escalier aboutissait tout bêtement
à une cave comportant ce que l’on peut s’attendre à trouver dans une cave : tonneaux, bouteilles pleines, bouteilles vides et tout le matériel nécessaire à l’usage et à l’entretien. Élie Amschel sourit :
– J’ai quelques bons crus, dit-il. Au retour, nous pourrions choisir une ou deux bouteilles pour vous remettre du voyage souterrain que vous allez devoir accomplir.
– Un voyage souterrain ? Mais je ne vois ici qu’un cellier...
– ... qui ouvre sur un autre et sur d’autres encore ! Presque toutes les maisons qui composent le ghetto sont reliées par un réseau de couloirs, de caveaux. Durant les siècles écoulés, notre sécurité a souvent dépendu de cet immense terrier. Il se peut qu’elle en dépende encore. Depuis la guerre, la Pologne est libre du joug russe mais nous, les Juifs, ne le sommes pas autant que le reste de la population. Par ici, s’il vous plaît !...
Sous sa main, un grand casier à bouteilles tourna avec un pan du mur auquel il s’attachait mais, cette fois, Amschel referma après avoir laissé passer Morosini qui évitait de se poser des questions, attentif à la bizarre aventure qu’il vivait.
On marcha longtemps par une suite de galeries et de boyaux dont le sol était fait tantôt de vieilles briques, tantôt de terre battue. Parfois, on franchissait une ogive à demi écroulée, parfois quelques marches visqueuses, mais toujours un couloir succédait à un autre avec la même odeur de moisi et de brouillard où se mêlaient des relents plus humains. C’était un hallucinant voyage à travers les âges et les souffrances d’une race qui avait dû, pour survivre, se terrer dans le domaine des rats et y attendre, le cœur arrêté, que s’éloigne le pas des massacreurs. Le regard fixé sur le chapeau rond du petit homme qui trottait devant lui, Aldo finissait par se demander si l’on arriverait jamais. Les limites du quartier juif devaient être dépassées depuis longtemps... à moins que, pour brouiller la piste, le fidèle serviteur d’Aronov n’ait choisi de recouper ses propres traces ? Certains détails surgis dans la lumière jaune de la lampe paraissaient tout à coup bizarrement familiers...
Morosini se pencha pour toucher l’épaule de son guide :
– C’est encore loin ?
– Nous arrivons.
Un instant plus tard, en effet, les deux hommes pénétraient à l’aide d’une clef dans un caveau bas à demi rempli de décombres. Un escalier, adroitement dissimulé au milieu des pierres écroulées, s’enfonçait dans une faille du mur pour aboutir à une porte en fer qui avait dû être forgée au temps des rois Jagellons mais, si antique qu’elle fût, cette porte s’ouvrit sans le plus petit grincement quand Amschel eut tiré trois fois sur un cordon pendant dans un renfoncement. Alors, en une seconde, Morosini changea de monde et remonta plusieurs siècles : un majordome vêtu à l’anglaise s’inclinait devant lui au bas de quelques marches recouvertes d’un tapis rouge sombre menant à une sorte de galerie. La seule différence avec un Britannique résidait dans les traits du visage quasi mongol et impénétrable. Sous le vêtement bien taillé, les épaules de cet homme et l’épaisseur de son torse révélaient une force redoutable. Il ne dit pas un mot mais, sur un signe d’Amschel, il se mit à gravir les marches suivi des deux visiteurs. Une autre porte s’ouvrit et une voix à la fois basse et profonde, émouvante comme un chant de violoncelle, se fit entendre :
– Entrez, prince ! dit-elle en français. Je suis extrêmement heureux de votre venue...
Le majordome débarrassa Morosini de sa pelisse au seuil d’une pièce qui ressemblait à une ancienne chapelle avec sa voûte de pierre dont les croisées d’ogives s’ornaient de culs-de-lampe ouvragés, mais c’était, pour l’heure présente, une vaste bibliothèque dont les murs que n’occultaient pas de hauts rideaux de velours noir disparaissaient sous une infinité de rayonnages remplis de livres. Une grande table de marbre sur piétements de bronze supportait un admirable chandelier à sept branches. Sur le sol couvert de précieux kilims, deux grandes torchères Louis-XIV répandaient une lumière chaude révélant le poêle sombre et, dans le renfoncement d’un enfeu attestant qu’il s’agissait bien d’un ancien sanctuaire, un coffre médiéval que ses verrous et ses défenses compliquées devaient rendre plus inattaquable que n’importe quel coffre-fort moderne.
Aldo embrassa tout cela d’un coup d’œil rapide, mais ensuite son regard se fixa pour ne plus bouger. Simon Aronov était devant lui, et le personnage était capable de retenir l’attention la plus flottante.
Sans trop savoir pourquoi, et tandis qu’il suivait Élie Amschel dans les entrailles du ghetto, l’imagination de Morosini, toujours prête à courir la poste, s’était composé une image pittoresque de celui qui l’attendait au bout de son voyage : une sorte de Shylock en lévite et haut bonnet de feutre noir, un Juif dans la plus pure tradition des récits moyenâgeux, habitant logique d’un souterrain ténébreux. Au lieu de cela, il rencontrait l’un de ses pareils, un gentilhomme moderne qui n’eût déparé aucun salon aristocratique.
Aussi grand que lui mais peut-être un peu plus massif, Simon Aronov dressait une tête ronde, presque chauve à l’exception d’une demi-couronne de cheveux gris, sur une silhouette à l’élégance sévère habillée très certainement par un tailleur anglais. Le visage, à la peau de blond tannée comme il arrive à ceux qui vivent beaucoup au-dehors, était marqué de rides profondes mais l’éclat de l’œil unique – l’autre se cachait sous une œillère de cuir noir – d’un bleu intense devait se révéler insoutenable à la longue.
Ce fut seulement lorsque Aronov vint vers lui en appuyant sur une lourde canne une boiterie prononcée que Morosini remarqua la chaussure orthopédique où s’emprisonnait le pied gauche, mais la main qui se tendait était belle tandis que la voix de velours sombre reprenait :

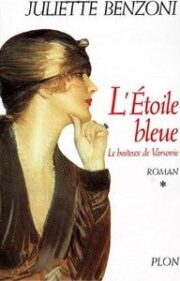
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.