Mina ne s’émut pas de la remarque patronale, se contentant de faire observer qu’une secrétaire n’avait pas besoin d’être belle et que Morosini ne l’avait pas engagée pour ça. Point final.
Pourtant, son entrée in casa Morosini s’était effectuée d’une façon assez originale et même plutôt piquante. Alors qu’il sortait d’une messe de mariage à l’église San Zanipolo[iv], le prince qui reculait pour admirer la sortie du cortège nuptial avait sans le vouloir heurté quelqu’un et entendu un grand cri. En se retournant, il eut juste le temps de voir deux jambes féminines disparaître à la renverse dans le rio dei Mendicanti : c’était Mina qui, à ce moment, reculait elle aussi pour mieux contempler la puissante statue équestre du Colleone, le condottiere, érigée devant l’église. Elle venait de faire un plongeon dans l’eau sale du canal.
Morosini, désolé, se hâta de lui porter secours avec l’aide de sa gondole et de Zian qui attendaient tout près de là. On tira la sinistrée de l’eau, on l’étendit dans le bateau et Aldo la fit ramener au palais où Cecina s’en occupa avec la compétence et la vigueur qu’on lui connaissait. Elle réussit à la faire parler et même à la confesser : la jeune Hollandaise pleurait comme une Madeleine la perte de son sac, tombé au fond du rio avec tout son argent. Seul son passeport, resté avec sa valise à la petite pension pour dames où elle était descendue, échappait au désastre.
Comme il n’existait pas de souci ou de chagrin capable de résister à la grosse femme, la naufragée nourrie de mandorle[v] et de café en vint presque à considérer son hôtesse comme une mère. De son côté celle-ci, apitoyée par la mine misérable de la jeune fille et son irréprochable italien, décidait de prendre ses intérêts en main. Et s’en alla trouver Aldo pour voir avec lui ce que l’on pouvait faire dans ce sens...
Par chance, Morosini pouvait beaucoup. Il venait de se séparer de sa secrétaire, la signora Rasca, qui avait tendance à confondre ses fonctions avec celles d’un gardien de musée et amenait quotidiennement ses nombreux parents, amis et connaissances admirer les belles choses que vendait son patron, poussant même l’esprit de famille jusqu’à fermer les yeux quand l’un ou l’autre des visiteurs décidait d’emporter un modeste souvenir. Aussi, après quelques instants d’entretien avec sa rescapée, le prince se sentit-il enclin à partager la façon de voir de Cecina : Mina, outre son hollandais natal, parlait quatre langues. Quant à sa culture artistique, elle était tout à fait convenable.
Estimant leur joute oratoire terminée, Morosini choisit de lui laisser le dernier mot. Tirant sa montre, il constata qu’il n’était pas loin de midi, prit sur un meuble ses gants et son chapeau, et ouvrit la porte du bureau de Mina pour lui rappeler qu’il déjeunait avec un client.
Amarré devant le perron, un motoscaffo flambant neuf – acajou blond et cuivres étincelants ! – attendait, superbe et anachronique. C’était l’un des premiers canots à moteur qui circulaient sur la lagune. Aldo trouvait un plaisir enfantin à conduire ce beau jouet, presque aussi racé qu’une gondole et signé Riva, qui le confortait dans l’opinion qu’il fallait vivre avec son temps...
Il mit le moteur en marche et démarra doucement. Le Guidecca traça une impeccable courbe à peine crêtée d’écume dans l’eau du canal puis piqua droit sur San Marco.
Le temps d’avril était frais, doux et sentait les algues. Le prince-antiquaire s’emplit les poumons de la brise marine qui venait du Lido et lâcha ses chevaux. Dans le bassin, à l’aplomb de San Giorgio Maggiore, un navire de guerre hérissé de canons gris déversait une bordée de marins vêtus de toile blanche à quelques encablures du Robert-Bruce. Le yacht noir de lord Killrenan procédait à ses manœuvres d’appareillage.
Morosini le salua du geste avant de piquer sur le palais ducal, qui, dans le soleil capricieux, ressemblait à une large broderie rose frangée de dentelle blanche. Heureux sans trop savoir pourquoi, il arrima son bateau, sauta sur le quai en prenant soin de rectifier son nœud de cravate, adressa un bonjour cordial au procureur Spinelli qui bavardait avec un inconnu au pied de la colonne de San Teodoro, sourit à une jolie femme vêtue de bleu ciel et entreprit de traverser la Piazzetta.
Des nuages de pigeons blancs tournoyaient avant de se poser sur les marbres encore luisants d’une pluie récentes et Aldo s’accorda un instant pour les regarder. Il aimait ce temps de midi qui mettait du mouvement au cœur de la ville. C’était l’heure où, devant San Marco, ses coupoles dorées et ses chevaux de bronze, le « grand salon » de Venise recevait sur ses dalles ornées d’une blanche géométrie ses visiteurs étrangers et ses fidèles en cette sorte de carnaval permanent qui renaissait chaque jour, à midi et au coucher du soleil. Alors les cafés de la place accueillaient leur contingent de consommateurs bruyants dont les conversations s’arrêtaient à peine lorsque, sous les marteaux des deux Maures de bronze, la grande cloche plantée sur la tour de l’Horloge sonnait les heures lumineuses de Venise.
Morosini savait bien qu’en passant devant le célèbre Florian il se ferait héler cinq ou six fois mais il était décidé à ne pas s’arrêter car il avait donné rendez-vous pour déjeuner chez Pilsen à un client hongrois et il détestait arriver le second lorsqu’il invitait quelqu’un.
Soudain, il jura silencieusement en constatant que le destin était contre lui et qu’il avait une bonne chance d’être en retard : une extraordinaire apparition venait à lui sous les regards rendus fixes des badauds. Celle qui s’avançait était la dernière dogaresse, la reine sans couronne de Venise et son ultime magicienne : la marquise Casati, qui voguait vers lui au pas lent des spectres, impériale, dramatique à souhait et pâle comme la mort, dans un enroulement de velours pourpre. Un page, vêtu de même couleur, la précédait, tenant au bout d’une laisse assortie au collier d’or clouté de rubis une panthère trop nonchalante pour n’être pas droguée. Un peu en retrait de la marquise, une femme venait, comme sacrifiée...
Lorsque l’on rencontrait Luisa Casati, il fallait se faire à l’idée que ses cheveux auraient changé de couleur depuis la précédente fois. Ils semblaient avoir à leur disposition toutes les nuances de l’arc-en-ciel et, ce jour-là, sous les plumes fulgurantes du chapeau, ils étaient d’un roux aveuglant. Très grande, le visage livide dévoré par d’énormes yeux noirs encore élargis par un maquillage charbonneux, la bouche pareille à une blessure fraîche, la Casati s’avançait d’un pas majestueux en serrant contre sa poitrine une brassée d’iris noirs. Sur ses pas, les gens se figeaient comme en face d’un masque de Méduse ou encore de la Mort, dont la marquise se plaisait à évoquer parfois les rites lugubres, mais elle se souciait peu de l’effet produit. Tout à coup souriante, elle vint à Morosini qui déjà s’inclinait, lui tendit une main royale alourdie d’un anneau qui aurait pu servir au couronnement d’un pape puis, braquant sur lui un monocle serti de diamants, elle s’écria d’une voix aux sonorités de violoncelle :
– Cher Aldo ! Quel plaisir de vous voir bien que vous n’ayez pas répondu à mon invitation pour le bal de ce soir. Je pense qu’il n’y a pas de votre faute : les cartons ont été envoyés en dépit du bon sens... mais vous n’en avez même pas besoin et je compte sur vous, naturellement...
C’était à peine une question. La Casati n’en posait que rarement et se passait en général de la réponse. Elle habitait sur le Grand Canal un palais de marbre, de porphyre et de lapis-lazuli menaçant ruine mais drapé de lierre romantique et de glycines. C’était la Casa Dario, où elle avait aménagé des salons grandioses. Elle y vivait parmi les objets précieux, les fourrures et la vaisselle d’or, entourée de gigantesques serviteurs noirs qu’elle habillait, suivant son humeur, en princes orientaux ou en esclaves. Les fêtes qu’elle y donnait étaient étourdissantes, cependant Morosini n’en goûtait pas toujours l’originalité. Ainsi ce fameux soir où, descendant de sa gondole, il fallut passer entre deux tigres de belle taille et on ne peut plus vivants, puis constater que les porte-flambeaux égrenés le long de l’escalier étaient de jeunes gondoliers à peu près nus mais peints en or, ce dont l’un d’eux devait mourir dans la nuit. Ce drame ne fit qu’ajouter une touche sinistre à la légende de la Casati, sans cesse grandissante depuis que, pour faire danser deux cents invités, elle avait loué la Piazzetta que l’on ferma au vulgaire par un cordon de ses domestiques vêtus de pagnes écarlates et reliés entre eux par des chaînes dorées. En fait, il n’était pas d’excentricité qu’on ne lui prêtât. On disait même que dans sa demeure française du Vésinet, le charmant palais Rose qu’elle avait acheté à Robert de Montesquiou, elle élevait des serpents. Ce qui était d’ailleurs l’exacte vérité.
Morosini, n’étant pas tenté par le fameux bal, répondit qu’il n’était pas libre. Les sourcils couleur d’encre se relevèrent d’un cran.
– Êtes-vous devenu boutiquier au point d’oublier qu’on ne refuse pas de vivre chez moi un instant d’éternité ?
– Si, justement ! fit Morosini que la répétition de l’étiquette commençait à agacer. La boutique a de ces exigences. Ainsi je pars ce soir pour Genève où je dois conclure une importante affaire. Il faudra me pardonner.
– Sûrement pas ! Vous n’avez qu’à téléphoner que vous avez la grippe. Les Suisses ont horreur des microbes et vous partirez plus tard. Allons, cessez de vous faire prier !... surtout si vous souhaitez entendre des nouvelles d’une dame que vous aimiez beaucoup.
Quelque chose frémit aux environs du cœur d’Aldo.
– J’en ai aimé quelques-unes...
– Mais celle-là plus que les autres. Du moins tout Venise en était persuadé...

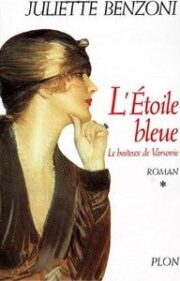
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.