Mais il en restera sur sa curiosité. Toute la ville s'est égaillée comme une volée d'étourneaux.
Tout le monde s'est trouvé en bas pour accueillir les étrangers. Il est resté seul sur ce rocher de malheur presque comme du temps où il était enfant et qu'il y montait par un sentier de chèvre. Qui croirait que la grand-place pavée de la Haute-Ville où, aujourd'hui, les dames aiment à tourner carrosse, a été cette clairière ombragée de grands arbres où, dès l'âge de six ans, il rôdait, son petit couteau-jambette en main, à la recherche des asperges sauvages ou des crosses de fougères, pointant de la terre humide, et qu'il rapporterait à sa mère pour qu'elle les ajoute à la soupe familiale ?
Ce ruisseau qui traverse la grand-place dévalait parmi les herbes hautes. Il y a trempé ses pieds nus de petit Normand, levant les yeux vers les frondaisons des grands arbres d'Amérique. Il s'est taillé un pipeau adossé aux racines d'un chêne, là où s'élève la cathédrale. De la grande forêt primitive, il ne reste plus sur le promontoire que des enclos et des parcs entourant les propriétés bâties : le monastère des Ursulines, la maison et le collège des Jésuites, le séminaire et l'évêché, l'Hôtel-Dieu. Hors ces grands bâtiments dans leurs îlots de verdure, partout des rues tracées bordées de maisons. Et l'on entend les carrosses et les charrettes tressauter sur les pavés, le bruit des sabots ferrés des chevaux...
En ce temps-là (le temps de son enfance), il y a près de cinquante ans, il n'y avait au pied du Roc que deux ou trois familles de colons. Ça ne faisait que quelques petits enfants français qui s'élevaient comme une couvée de sarcelles sauvages au bord du fleuve perdu.
Six ou sept femmes et, parmi elles, Hélène Boullé, vingt ans, épouse de M. de Champlain et ses trois suivantes.
La fine Hélène Boullé, en robe blanche et son petit miroir au cou, où les Indiens se voyant refléter s'attendrissaient qu'elle « les gardât dans son cœur ».
Tout le monde logeait dans l'habitation que M. de Champlain avait construite sur la rive.
Un véritable petit château de bois en solide charpente, avec trois corps de logis, un vaste magasin, un petit colombier et, au second étage, sous la toiture en pente aux hautes cheminées, un balcon circulaire permettant aux sentinelles de surveiller l'immense horizon. Autour un large fossé flanqué d'un pont-levis et plusieurs canons braqués aux endroits stratégiques. L'habitation, on s'y entassait tous, dans les débuts, quand l'hiver venait, quand l'Iroquois menaçait. Colons, traitants, interprètes, soldats. On se tenait chaud. La falaise à laquelle on s'adossait vous suspendait au-dessus de la tête des franges de glaces géantes. Les marées d'automne rongeaient les pilotis. À manger, l'hiver, toujours des farines et des salaisons de la Compagnie, du cidre piqué comme sur les navires, quelque gibier qu'apportaient les Indiens ou qu'on prenait au piège.
L'odeur des fourrures vous saoulait. Le mal de terre – le scorbut – vous faisait les chairs flasques, la peau blême, les gencives saignantes.
Louis Hébert, l'apothicaire, soignait cela avec de la décoction de myrtilles sèches. Les Algonquins apportaient leurs médecines mystérieuses.
Le soir, on disait la prière en commun et, le dimanche, pendant les repas, on lisait la Vie des Saints.
Une année où les navires de France amenant des vivres avaient été capturés par les Anglais, ce fut la famine. Minables récoltes de ces colons qui savaient à peine manier la houe ! Aucune réserve pour l'hiver. La mort promise sans recours.
M. de Champlain charria ses Français sur trois barques et ils s'en allèrent au long du grand fleuve Saint-Laurent demandant pitié aux sauvages.
C'est ainsi qu'elle a été sauvée la petite colonie. Par la charité des sauvages. Algonquins, Montagnais, nomades dispersés sous leurs wigwams de peaux ou Hurons sédentaires, dans leurs villages aux cossues maisons d'écorce en berceau, bien garnies de maïs récolté, les uns et les autres acceptant de recevoir, soit un homme, soit un enfant, ou un couple avec un bébé, afin de partager avec cette bouche supplémentaire leur bol de sagamite, bouillie de maïs, ou leurs réserves de poissons séchés ou de viande fumée.
Charité exemplaire car, pour toute famille ou tribu isolée, dans l'hiver inclément, une bouche supplémentaire peut être cause de leur perte pour peu que le printemps tarde à venir.
On en avait casé ainsi peu à peu au long du fleuve. À la fin, il ne restait plus qu'une barque, celle où il se trouvait lui-même avec ses onze ans et son copain, Tancrède Beaujars, qui en avait treize, et sa sœur Élisabeth Beaujars qui en avait dix. Tous trois, serrés sous une couverture et n'osant plus bouger tant le froid et la faim les tenaillaient.
Le nautonier lui-même, Eustache Boullé, beau-frère de M. de Champlain, était si faible qu'il n'avait plus la force de hisser la voile, à peine celle de manœuvrer le gouvernail.
La barque allait comme une barque fantôme, descendant le fleuve vers son embouchure polaire, entre les rives du Labrador et de Gaspé.
Les glaces commençaient. À la lisière des eaux salées, elles prenaient des transparences vertes et bleues qui scintillaient dans les brouillards. Les hautes falaises de cristal paraissaient peuplées de démons. Les enfants devenaient de plus en plus tristes. Ils avaient l'impression qu'ils étaient destinés à errer toujours dans les limbes. Quand on abordait, les grèves étaient désertes et ils n'avaient plus la force de partir à la recherche des villages. Ils suçaient des écorces, se partageaient un dernier morceau de biscuit marin.
Du côté de Gaspé, un chef algonguin avait accepté de prendre trois enfants. Eustache Boullé était reparti.
Dans les cabanes, fumée, vermine, mais du bon temps. Ensevelie sous les neiges, la vie dans les villages indiens n'est rien d'autre, l'hiver, que celle des bêtes au fond de leur terrier où l'on se blottit à l'abri des tempêtes, où l'on dort, où l'on mange, où l'on fait maintes choses agréables pour oublier les menaces du dehors. À se remémorer sa saison en Gaspésie, Pierre Loubette se prend à sourire.
Peu « honteuses » comme elles étaient de nature, ces sauvagesses, adolescentes et même les jeunes femmes n'ont pas été longues à se montrer curieuses des deux beaux garçonnets d'une race étrangère.
À ce souvenir il rit et s'esclaffe, et tousse, tousse jusqu'à ce que le sang vienne tacher le linge qu'il a porté à sa bouche.
Putain de vie ! C'est toute cette fumée respirée et tout ce froid inhumain, qui lui ont, à la longue, brûlé l'intérieur. Mais on ne peut pas regretter.
Un instant il s'est revu, petit gars râblé et vigoureux, tout surpris de son plaisir, se débattant sous les fourrures avec la belle Indienne au corps lisse, qui rit, le bécote, le caresse, le chatouille, l'agace, le lèche, le tourneboule comme un chiot et le fait éclater, lui aussi, de rire et de bien-aise.
Du bon temps !
Et comment voulez-vous, après une enfance pareille, qu'on se fasse à cette ville pleine de maisons, de boutiques, d'entrepôts, d'églises et de bordels, qu'on se fasse à ce salmigondis d'arrivants du Vieux Monde, racaille qui vous pille, ou clercs illuminés qui vous excommunient pour un rien, grands seigneurs en dentelles dont l'exil sanctionne quelque crime ou malversation, ou pieuses bienfaitrices débarquant avec tous leurs meubles, leurs tapisseries et les tableaux de tous les saints, fonctionnaires aux dents longues, grands jésuites promis au martyre, émigrants faméliques, soldats ahuris, officiers prétentieux qui marchent comme des ours sur le sentier de la guerre, tout ce monde-là n'ayant en commun que l'avide espérance de « faire son beurre » dans la fourrure.
Dans ce temps-là, les chênes de la forêt d'Amérique n'appartenaient pas au Roi de France, comme ça a été décrété un beau jour, et les braves colons du Canada pouvaient s'y tailler de beaux meubles, comme son buffet-vaisselier, aux dessins en « pointes de diamant ». Tout ce qui lui reste. M. le marquis de Ville d'Avray guigne dessus, mais il ne l'aura pas.
Il paraît que les étrangers arrivés aujourd'hui logent chez lui, en haut de la rue même. Il a entendu passer toute une compagnie brillante. Des cris ! Des appels ! On se hélait.
Pourrait-on croire que tout était si grand, si calme et désert, en ce temps-là, au Canada, quand, à cette heure de la nuit, des éclats de voix s'élèvent et que des ivrognes braillent dans la rue, pas plus loin qu'en face de chez lui : un éclair de lumière a glissé sur les petits carreaux de papier huilé de sa fenêtre.
C'est la porte du cabaret du Soleil levant qui s'est ouverte pour laisser passer un buveur titubant, puis qui s'est refermée.
*****
À l'entrée de la rue de la Closerie, juste en face de la maison où le vieux Loubette, oublié sur son grabat entre son buffet de chêne et son calumet de pierre rouge, se remémore le temps de M. de Champlain, se trouve le cabaret du Soleil levant avec son seuil de trois marches, traître aux ivrognes les jours de verglas et au-dessus sa belle enseigne d'or rayonnant d'un soleil qui sourit.
M. le duc de La Ferté, amer et tourmenté, s'y est réfugié à la nuit. C'est une chose pénible que de se cacher sous un faux nom, surtout lorsque le passé surgit à vos yeux sous l'apparence d'une femme troublante et que l'incognito dont on s'est affublé ne vous permet pas de vous faire reconnaître d'elle.
Il fait glisser son gobelet d'étain tout au long de la table de bois poli par deux générations de buveurs attablés. Et il reste là affalé, le bras tendu, sa manchette de dentelle fripée couvrant son poignet, ses doigts qui tremblent, crispés autour du récipient.
Il bredouille :

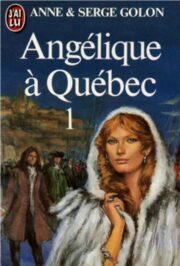
"Angélique à Québec 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique à Québec 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique à Québec 1" друзьям в соцсетях.