On s'enferma donc dans le poste pour y vivre les longs jours annoncés où chaleur et nourriture deviendraient les deux préoccupations essentielles. Peyrac y ajoutait un troisième élément, non moins indispensable, estimait-il, au maintien vital : le travail. Le souterrain de la galerie-tunnel, partant de la salle principale, permettait de gagner les ateliers. Personne ne chômerait, nul n'aurait le temps de sentir peser sur lui l'étreinte blanche de l'hiver : il n'y aurait que bien trop de travail pour tous. Pour les femmes, c'était simple. Nourriture et chaleur : tels étaient leurs mots d'ordre. Personne n'avait eu besoin de le leur imposer et elles avaient su se répartir la besogne avec diligence. C'était encore une des facultés d'Angélique.
Elle besognait aussi dur que les autres, sans avoir l'air de prendre les choses en main.
Pourtant c'était d'elle que venait l'impulsion. Maîtresse en fait, elle n'en réclamait pas le titre ni les prérogatives. D'instinct elle savait que l'heure viendrait. Ce qui allait de soi, c'était de servir et de tout faire pour maintenir le bien-être des êtres qui lui étaient confiés. Et Joffrey continuait de l'observer.
Nourriture et chaleur – les feux et la cuisine – et puis l'ordre. Sans ordre et propreté la vie deviendrait intenable dans ce terrier surpeuplé. Dès le matin les balais de bruyère entraient en action.
On avait auparavant ranimé les braises, posé sur les chenets fagots et bûches, accroché des marmites à bouillir dans les cinq foyers.
Le temps gagné sur l'hiver avait permis des agrandissements notables. L'entrée du poste était suivie d'une pièce étroite destinée aux dépôts des vêtements et des bottes couverts de neige. Au fond de celle-ci une cheminée d'angle avec un seul âtre, près des bat-flanc où s'alignaient les paillasses des hommes, était plus spécialement destinée à ce séchage indispensable qui dégageait beaucoup de buée et des odeurs entêtantes de cuir et de fourrure détrempés. On se groupait plus volontiers autour de la cheminée centrale où mijotaient les soupes et les ragoûts. Elle comportait elle aussi quatre foyers, deux donnant de race et de droite dans la grande salle, les deux autres destinés à chauffer, l'un la chambre d'Angélique et de son mari, l'autre, sur la gauche, la vaste pièce, séparée par un paravent de planches, où logeaient les Jonas et les enfants sous la garde d'Elvire. Un ressaut du promontoire rocheux, sur lequel avait été bâti ou plutôt creusé le poste de Wapassou, surélevait la troisième chambre qui était celle du comte et de la comtesse de Peyrac.
De la salle on y accédait par quatre échelons et une estrade qui courait à mi-hauteur et sur laquelle Angélique rangeait les écuelles, boîtes et paniers, immédiatement utiles à la cuisine et au repas.
La porte de gros chêne épais, sur des gonds de cuir, s'ouvrait difficilement et comme à regret. Il fallait baisser la tête pour entrer. Il n'y avait qu'une seule fenêtre très petite avec des carreaux de parchemin. Et tout le reste était de chêne noir équarri. L'âtre s'ouvrait au fond. À droite, une porte donnait sur un cagibi aménagé pour les bains de vapeur et où Angélique connaissait ses meilleurs instants de détente et pouvait satisfaire sa passion pour l'eau chaude. À la Cour des Miracles on le lui avait assez reproché, mais elle n'en avait pas été guérie pour autant.
Angélique aima tout de suite ce trou obscur à demi enfoui dans le roc, à demi couvert par la retombée des noires branches des sapins qui au-dehors frôlaient son toit de bardeaux. Derrière la grande salle, il y avait une sorte d'abri sous le roc qui servait d'entrepôt et de cellier. On y brassait la bière, on y fabriquait le savon, on y faisait la lessive. Le porc, l'enfant choyé de la maison, y grognait et y recevait les visites de ceux qui veillaient à ce qu'il demeurât gras et lui apportaient les restes des repas. Puis le couloir couvert menait jusqu'à l'emplacement mystérieux des ateliers et des forges. Le long de ce souterrain, des canalisations de plomb amenaient de l'eau chauffée auparavant par les fourneaux de la mine. Parfois Angélique s'écriait :
– Allez donc voir si Eloi Macollet n'est pas mort !...
Car le vieux Canadien n'avait pas voulu s'enfermer avec les autres et il s'était installé dans la cour, dehors, comme un vieil ours, dans un wigwam d'écorce bâti de ses mains, avec un foyer au centre dans un cercle de cailloux. C'était seulement devant son refus de partager la vie commune qu'on s'était avisé qu'il n'appartenait pas, en fait, à la caravane, mais qu'il n'était qu'un vieux coureur de bois solitaire qui, descendant du mont Kathedin, s'était arrêté un soir au poste de Katarunk, alors que l'armée canadienne y campait et que Peyrac venait d'y arriver. Pourquoi était-il resté avec eux et les avait-il suivis ? Personne ne le savait que lui. Et il avait son idée bien ferme là-dessus. Il ne l'eût pas avoué à n'importe qui. En fait, à cause d'Angélique. Macollet était frondeur de nature. Or, ses compatriotes de Québec lui avaient dit que cette femme-là, c'était, presque certainement, la Démone de l'Acadie, et il se rappelait que sa belle-fille, de Lévis, elle aussi y croyait à cette démone qui devait jeter le malheur sur l'Acadie. Alors il s'était dit que ça lui ferait dresser les cheveux sous son bonnet, à sa belle-fille, lorsqu'elle apprendrait qu'il avait passé tout un hiver avec celle qu'on soupçonnait maintenant être la Démone. De plus, il avait bien réfléchi : les démons et les démones, il s'y connaissait, lui qui avait rôdé dans toutes les forêts d'Amérique. Eh bien, celle-là qu'on accusait, elle n'en était pas. Il en aurait mis sa main au feu. C'était simplement une femme pas comme les autres, une femme belle et aimable, qui savait rire, bien manger et même être un peu saoule à l'occasion. Il l'avait vue si gaie et si grande dame à la fois à Katarunk qu'il en gardait le souvenir comme d'un des meilleurs moments de son existence. Il n'y avait pas de déshonneur à servir une femme comme celle-là, se disait-il. Sans compter que ces gens-là avaient besoin de lui, sinon ils ne s'en tireraient pas. Ils avaient trop d'ennemis, alors Macollet restait avec eux. L'entêtement d'Eloi Macollet à vouloir coucher au-dehors causait beaucoup de soucis à Angélique. Un jour, on ne pourrait plus parvenir jusqu'à sa cabane et il risquait de mourir sans qu'on le sût.
Pour faire plaisir à Angélique, les plus dévoués allaient deux fois par jour prendre des nouvelles du vieux et lui porter de la soupe chaude. Ils revenaient en toussant pour avoir pénétré dans l'épaisse atmosphère enfumée de la hutte, où Eloi Macollet, accroupi devant son feu, fumait voluptueusement son calumet de pierre blanche, en savourant sa liberté.
Chapitre 7
La neige tombait toujours.
– Une chance que ça ne nous ait pas pris huit jours plus tôt, disait-on.
Chacun y voyait un signe du ciel, et l'on y revenait toujours comme une preuve certaine que chacun sortirait vivant de l'aventure.
– C'est que ça n'est pas arrivé à tout le monde de s'en tirer !...
On se mettait à évoquer des précédents.
C'est qu'il y en a eu des colons morts en hivernage sur les côtes d'Amérique. Plus encore de faim et de maladie que massacrés par les sauvages. La moitié des pèlerins de Plymouth, entre autres, le premier hiver qui suivit leur débarquement du Mayflower, en Nouvelle-Angleterre, en 1620. Le Mayflower se tenait dans la rade, mais que pouvait ce navire, pas plus riche qu'eux en vivres frais, sinon regarder mourir ces malheureux et leur parler des côtes lointaines d'Europe. Et les Français de M. de Monts et de M. Champlain, les uns à l'île du fleuve Sainte-Croix, les autres pas loin de Gouldsboro justement, en 1606, la moitié aussi sont morts. La moitié du contingent débarqué, c'est un chiffre classique dans les histoires de famine.
On se regardait en dessous, en se demandant qui de ceux qui étaient présents se retrouveraient vivants au printemps.
Et l'hivernage de Jacques Cartier en 1535, dans la rivière Saint-Charles, sous Québec. Deux nefs se sont avancées trop loin sur le Saint-Laurent et quand l'hiver est venu ils se sont glissés prudemment dans la petite rivière Saint-Charles, se sont cachés contre la falaise et maintenant les deux nefs sont transformées en forteresses de glace. Et là-dedans les hommes meurent les uns après les autres, les gencives saignantes. Le chef sauvage de Stadacomé leur apporte une décoction d'écorce et, quand ils ont bu, ils guérissent et le reste est sauvé. Et la Demoiselle, l'histoire de la Demoiselle ? C'est la nièce du sieur de Roberval, qui vint au Canada en 1590. Son oncle, maudit jaloux, l'a abandonnée sur une île du golfe Saint-Laurent avec son amoureux, Raoul de Ferland ; ils ont fini par y mourir, fous. Et l'histoire de la fondation de Jamestown, où ils se sont mangés. Tant d'autres histoires. On n'en finit plus quand on se met à raconter des histoires de famine, en Amérique. La plus tragique, c'est celle des Anglais de sir Walter Raleigh dans l'île de Roanoke, en Virginie. C'était en 1587. Le chef des colons, John White, dut faire un voyage en Angleterre pour chercher des secours. Quand il revint dans l'île il ne trouva plus aucune trace des colons parmi lesquels se trouvaient sa femme et sa petite fille Virginia, le premier enfant blanc né sur le sol américain. Il a fouillé toutes les mers, toutes les côtes, toutes les forêts, une année durant, il n'a jamais rien retrouvé. Le mystère continue à planer sur le sort de ces premiers colons.
En écoutant ces récits, Angélique pensait à tout ce qu'elle pourrait cependant faire pour écarter d'eux le spectre de la famine et du scorbut. Elle les sentait hantés par la terreur ancestrale du « mal de terre ». Trop de naufrages, trop d'hivernage sur des terres désolées et inconnues ont ajouté à la légende. Pendant des siècles on s'est terré avec du lard salé et des biscuits. On ignorait ce qui pouvait se manger de la végétation hostile environnante, et d'ailleurs on n'avait rien planté. Pas eu le temps !... Et puis ce n'est pas l'affaire des marins que de planter. La terre immobile, qui ne va nulle part, s'endort sous son linceul blanc, marâtre implacable et indifférente, elle se rétrécit, se durcit, meurt. Elle s'en va, elle les laisse là, les hommes, sans rien. Plus rien. Plus un oiseau, plus un animal, plus une feuille. Tout est matière inconsommable : pierres, bois, neige. Plus rien, et le mal de la terre peu à peu se glisse dans les veines, ronge la vie, abat lame. L'air lui-même qu'on respire devient ennemi, dépouillé de toute vitalité par le gel... Il fait tousser, puis on meurt... Et maintenant, c'était leur tour, aux gens de Peyrac, d'affronter tout cela !... Le fort de Wapassou en plein désert, à plus de cent lieues de tout endroit habité, de Blancs et même de Rouges, c'était une folie. Ces femmes parmi ces hommes, c'était une gageure. Ces vies à maintenir durant le long temps de la mort totale de la nature alentour, c'était un exploit insensé. Ces esprits à garder sains parmi les fantasmagories que créent la solitude et la menace silencieuse des espaces illimités, c'était un pari d'une folle audace. Mais qui dit désert dit oasis. Qui dit grands espaces cruels dit refuge et douceur. Qui dit maux et malaises dit soins et remèdes. Qui dit peur et fatigue dit consolation et repos. Qui dit solitude dit accueil. Ainsi Angélique avait décidé d'être pour tous ceux qui étaient sous sa garde le contraire de ce qui les menaçait.

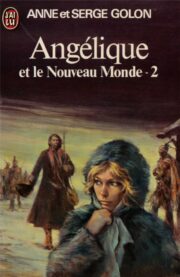
"Angélique et le Nouveau Monde Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2" друзьям в соцсетях.