– Ware ! Ware ! disait-il.
C'est-à-dire : l'eau. C'était un mot abénakis qu'avec lui elle finirait par savoir !
Plus loin on rencontra une eau très claire mais qui avait un goût de calcaire dur. Donc une eau ennemie. Angélique secoua la tête, fit mine de recracher l'eau et déclara qu'on ne pouvait en boire.
Mopountook approuva hautement. La femme blanche avait bien du discernement. La promenade continua et ils rencontrèrent des eaux rousses, ferrugineuses, des eaux troubles et inquiétantes mais savoureuses.
Alors, tard dans l'après-midi, il lui découvrit une source presque invisible au sein d'une petite clairière, une eau qui jaillissait et disparaissait simultanément, sans un frémissement, aussitôt bue par le terrain spongieux, une offrande silencieuse et ininterrompue de la terre, une eau à la saveur verte. On avait par elle le goût de la feuille sur la langue. Le printemps y revivait : cresson, sauge, menthe mêlés. Le charme de cette source agit sur Angélique jusqu'à lui faire perdre la notion du temps.
D'abord, elle avait essayé de faire comprendre à Mopountook qu'elle ne devait pas trop s'éloigner du poste. Plus tard, elle dut renoncer car ils avaient tellement tourné en rond dans la forêt qu'elle craignait de s'égarer en le quittant.
Le soir tombait lorsqu'on la vit réapparaître sur les talons du grand diable rouge. Elle était fourbue. Une fois de plus, on avait cherché dans l'inquiétude la comtesse de Peyrac. Mopountook se rengorgea. Il était extrêmement satisfait de sa journée de prospection des sources et des heureuses dispositions d'Angélique à les reconnaître. Digne et familier, il entoura d'un bras protecteur les épaules du comte, plutôt mécontent, et lui dit que son cœur se réjouissait.
La femme blanche, expliqua-t-il, était, naturellement, comme toutes ses pareilles, les femmes, assez rebelle, et un peu trop encline à persuader un homme qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais elle reconnaissait l'eau des sources et elle savait en distinguer le goût. C'était un grand don. Un don bénéfique. Lui, le chef local, car le lac Umbagog était de leur voisinage, il souhaitait que les Blancs demeurassent longtemps au lac d'Argent, et la piste des Appalaches renaîtrait, cette piste que les Indiens suivaient jadis en commerçant depuis le grand fleuve du Nord jusqu'aux rives de l'Océan.
Il se révéla que cette journée eut des conséquences bénéfiques. Car, dès le lendemain, les Indiens Métallacks se présentèrent disant qu'il serait bon que les Blancs vinssent participer avec eux à une dernière grande chasse avant l'hiver. Les Blancs apporteraient leurs fusils, poudre et balles et, en échange de l'aide mutuelle, on leur laisserait une part des bêtes piégées.
Les orignals ou élans commençaient à descendre du Canada vers les régions moins âpres du Maine. Mopountook, en revenant de Wapassou, était venu secouer ses Indiens, leur reprochant leur paresse juste au moment où le gibier connaissait une recrudescence passagère, qu'aussi bien leur indolence était la cause des famines qui les accablaient chaque année. Ils se figuraient toujours avoir assez de provisions, mais on n'a jamais assez de provisions pour traverser le long hiver. D'ailleurs, Mopountook avait fait un songe : le Manitou leur ordonnait d'organiser une dernière grande chasse et d'y convier les Blancs du lac d'Argent qui avaient affronté les féroces Iroquois et s'en étaient tirés vivants avec leurs cheveux sur la tête, par l'habileté de leurs langues et de leurs magies ! Et il en fallait pour convaincre un Iroquois de renoncer à sa vengeance. Ces Blancs avaient payé le prix du sang par l'incendie de leurs marchandises. Suivait alors la nomenclature de ces nombreuses et splendides marchandises, sacrifiées au feu et que les Indiens Métallaks récitaient sur un ton de litanies en se délectant. Cent balles de fourrures, de l'eau-de-vie, des couvertures d'écarlatine, etc. L'Homme du Tonnerre n'était pas un Blanc comme les autres. Il avait des pouvoirs. Mieux valait s'en faire un ami. Mopountook et les siens, les tribus du lac Umbagog, leurs voisins, les prenaient sous leur protection.
Nicolas Perrot, Florimond, Cantor et un des Anglais partirent, en leur compagnie, pour quatre ou cinq jours vers l'Ouest, afin d'organiser la plus grande chasse de l'année, tandis que l'effort des autres se portait à l'achèvement du poste.
Quand les chasseurs du lac Umbagog revinrent vers la fin de la première semaine de novembre, il y eut recrudescence de besognes et de travaux. Enfin, l'on put considérer que la réserve de vivres était suffisante. Avec de la chance, un printemps précoce, quelques bonnes pièces prises aux pièges qu'on placerait dans la neige, on franchirait l'hiver. Eloi Macollet hochait la tête, rassuré.
– On ne sera peut-être pas obligés de se manger entre nous.
– Que racontez-vous là ! Quelle horreur !...
– Hé ! c'est arrivé, ma bonne dame.
Il plaisantait à peine.
Angélique, en l'entendant, se sentait étreinte d'une brusque appréhension. Elle oscillait d'un état d'euphorie que lui inspirait la beauté de l'endroit désert et caché à celui d'une crainte naturelle, lorsqu'elle envisageait l'épreuve qui les attendait et combien ils étaient peu armés pour l'affronter. Ces hommes et ces quelques femmes entassés dans un espace restreint avec des vivres insuffisants, pas de remèdes, l'isolement total, pesant, dans un cercle fermé, ces enfants surtout, vies fragiles, devraient survivre à l'hiver.
Chapitre 4
Joffrey de Peyrac n'avait rien dit lorsqu'il avait vu Angélique prendre en main la dure tâche du boucanage. Elle se doutait qu'il l'observait de loin et tenait à se montrer à la hauteur.
– S'imagine-t-il que je ne suis bonne à rien et que je vais rester les bras croisés ? Il fallait gagner un an. C'était bien ce qu'il avait dit, n'est-ce pas ? Et pour l'instant ils possédaient à peine plus que leurs vêtements sur le dos.
L'aider à survivre, à triompher, avec quelle exultation secrète elle s'y emploierait, elle qui de si longtemps n'avait pu le servir.
La pensée d'œuvrer pour lui et de racheter en quelque sorte par ce fait ses trahisons passées illuminait les yeux d'Angélique. Et les besognes les plus rudes lui paraissaient faciles. Il y a des choses que le temps seul peut prouver. La fidélité d'un amour entre autres. Elle réussirait à abattre ce mur de méfiance à son égard qui hantait parfois Joffrey de Peyrac. Elle lui prouverait qu'il était tout pour elle et aussi qu'elle n'empiétait en rien sur sa liberté d'homme, qu'elle ne pèserait pas sur sa vie, qu'elle ne risquait pas de le détourner des travaux et des buts qu'il s'était assignés.
La crainte qu'il pût un jour regretter de l'avoir emmenée avec lui, ou même de l'avoir retrouvée, lui donnait des sueurs froides. Ce fut un temps où les aléas du campement les séparaient de nouveau ; elle se tourmentait loin de lui. Comme pendant le voyage les hommes s'entassaient vaille que vaille sous de rustiques abris d'écorce à l'indigène ; pour les femmes et les enfants, on avait bâti un wigwam plus spacieux avec à l'une des extrémités une petite cheminée hâtivement dressée. L'abri était suffisamment chaud mais Angélique recommençait à rêver qu'elle était encore seule, cherchant désespérément son amour perdu à travers le monde, ou bien elle le voyait, la rejetant, avec ce regard inflexible qu'il avait eu sur le Gouldsboro.
Aussi elle travaillait comme une esclave. Et dès qu'elle avait un instant elle courait avec les enfants dans la forêt pour ramasser des fagots. On manquait de bourrées et elle savait d'expérience que rien n'est pire par un matin d'hiver que de ne pouvoir allumer le feu. Ils se hâtaient de ramasser branches et branchettes tombées à terre pour les entasser dans la remise avec la réserve de bûches.
Ramasser du bois était une besogne qui avait toujours plu à Angélique. Au château paternel, lorsqu'elle était fillette, la tante Pulchérie disait que c'était le seul travail auquel elle consentait volontiers. Elle savait faire rapidement d'énormes fagots qu'elle portait sans faiblir. La première fois que les hommes de Peyrac l'avaient vue revenir du bois, comme une forêt en marche, et courbée comme une vieille femme sous sa charge, avec la petite troupe des enfants derrière elle, ils étaient demeurés bouche bée et n'avaient su que dire ni que faire. Elle accomplissait si parfaitement toutes les besognes entreprises qu'une intervention paraissait déplacée, et ils s'en abstinrent. Mais ils s'interrogeaient entre eux et n'arrivaient pas à se faire une opinion. C'était une femme qui avait travaillé dur dans sa vie, et que rien ne rebutait, mais c'était aussi une grande dame qui avait l'habitude d'être servie, de commander, de se payer du bon temps. Seulement, voilà, elle n'aimait pas qu'on mélange les deux côtés de son caractère.
Et si un homme, en ces temps de rudes et urgents travaux qui précédèrent le premier hivernage de Wapassou, s'approchait d'elle pour l'aider, il arrivait qu'elle le renvoyât un peu sèchement.
– Laissez donc, mon garçon, vous avez autre chose à faire de plus pressé ! Si j'ai besoin de vous, je saurai vous appeler.
Joffrey de Peyrac l'observait aussi. Il l'avait vue s'activer autour des feux de boucan, avec une compétence quasi professionnelle. Il l'avait vue dépouiller de leurs peaux des daims ou des cerfs, vider des entrailles, briser des os, plumer, couler la graisse nauséabonde, porter les chaudrons hors du feu, tout cela avec une habileté quasi miraculeuse de ses petites mains fines et racées et une énergie de portefaix.
Avec un mélange d'étonnement et d'estime, il la découvrait extrêmement vigoureuse, capable, entendue à mille choses auxquelles son éducation et surtout la vie dorée et luxueuse qu'il lui avait donnée à Toulouse ne semblaient pas l'avoir destinée. Et dans le mouvement d'irritation qui, parfois, avait été sur le point de le porter vers elle pour lui arracher le tranchoir, le couteau de boucher qu'elle maniait avec tant de dextérité, ou encore la chaudière pesante qu'elle déplaçait d'un seul coup de reins, ou la charge de bois mort sous laquelle elle se courbait, il avait senti la violence du mauvais sentiment douloureux que lui causait le souvenir des années de l'absence.

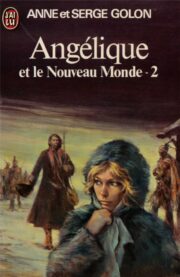
"Angélique et le Nouveau Monde Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2" друзьям в соцсетях.