La difficulté était de garder assez de bois à l'intérieur de cet abri pour alimenter sans cesse la flamme nécessaire. De quelques coups de hachette, Florimond avait coupé un fagot, pris aux branches basses des arbres alentour. Florimond se disait que parfois, au temps où il rêvait à son père en écoutant les récits du vieux Pascalou, à l'hôtel du Beautreillis2, il avait senti ce père plus proche de lui que devant l'homme lui-même, retrouvé. Pourtant, la rencontre qu'il en avait faite quelques années plus tôt était très semblable au rêve. Il avait trouvé en Nouvelle-Angleterre un homme de mer, un grand seigneur et un savant qui lui communiquerait sa science à laquelle il aspirait, bien plus que son cœur n'appelait à l'affection paternelle. Lorsque les jésuites chez lesquels il avait été pensionnaire un temps, près de Paris, accueillaient plus que froidement les mirifiques inventions de sire Florimond, celui-ci se consolait en se disant : « Mon père est bien plus savant que tous ces... imbéciles pour lesquels seule la scolastique compte, non les faits observés », et c'était vrai. S'il lui arrivait, maintenant que son père était devant lui vivant, de demeurer comme paralysé et muet de confusion, lui, Florimond qui avait conversé familièrement avec le roi Louis XIV et traité de haut de si éminents professeurs, c'était qu'il se trouvait en vérité subjugué par la personnalité transcendante de ce père dont il découvrait un peu plus chaque jour le savoir, l'expérience et jusqu'à l'endurance physique exceptionnelle. Joffrey de Peyrac sentait que son fils le considérait moins comme un père que comme un maître. Florimond, lorsqu'il était parti à sa recherche, atteignait ses quatorze ans. Il commençait à sentir le besoin d'un magister qu'il pût suivre avec confiance et ne découvrant parmi ceux qu'on lui désignait que sophisme et lâcheté, faux-fuyant, ignorance et superstition, il les avait fuis.
Lorsqu'il se penchait vers Florimond, le comte de Peyrac avait l'impression de contempler l'image même de sa propre jeunesse, comme en un miroir fidèle. Il reconnaissait en lui l'admirable égoïsme des amoureux de la Science et de l'Aventure, qui les rend insensibles à tout ce qui n'est pas la satisfaction dévorante de leur passion. Il se souvenait comment il était parti à quinze ans, boitant et s'attirant les quolibets pour sa laideur et sa démarche bancale, faire le tour de la terre. S'était-il alors soucié un seul instant de la mère qu'il laissait derrière lui et qui le regardait s'éloigner, lui le fils unique qu'elle avait arraché à la mort ?... Florimond était de son espèce. Il possédait la même désinvolture sentimentale. Elle lui permettrait d'atteindre les buts qu'il se fixerait sans se laisser distraire. On ne l'eût vraiment blessé à mort qu'en refusant le savoir à son avidité. Il réclamait la satisfaction de l'esprit beaucoup plus que celle du cœur.
Peyrac, en méditant sur le caractère de son fils, pensait que, devenu homme, lorsqu'il se serait éloigné définitivement des siens, il risquait de se montrer parfois insensible et même dur. Avec d'autant plus de morgue qu'il n'aurait pas à surmonter le handicap paternel d'un visage et d'une tournure disgraciés. Sa beauté lui faciliterait bien des choses...
– Père, dit Florimond à mi-voix, tu es beaucoup plus fort que moi, tu sais ? Comment as-tu acquis une telle endurance ?
– Par une longue vie, mon fils, où je n'ai guère eu le temps de laisser mes muscles se rouiller.
– Voilà où le bât me blesse, s'écria Florimond. Comment s'entraîner à la marche et à la course, dans ce Boston où notre seule distraction consistait à se pencher sur les livres d'hébreu ?
– Regrettes-tu la science acquise en ces quelques mois d'internat ?
– À vrai dire... non, j'ai pu lire l'Exode, dans le texte, et j'ai beaucoup progressé, en grec, en étudiant Platon.
– Parfait ! Dans l'internat qui s'ouvre pour vous sous ma juridiction, vous aurez l'occasion de fortifier vos corps ainsi que vos esprits. Aujourd'hui te plains-tu que l'entraînement ait été trop doux ?
– Ah non, s'exclama Florimond qui se sentait courbaturé des pieds à la tête.
Le comte s'étendit de l'autre côté du feu appuyé sur son havresac. Autour d'eux, la forêt les entourait d'un silence glacé, ponctué de mille bruits secs qu'on ne s'expliquait pas et qui faisaient sursauter.
– Tu es plus fort que moi, père, répéta Florimond.
Ces derniers jours avaient été une leçon pour sa vanité facilement satisfaite.
– Pas en tout, mon garçon. Ton cœur à toi est net, serein. Ton insensibilité te protège comme une armure et elle te permettra d'entreprendre certaines choses que, moi, je ne peux plus affronter car mon cœur, à moi, est enchaîné.
– Est-ce dire que l'amour affaiblit ? demanda Florimond.
– Non, mais être responsable d'autres vies que la sienne entrave terriblement la liberté ou ce que nous appelons liberté au printemps de nos vies. Vois-tu, l'amour, comme toute connaissance nouvelle, enrichit, mais il est écrit dans la Bible : « Accroître sa science, c'est accroître sa peine. » Ne sois pas impatient de tout posséder, Florimond. Mais ne renonce à rien de ce que peut t'offrir l'existence, par peur d'en souffrir. La folie, c'est de vouloir tout posséder à la fois. Le jeu de l'existence, c'est de remplacer une force par une autre. La jeunesse est libre, soit, mais l'adulte est capable d'aimer, et c'est un sentiment merveilleux.
– Penses-tu que je connaîtrai ces joies ?
– Quelles joies ?
– L'amour dont tu parles.
– Il se mérite, mon fils, et il se paye.
– Je m'en doute... Et il se fait même payer aux autres, dit Florimond en frottant ses tibias endoloris.
Le comte de Peyrac rit de bon cœur. Avec Florimond, ils se comprenaient toujours à demi-mot. Florimond rit aussi et lui lança un regard complice.
– Tu es plus gai, père, depuis que tu as ramené notre mère parmi nous.
– Toi aussi, mon fils, tu es plus gai.
Ils se turent, pensant à des choses vagues où passait le visage d'Angélique et qui peu à peu se cristallisaient autour de l'homme qu'ils poursuivaient et qui s'était introduit parmi eux, comme un loup pour leur faire offense.
– Sais-tu, père, qui me rappelle ce lieutenant de Pont-Briand, dit brusquement Florimond. En plus raffiné, en moins vulgaire, certes, mais de la même étoffe malgré tout. Il ressemble, c'est affreux, au capitaine Montadour3.
– Qui était-ce ce capitaine Montadour ?
– Un ignoble porc qui gardait notre château avec ses soudards, par ordre du Roi, et qui insultait ma mère par ses seuls regards. Combien de fois n'ai-je pas eu envie de lui crever la panse ! Mais je n'étais qu'un enfant et je ne pouvais rien pour la défendre. Ils étaient beaucoup trop nombreux, ces soudards et beaucoup trop puissants... Le Roi, lui-même, voulait la perte de ma mère et sa reddition...
Il se tut et rassembla autour de lui sa lourde casaque doublée de peau de loup qui lui tenait lieu de couverture. Son silence se prolongeant, Joffrey de Peyrac le crut endormi, mais le jeune garçon reprit soudain :
– Tu dis que mon cœur est encore fermé, insensible, mais là tu te trompes, père.
– Vraiment ?... Serais-tu amoureux ?
– Pas dans le sens que tu l'entends. Mais j'ai dans le cœur une blessure d'amour qui ne me laisse pas souvent en paix et depuis quelque temps une haine profonde me tourmente. Voilà ! Je hais les hommes qui ont tué mon petit frère Charles-Henri. Lui, je l'aimais...
Il se redressa sur un coude et ses yeux brillaient de fièvre tandis qu'il penchait son visage en avant dans la clarté des flammes.
« En effet, je me trompais, pensa le comte, son cœur vit. »
Florimond expliqua.
– C'était mon demi-frère, le fils que ma mère a eu du maréchal du Plessis-Bellière.
– Je sais.
– C'était un enfant adorable et je l'aimais. Je suis sûr que c'est Montadour qui, de sa main, l'a égorgé pour se venger de ma mère qui le repoussait. Un homme à la ressemblance de Pont-Briand qui se pavanait il y a quelques jours encore, satisfait de sa belle prestance, de son sourire jovial... Tout à fait la même suffisance !... Et quand je pense à Montadour, je me prends à haïr tous les Français reîtres et paillards, et leurs sourires si contents d'eux-mêmes. Pourtant je suis français aussi. Parfois j'en veux à ma mère de m'avoir empêché d'emmener sur mon cheval mon petit frère : je l'aurais sauvé. Il est vrai qu'il était si petit. Aurais-je pu le préserver de tout ? Lorsque je repense à ces choses, c'est là que je vois que je n'étais qu'un enfant... Je ne le croyais pas à ce moment-là, mais je n'étais qu'un enfant aux mains nues... malgré mon épée. Et ma mère était plus désarmée encore. Je ne pouvais rien faire pour la défendre, la soustraire à la lâcheté de ses tourmenteurs. Je n'ai pu que partir à ta recherche. Maintenant, je t'ai trouvé et nous sommes forts tous les deux, toi, son mari, moi, son fils. Mais il est trop tard, ils ont eu le temps d'achever leur œuvre de lâcheté. Rien ne pourra ressusciter le petit Charles-Henri...
– Si, un jour, il ressuscitera un peu pour toi.
– Que veux-tu dire ?
– Le jour où tu auras toi-même un fils.
Florimond fixa son père avec surprise puis poussa un soupir.
– C est vrai ! Tu as raison de me parler ainsi, merci, père !
Il ferma les yeux et parut las. Pendant toute cette évocation, il avait parlé à phrases brèves et lentes. Comme s'il découvrait au fur et à mesure des vérités qu'il n'avait pas encore regardées en face. Et pour le comte aussi, c'était un coin du voile mystérieux qui se déchirait sur l'existence inconnue et douloureuse qu'Angélique avait vécue loin de lui. Elle ne parlait jamais du petit Charles-Henri. Par tact envers lui, par crainte aussi peut-être. Mais son cœur de mère saignait-il moins que celui de Florimond ?...

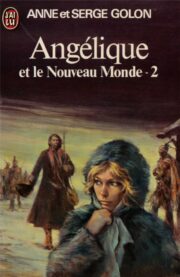
"Angélique et le Nouveau Monde Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2" друзьям в соцсетях.